 C’est un album qui a à peine existé, obsolète avant d’avoir vécu, égaré à côté de son époque dès sa sortie, en 1971. A côté de toutes les époques, d’ailleurs, puisque les quelques rééditions – une en CD en 2004, l’autre en vinyl en 2012 – sont rapidement devenues introuvables. C’est donc peu dire que cette ultime tentative pour rattraper les décennies perdues, à l’instigation de l’excellent label espagnol You Are The Cosmos, est bienvenue. C’est surtout un album qui pratique la nostalgie à chaud, proclamant en acte son amour pour une époque déjà révolue – la première partie des sixties – sans le moindre espoir de la ressusciter au-delà des quelques minutes que durent chacune de ces douze chansons. Un album composé par ceux qui ont déjà trop vécu pour entretenir encore la moindre illusion. Un très grand album de passions musicales résignées. Continuer la lecture de « Rockin’ Horse, Yes It Is (You Are The Cosmos) »
C’est un album qui a à peine existé, obsolète avant d’avoir vécu, égaré à côté de son époque dès sa sortie, en 1971. A côté de toutes les époques, d’ailleurs, puisque les quelques rééditions – une en CD en 2004, l’autre en vinyl en 2012 – sont rapidement devenues introuvables. C’est donc peu dire que cette ultime tentative pour rattraper les décennies perdues, à l’instigation de l’excellent label espagnol You Are The Cosmos, est bienvenue. C’est surtout un album qui pratique la nostalgie à chaud, proclamant en acte son amour pour une époque déjà révolue – la première partie des sixties – sans le moindre espoir de la ressusciter au-delà des quelques minutes que durent chacune de ces douze chansons. Un album composé par ceux qui ont déjà trop vécu pour entretenir encore la moindre illusion. Un très grand album de passions musicales résignées. Continuer la lecture de « Rockin’ Horse, Yes It Is (You Are The Cosmos) »
Catégorie : chronique réédition
Catégories chronique réédition
Neutrals, Kebab Disco (Emotional Response)
 Après avoir sorti à l’arrache plusieurs cassettes, les Neutrals avaient fait presser en 2019 un excellent LP au titre des plus loufoques : Kebab Disco. Victime de son succès, le disque attendait d’être réédité et c’est leur label Emotional Response Records qui a eu la bonne idée de le ressortir en version vinyle orange limitée à 100 exemplaires. On me dira qu’au vu des frais de ports prohibitifs pour l’acheminer vers la France, personne ne l’achètera, mais cette réédition sera une bonne occasion, pour ceux qui seraient passés à côté, de découvrir ce groupe californien.
Après avoir sorti à l’arrache plusieurs cassettes, les Neutrals avaient fait presser en 2019 un excellent LP au titre des plus loufoques : Kebab Disco. Victime de son succès, le disque attendait d’être réédité et c’est leur label Emotional Response Records qui a eu la bonne idée de le ressortir en version vinyle orange limitée à 100 exemplaires. On me dira qu’au vu des frais de ports prohibitifs pour l’acheminer vers la France, personne ne l’achètera, mais cette réédition sera une bonne occasion, pour ceux qui seraient passés à côté, de découvrir ce groupe californien.
Neutrals, c’est Allan McNaughton à la guitare et au chant, Phil Benson à la basse et aux choeurs et Phil Lantz à la batterie, trois quadras établis dans la région de San Francisco, qui prolongent allégrement l’adolescence en s’adonnant à une garage pop dans la veine de The Jam, des Undertones et des meilleures groupes de power-pop des années 80. Continuer la lecture de « Neutrals, Kebab Disco (Emotional Response) »
Catégories chronique réédition, mardi oldie
The Beau Brummels, Turn Around : The Complete Recordings, 1964-1970 (Now Sounds)
 Il aura fallu près d’un mois pour commencer à digérer cette rétrospective quasi-intégrale de l’œuvre initiale de The Beau Brummels : huit volumes remplis à ras-bord – plus d’une trentaine de morceaux sur certains CD’s – qui composent un récit chronologique exhaustif – et pour partie inédit d’une petite épopée. Il y a pourtant bien des raisons valables de consacrer quelques heures d’attention au legs de ce groupe que l’on considère souvent comme secondaire. Réévaluer son importance relative, sans doute. Mais, après tout, cet aspect de la besogne a été déjà préalablement amorcé depuis que, au début du siècle, le jeu érudit des réhabilitations rétrospectives a conduit les amateurs de l’archéologie du folk-rock à panthéoniser au moins deux des albums les plus novateurs et donc remarquables du quintette de San Francisco : Triangle (1967) et Bradley’s Barn (1968). Continuer la lecture de « The Beau Brummels, Turn Around : The Complete Recordings, 1964-1970 (Now Sounds) »
Il aura fallu près d’un mois pour commencer à digérer cette rétrospective quasi-intégrale de l’œuvre initiale de The Beau Brummels : huit volumes remplis à ras-bord – plus d’une trentaine de morceaux sur certains CD’s – qui composent un récit chronologique exhaustif – et pour partie inédit d’une petite épopée. Il y a pourtant bien des raisons valables de consacrer quelques heures d’attention au legs de ce groupe que l’on considère souvent comme secondaire. Réévaluer son importance relative, sans doute. Mais, après tout, cet aspect de la besogne a été déjà préalablement amorcé depuis que, au début du siècle, le jeu érudit des réhabilitations rétrospectives a conduit les amateurs de l’archéologie du folk-rock à panthéoniser au moins deux des albums les plus novateurs et donc remarquables du quintette de San Francisco : Triangle (1967) et Bradley’s Barn (1968). Continuer la lecture de « The Beau Brummels, Turn Around : The Complete Recordings, 1964-1970 (Now Sounds) »
Catégories chronique réédition, mardi oldie
Spiritualized, Ladies and gentlemen we are floating in space (Fat Possum)
 On ne sait pas toujours de quoi est faite la réalité. Lorsque cet album sort, le 16 juin 1997, l’ouverture de son packaging médicamenteux et le décollement de l’opercule en alu du blister laissent planer dans toute la pièce l’aura opiacée de Jason Pierce et l’arbre généalogique chargé du groupe. Ladies and Gentlemen We Are Floating in Space est le troisième album studio de Spiritualized. A la fois vaporeux et terriblement ancré dans la matérialité physique de la musique, on y trouve des apparitions du Balanescu Quartet et du London Community Gospel Choir. Qualifié d’album space rock psychédélique, il atteindra pourtant la quatrième place des charts britanniques, au plus fort de la période Britpop. Continuer la lecture de « Spiritualized, Ladies and gentlemen we are floating in space (Fat Possum) »
On ne sait pas toujours de quoi est faite la réalité. Lorsque cet album sort, le 16 juin 1997, l’ouverture de son packaging médicamenteux et le décollement de l’opercule en alu du blister laissent planer dans toute la pièce l’aura opiacée de Jason Pierce et l’arbre généalogique chargé du groupe. Ladies and Gentlemen We Are Floating in Space est le troisième album studio de Spiritualized. A la fois vaporeux et terriblement ancré dans la matérialité physique de la musique, on y trouve des apparitions du Balanescu Quartet et du London Community Gospel Choir. Qualifié d’album space rock psychédélique, il atteindra pourtant la quatrième place des charts britanniques, au plus fort de la période Britpop. Continuer la lecture de « Spiritualized, Ladies and gentlemen we are floating in space (Fat Possum) »
Catégories chronique réédition, mardi oldie
Aztec Camera, Backwards And Forwards – The WEA Recordings 1984-1995 (Cherry Red)
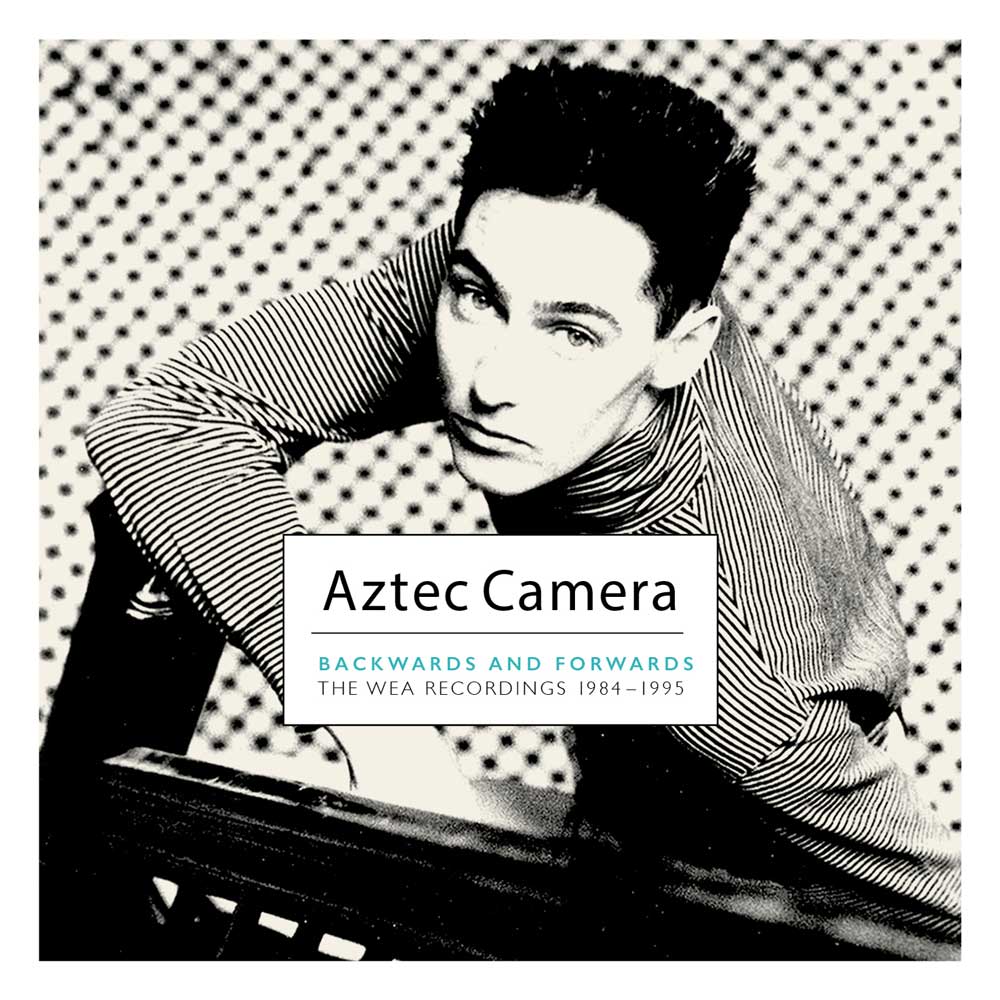 Il faut compter ici pas moins de neuf disques – tous les albums originaux avec leurs bonus respectifs, de Knife (1984) à Frestonia (1995)- accompagnés de deux volumes d’enregistrements live et une autre paire de fourre-tout, hétéroclites mais précieux, consacrés aux remixes et autres titres rares – pour parvenir à restituer l’intégralité de cette histoire passionnante. De ces histoires plutôt, tant l’épopée de Roddy Frame et d’Aztec Camera au cours des deux dernières décennies du siècle passé comporte d’éléments riches et contrastés qu’un recul apaisé tend, une fois encore, à réévaluer. Continuer la lecture de « Aztec Camera, Backwards And Forwards – The WEA Recordings 1984-1995 (Cherry Red) »
Il faut compter ici pas moins de neuf disques – tous les albums originaux avec leurs bonus respectifs, de Knife (1984) à Frestonia (1995)- accompagnés de deux volumes d’enregistrements live et une autre paire de fourre-tout, hétéroclites mais précieux, consacrés aux remixes et autres titres rares – pour parvenir à restituer l’intégralité de cette histoire passionnante. De ces histoires plutôt, tant l’épopée de Roddy Frame et d’Aztec Camera au cours des deux dernières décennies du siècle passé comporte d’éléments riches et contrastés qu’un recul apaisé tend, une fois encore, à réévaluer. Continuer la lecture de « Aztec Camera, Backwards And Forwards – The WEA Recordings 1984-1995 (Cherry Red) »
Catégories chronique réédition, mardi oldie
Arpanet, Wireless Internet/Inertial Frame (Record Makers/Bigwax)
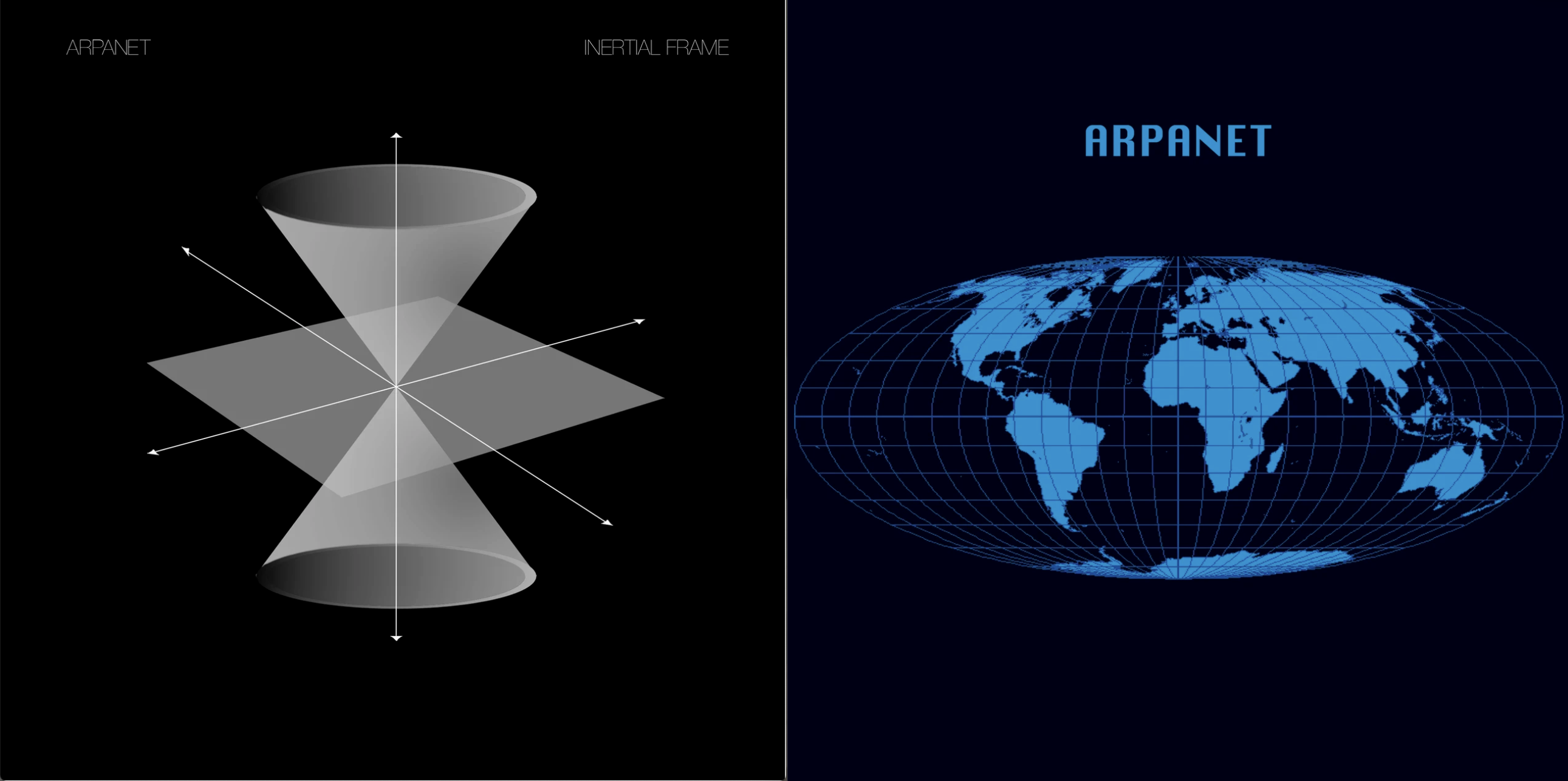
Dans More Brilliant than the Sun (1), livre considéré comme culte et étude définitive sur l’afrofuturisme, le théoricien et critique Kodwo Eshun élabore la catégorie de « Sonic Fiction » pour rendre compte du potentiel narratif et fictionnel de tout un pan de la musique afro/anglo-saxonne. Du jazz à la Jungle, en passant par le Dub, le Hip Hop et bien évidemment la techno, autant de courants qui ont en effet pu participer à la configuration d’un continuum esthétique marqué par une grande tonalité SF et futuriste. Que l’on évoque les fantasmagories cosmiques et l’imaginaire spatial de Sun Ra, ou les assauts militaro-cyberpunks et militants du label Underground Resistance, la puissance de configuration fictionnelle portée par ces musiques apparaît comme l’une de leur caractéristiques essentielles. Continuer la lecture de « Arpanet, Wireless Internet/Inertial Frame (Record Makers/Bigwax) »
Catégories chronique réédition, sunday archive
Jonathan Richman, I, Jonathan (Rounder, 1992, réédition Craft Records 2020)
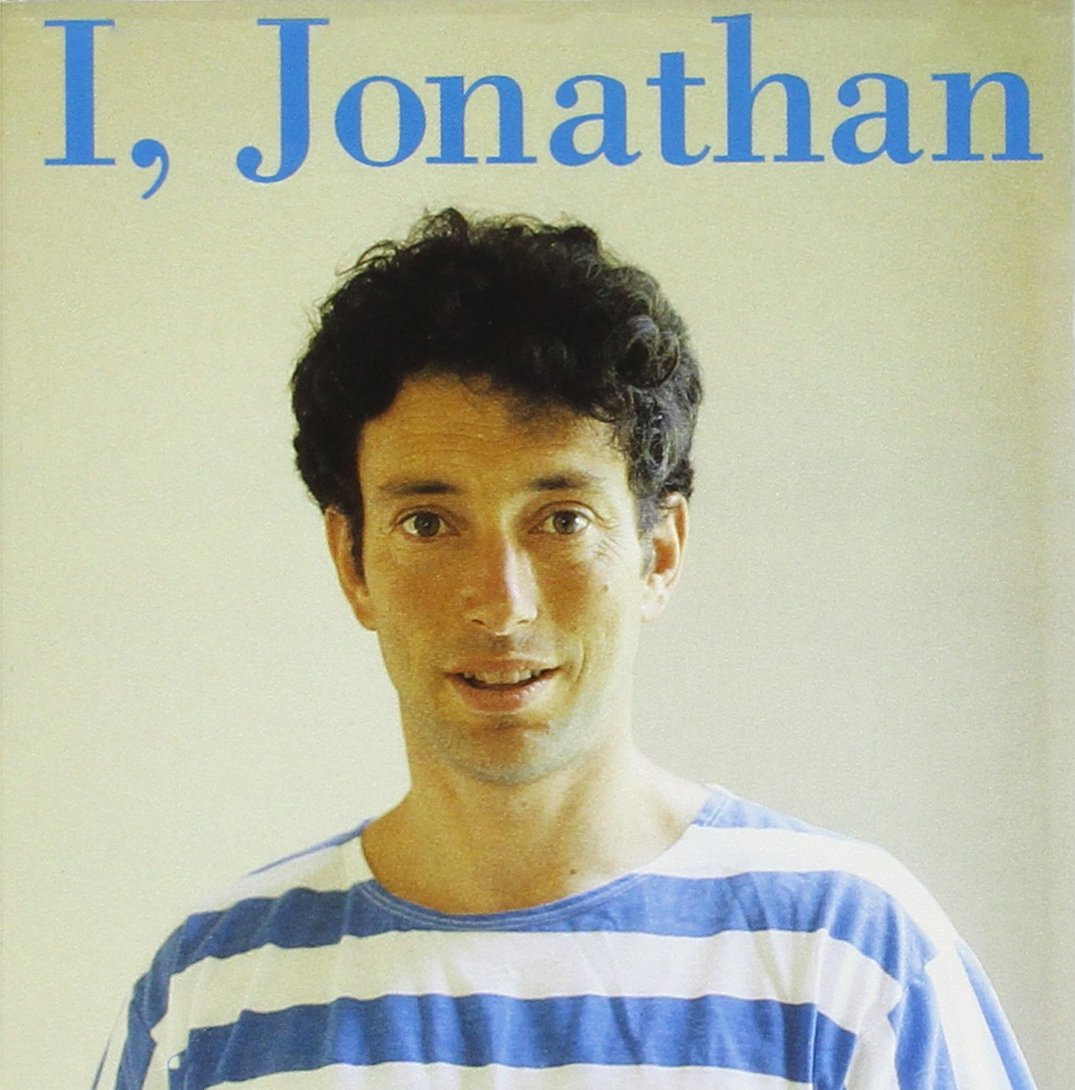 Jojo, le héros.
Jojo, le héros.
Le vôtre, le mien, le nôtre, le tout un chacun, chacun sait, chacun a sa version.
C’est un homme qui sort un brin de l’ordinaire.
Faire court ? Lui sait, moi pas. Cette réédition en vinyle d’un album de 1992 permet toutefois d’en dire pas mal. Car c’est le moment où il est notre idole absolue (sur les bons conseils des Pastels, de Galaxie 500, des oubliés Rockingbirds et de Duglas des BMX Bandits) et même s’il ne sait pas trop où il en est lui-même, il sait toujours où nous trouver. Il sort d’ailleurs régulièrement des disques relativement excitants à l’époque, à l’inverse d’un Lou Reed*.
Catégories chronique réédition, mardi oldie
Henri Salvador, Homme Studio 1970-1975 (Born Bad Records)
 Après deux compilations dédiées à Pierre Vassiliu (Face B et En Voyages), le label Born Bad et le musicien Guido Cesarsky (Acid Arab) s’attaque à un autre monument inattendu de la chanson française : Henri Salvador. Trésor bien gardé de la production francophone des années 60/70, la bien nommée Homme Studio apporte un éclairage nécessaire sur l’œuvre d’un des musiciens les plus iconoclastes de son époque. Déjà quarantenaire et sacrément expérimenté au moment de l’explosion yéyé du début des années soixante, Henri Salvador navigue dans les décennies avec un recul que n’ont pas toujours ses contemporains. Continuer la lecture de « Henri Salvador, Homme Studio 1970-1975 (Born Bad Records) »
Après deux compilations dédiées à Pierre Vassiliu (Face B et En Voyages), le label Born Bad et le musicien Guido Cesarsky (Acid Arab) s’attaque à un autre monument inattendu de la chanson française : Henri Salvador. Trésor bien gardé de la production francophone des années 60/70, la bien nommée Homme Studio apporte un éclairage nécessaire sur l’œuvre d’un des musiciens les plus iconoclastes de son époque. Déjà quarantenaire et sacrément expérimenté au moment de l’explosion yéyé du début des années soixante, Henri Salvador navigue dans les décennies avec un recul que n’ont pas toujours ses contemporains. Continuer la lecture de « Henri Salvador, Homme Studio 1970-1975 (Born Bad Records) »


