
Le 25 février 2019 a été une journée noire pour tout admirateur de la pop anglaise dans ce qu’elle a de plus ambitieux, avant-gardiste et intemporel, un peu plus de trois ans après le chant du cygne de Bowie. La disparition de Mark Hollis, dont nous n’avions presque plus aucune nouvelle depuis 1998, sonnait le glas de nos espoirs d’entendre à nouveau sa voix si particulière, lui qui osa l’utiliser comme un instrument (oui, c’est un cliché !), mais un de ceux dont personne n’avait joué avant. Je me consolais en me disant que j’avais eu la chance de le rencontrer il y a plus de vingt ans, quelques semaines après Christophe Basterra dont l’article figure ici-même. Je ne vais donc pas ajouter grand-chose de plus, il l’a si bien écrit.
Mais…
À l’époque, en parallèle de mes chroniques pour la RPM, j’écrivais pour une autre revue, plus mainstream sur le plan culturel (pour dire ça poliment), et désormais disparue : Tribeca 75. Je leur proposais parfois des interviews d’artistes que je n’aurais jamais pu rencontrer autrement (Radiohead, The Chemical Brothers) en sachant qu’il y avait peu de chances que l’interview soit publiée. Désolé si une attachée de presse lit ce passage… Je les utilisais comme ils m’utilisaient, sans doute. Ainsi, je leur ai proposé une interview de l’ancien chanteur de Talk Talk en leur disant : si, c’est le mec qui chantait dans vos années lycées new wave, Number me with rage, it’s a shame (Such a shaaaame). En plus, son album sort chez Polydor et vous connaissez très bien l’attachée de presse. J’ai dû être bien pénible car ils ont fini par accepter et j’ai eu mon rendez-vous.
Je me souviens du choc ressenti à l’écoute de l’album solo de Mark Hollis.
Comment sept ans après le sommet que constitue le dernier album de Talk Talk, Laughing Stock, avait-il pu réussir à en repousser les limites et à le surpasser ?
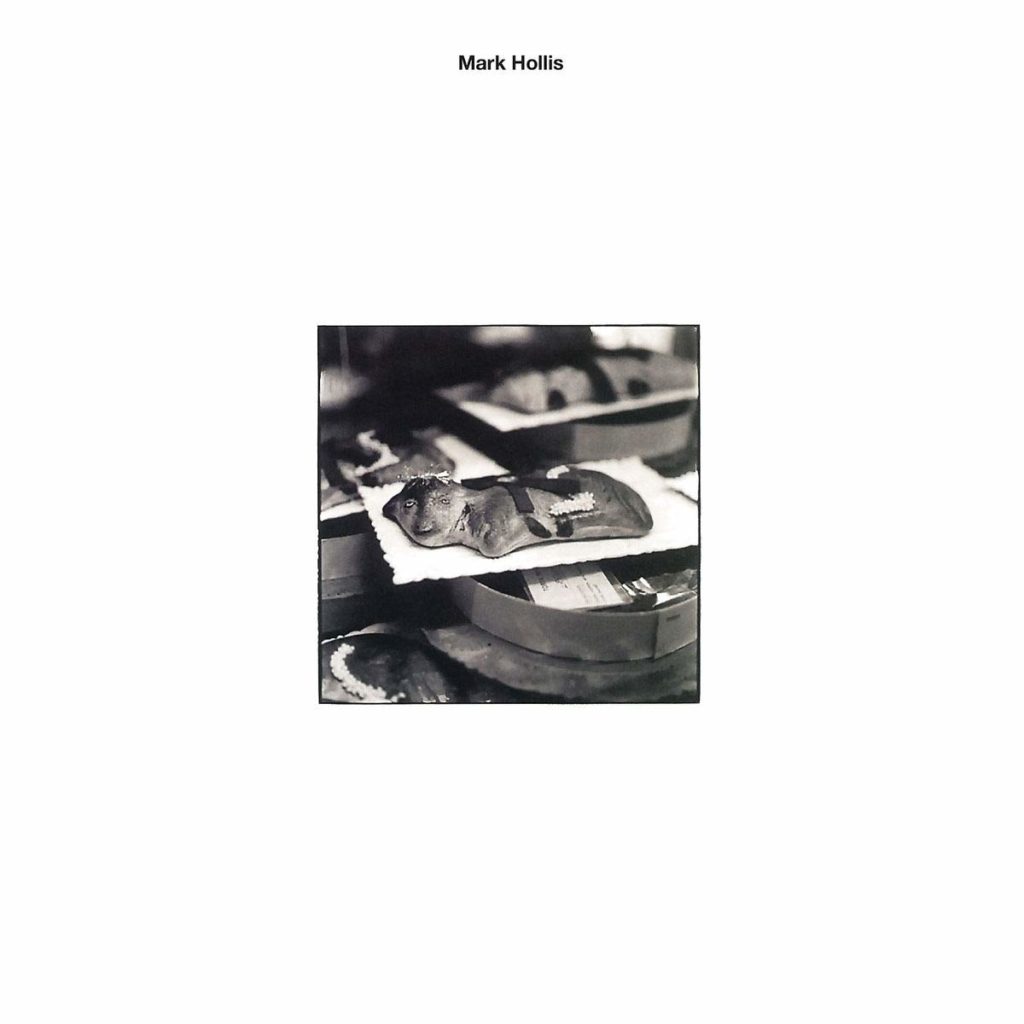
Pour ma génération (et d’autres heureusement), les deux derniers albums de Talk Talk c’est comme le second de Slint ou le premier de The Apartments (ce sont des exemples, il y a aussi Secrets Of The Beehive de David Sylvian pour en prendre un autre). Bref, des albums cultes, qui ne se sont pas pas très bien vendus mais dont l’influence sur l’existence même de certain-e-s a été indéniable. Sauf que contrairement aux autres, Mark Hollis avait eu la chance de rencontrer un succès planétaire et donc d’avoir les moyens, ensuite, soit de continuer à jouer le jeu avec comme finalité de terminer dans les stades, pour un temps, comme Tears For Fears. Ce qui est dommage car The Hurting, leur premier album, reste un grand disque. Oui, d’accord, il y a Mad World dessus, mais aussi Pale Shelter et cette balade qui vous tord les tripes, Memories Fade.
Donc je disais, soit faire de la musique comme divertissement pour amuser et détendre les foules ou renoncer à tout ça, et utiliser les royalties qui en découlent pour faire de la musique, comme on entrait en religion il y a longtemps, à corps perdu, et ne surtout pas se répéter, aller vers l’inconnu. Là est le vrai challenge et peu de musiciens, qui ont été des grosses stars, ont osé s’aventurer vers là. Mark Hollis, ainsi que ses collègues, Lee Harris, Paul Webb, Simon Brenner et leur producteur Tim Friese-Greene (leur Teo Macero à eux) ont réussi cela. On ne le redira jamais assez mais les deux derniers albums de Talk Talk sont des merveilles absolues que l’on écoutera avec la même ferveur dans cinquante ans.
Bref, Mark Hollis, l’album, réussit la prouesse de repousser les limites de ce qu’avait atteint Talk Talk. Aux croisements de l’avant-garde minimaliste, du jazz, de la musique classique, il clôt remarquablement cette trilogie qu’il forme avec Spirit of Eden et Laughing Stock, même si Mark Hollis s’en défend, comme il le dit dans l’interview de Christophe Basterra. Par exemple, quand il tend vers le dépouillement le plus complet à l’image de son morceau d’introduction, qui commence après non pas dix sept mais dix neuf secondes de silence, le bien nommé The Colour of Spring.
Simplement accompagné d’un piano minimaliste, Mark Hollis chante comme un homme illuminé : Soar the bridges that I burnt, puis ajoute : before, dans un murmure dont il faut la preuve des paroles du livret pour être sûr que l’on a bien compris. Et de même pour la fin, quand il chante : One song among puis us all, que l’on devine plus qu’on ne l‘entend. Comme s’il s’excusait de son exaltation.
J’ai toujours pensé que cet album était, pour Mark Hollis, un doigt d’honneur à l’industrie musicale, au monde dans lequel il vivait. J’ai toujours eu ce fantasme d’un artiste qui plutôt que de hurler sa colère et sa rage avec une musique agressive aurait préféré faire un pas de côté ou sortir sur la pointe des pieds, dans un murmure. Comme dans ce morceau de Frank Sinatra, Angel Eyes, qui se termine par ces mots : Excuse me while I… disappear (la version Live at the Sands est la meilleure). C’est le sens que je donne à cet ultime album de Mark Hollis, bien sûr, je ne saurais jamais s’il serait d’accord avec cette interprétation fantasmée, j’étais bien trop jeune pour oser lui poser une question pareille.
Donc voilà, la rencontre a eu lieu un après-midi dans le luxueux hôtel Le Royal Monceau, endroit incongru pour parler de musique, mais passage obligé pour les artistes en promo dans une major à l’époque. Loin de l’artiste élitiste, intello, Mark Hollis était au contraire, simple et naturel, comme vous et moi, juste passionné par la musique et avec le talent de savoir l’exprimer avec ce sens de l’essentiel. Je me souviens de son empathie, son écoute, de sa disponibilité. Une entrevue courte, quarante minutes maximum, le média n’était pas assez puissant en termes de vente pour espérer avoir plus. Et l’attaché de presse est venu me le rappeler après quarante minutes montre en main.
Je ne pensais pas à l’époque à préserver ces moments d’intimité, partagés avec des artistes rares et passionnés. Aussi, je l’ai enregistré par dessus une cassette promo que Polydor m’avait filé de l’album Low Estate des 16 Horsepower. Allez savoir pourquoi ! Bien sûr, par la suite, cette interview n’étant pas plus importante que cela pour le magazine, comme je m’y attendais, elle passa à la trappe. Mais au moins, j’avais rencontré Mark Hollis. Chose curieuse, j’aurais pu m’en servir pour mon émission de radio sur Aligre FM, Helter Skelter, mais je ne l’ai pas fait. Ne me demandez pas pourquoi une fois de plus. Le destin, sans doute. Cela faisait plusieurs années que je me disais qu’il fallait que je la retrouve, pour lui donner une visibilité. Car j’en avais un souvenir fort. L’une de mes rencontres phares, elle me rappelle celle avec Vini Reilly en 1991, un autre artiste que l’on pourrait croire autiste, sauf que lui n’était quand même pas très en forme. Il aura donc fallu que Mark Hollis disparaisse pour que je trouve le temps de fouiller dans mes cartons et la retrouver. Ainsi, un an après sa mort, je pensais qu’il était important de lui rendre hommage et cela me fait plaisir que cela soit pour Section 26 après tout ce temps depuis l’époque RPM.
Pour clore, je me faisais cette réflexion que certains des plus grands artistes sont attirés vers la beauté qui se dégage de la fragilité des choses et de leur aspect éphémère. Je pense à Nick Drake par exemple, mais aussi un poète comme Percy Shelley qui l’a bien écrit également. Mark Hollis nous le rappelle et a su mieux que personne capturer cette fragilité en musique. Apprécions ces moments pendant qu’ils sont (encore) là.
Viviane Morrison

Qu’avais-tu en tête au moment de te lancer dans l’aventure de ce premier album solo ?
Quand je décide d’enregistrer un disque, j’ai une priorité : ne pas me répéter. Avec Laughing Stock, les méthodes d’arrangement et d’enregistrement de Talk Talk avaient atteint leurs limites. Pour ce nouvel album, j’ai souhaité une approche minimaliste et acoustique. J’ai utilisé le minimum de matériel en cherchant à ce que les titres sonnent le plus réel possible.
Sept années se sont écoulées entre The Laughing Stock et ce premier album solo. As-tu passé tout ce temps à travailler sur ce disque ?
Pas vraiment. Le travail s’est étalé sur plusieurs périodes. Certaines étaient consacrées à l’écriture des bois, d’autres à la notation ou au piano. J’ai passé beaucoup de temps à jouer de la musique par plaisir. Sans penser à l’enregistrement d’un album.
Quels sont les artistes dont tu te sens proche aujourd’hui ?
Ces derniers temps, j’ai beaucoup écouté Morton Feldman. C’est un compositeur avec lequel je ressens des affinités. Surtout à travers son approche des instruments. Sa composition de quatuor à cordes et clarinette est ce que j’ai entendu de mieux depuis bien longtemps.
Pourrais-tu nous parler du contraste entre les moments de silence et l’instrumentation très acoustique de cet album solo ?
Je pense que la musique n’est que contrastes. Les rechercher est une façon de trouver sa voie. J’ai voulu créer une musique dans laquelle le silence est aussi important que ce qui le brise. J’aimerais un jour arriver à enregistrer des instruments acoustiques originaux et arriver à dévoiler leur fragilité. J’aimerais également pouvoir écrire dans un style inédit. Par exemple, avec des éléments de musique classique faisant écho au jazz, qui lui-même fait écho à quelque chose d’autre. La musique ne devrait pas se limiter à un seul élément. Elle doit laisser une impression avant de se diriger ailleurs. Il faut se fixer un but, sinon composer n’a aucun intérêt.
Pourquoi avoir réduit les arrangements au strict minimum ?
Pour avoir une approche simpliste afin que chaque élément trouve sa place quand tu enregistres. Cela nécessite un ingénieur du son talentueux. Il doit comprendre la façon dont tu veux créer un équilibre et ajuster quand cela est nécessaire. Bien que toutes ces choses existent comme un ensemble, et malgré le fait que cela puisse paraître insignifiant, certains instruments sont naturellement plus dominants que d’autres. Pour que tout puisse s’inscrire dans un cadre sonore, il faut quelqu’un d’un haut niveau de technicité.
Vers qui t’es-tu tourné pour obtenir le son que tu avais en tête ?
Phill Brown. Il a travaillé sur The Colour of Spring et The Laughing Stock. Je le connais depuis longtemps. Il a joué un rôle important dans ce nouvel album. Contrairement à ce que l’on pourrait penser, il n’a pas été enregistré en live, mais l’idée était d’en créer la sensation.
Le disque fait parfois penser à du Robert Wyatt. Est-ce un artiste dont tu te sens proche ?
Je m’entends bien avec Robert Wyatt. Je suis fan de son travail depuis ses débuts avec Soft Machine. C’est un batteur incroyable. Son chant est également fascinant. La façon dont il exécute les vocaux sur Shipbuilding est à couper le souffle.
L’Ex-Japan David Sylvian emprunte aussi des directions intéressantes. Certaines font parfois penser à ton travail.
C’est difficile à dire. Je sais qui est David Sylvian mais je ne connais pas bien sa musique.
Pourrais-tu nous parler de ton approche du chant ?
J’ai voulu chanter de la façon la plus naturelle possible. L’aspect lyrique est primordial. Il faut réussir à faire exister les paroles mentalement pour qu’elles soient chantées de façon correcte. Pour obtenir un bon résultat, il faut enregistrer les voix et la musique avec les mêmes critères. Sans faire d’exception.
Arriver à une telle liberté d’écriture a-t-il été compliqué ?
J’ai eu de la chance grâce à Talk Talk. It’s My Life, notre deuxième album, a connu un énorme succès. Cela nous a permis d’avoir suffisamment d’argent pour enregistrer The Colour Of Spring et Spirit of Eden selon nos conditions.
J’ai lu que tes deux films préférés étaient Le Voleur de Bicyclette de Vittorio De Sica et Les Enfants du paradis de Marcel Carné.
Ah oui définitivement. Absolument.
Et peux-tu nous dire pourquoi ?
Parce que je trouve que la narration est secondaire dans Le Voleur de Bicyclette. Il s’agit plutôt de ce que ressentent les protagonistes. Ce que j’aime dans ce film, c’est la relation entre le père et le fils. Elle est tellement puissante. Le fait que tu prennes un objet comme une bicyclette qui est si accessoire, anecdotique, et pourtant les implications de ce que cet objet signifiait pour cette famille est si vaste.
Est-ce que tu te tiens au courant de ce qui se passe dans le domaine culturel contemporain ?
J’aime le fait qu’à Londres, il soit possible d’accéder à une installation artistique complètement dingue. À tel point qu’il est impossible d’imaginer une ville autre qu’une capitale financer ce genre de choses. Je suis allé voir une exposition de Nicholas Pope à la Tate. Il y exposait d’énormes modèles en argile. On y sentait une forte odeur d’huile brulée. Il y avait également un fond sonore industriel. Les statues étaient regroupées dans une sorte de chapelle mexicaine. Il lui a fallu plus de sept années pour réaliser cette œuvre (The Apostles Speaking in Tongues Lit By Their Own Lamps, ndlr). Il a développé une maladie qui empêchait son cerveau de fonctionner normalement mais il a continué à travailler. Mutual Interest, une œuvre de Michal Rovner m’a également marqué. Elle comportait trois écrans diffusant pendant vingt minutes des images hors-champ, avec des zooms étranges. Là aussi, sur fond de musique industrielle.

Tu es un Londonien de naissance. Quel est ton rapport à cette ville ?
J’aime vivre à Londres. Je m’y sens à la maison. C’est là où mes enfants vivent. Je veux qu’ils grandissent dans une société multiculturelle. Je veux aussi pouvoir leur proposer une grande variété d’activités. J’ai juste quitté cette ville quelques années. J’étais dans un cycle album – tournée qui n’en finissait pas. Je voulais me trouver un endroit reposant, calme et avec beaucoup d’espace. Je voulais faire partie d’une petite communauté plutôt que d’être un anonyme à Londres. Quand l’un de mes fils a eu huit ans, un âge important dans le développement des enfants, j’ai eu envie qu’il soit un peu plus conscient de ce que représentait le monde. Nous sommes repartis vivre à Londres.
Trouves-tu parfois ton inspiration dans les livres ?
Le pouvoir des livres est puissant. Ils te forcent à travailler ton imagination. En littérature comme en musique, tu dois essayer de trouver une force et un rythme différent. Je pense tenir quelque chose de spécial avec les paroles de Westward Bound. Je n’irai pas jusqu’à dire qu’elles sont plus importantes que les autres, mais j’en suis particulièrement fier. Elles sont peut être parmi ce que j’ai fait de mieux. Je trouverais plus simple d’écrire de la musique pour accompagner un livre que pour un film. Un livre contient plus de subtilités. Il est plutôt rare qu’un film inspiré d’un livre soit de meilleure qualité que l’histoire originale. Ça se confirme encore avec un livre de Bruce Chatwin que j’ai lu la semaine dernière. Il s’appelle On The Black Hill. Une fois le livre terminé, j’ai loué le film. Je n’ai pas pu tenir plus de dix minutes.
Tu donnes l’impression de t’inspirer de la musique de Ravel. Est-ce vraiment le cas ?
On m’a fait écouter tout à l’heure un morceau de Ravel censé ressembler à un titre du nouvel album. Je ne le connaissais pas. Mes compositions préférées de Ravel sont les Trois Poèmes de Mallarmé, ses quatuors à cordes et ses Miroirs pour piano. Particulièrement la section Oiseaux Tristes, que je trouve vraiment superbe.
Ton style d’écriture a évolué avec le temps. Il atteint une nouvelle dimension avec cet album solo.
C’est un changement naturel. Quand j’ai commencé à composer, la formule classique couplet / refrain / couplet me plaisait bien. J’ai rapidement cherché à ne pas me répéter. C’est une évolution que je trouve normale. Je n’étais pas le seul à aller dans ce sens. Après le succès avec It’s My Life, Tim Friese-Greene nous poussait sans cesse à nous renouveler. Pour Myrrhman, le premier titre de The Laughing Stock, nous voulions composer une chanson dans laquelle aucune partie ne se répétait. Pour le titre suivant, Ascension Day, le premier couplet faisait sept mesures, le second neuf mesures, le troisième dix mesures. Il a fallu ajouter des paroles en cohérence avec ce cadre complexe. Tout cela dans le but d’aller de l’avant. Avec le nouvel album, j’ai opté pour plus de minimalisme dans les arrangements. Il n’y a jamais plus de quatre ou cinq mesures. On y trouve beaucoup d’instruments acoustiques enregistrés calmement, de la manière la plus réaliste possible.
Ton premier groupe était The Reaction. Et vous aviez un titre sur une compilation punk avec The Nosebleeds, le premier groupe de Vini Reilly, de Durutti Column, (Streets sorti par Beggars Banquet en 1977). Je me demandais si tu appréciais sa musique…
Non je ne connais pas ce qu’il fait. (NDLR : A-t-il vraiment compris ma question, vu mon accent déplorable ?)
Mais est-ce que tu te souviens de cette période et de vos débuts ?
Je me souviens de la première chanson enregistrée par The Reaction. C’était Talk Talk Talk Talk. Deux heures trente se sont écoulées entre le moment où nous sommes entrés dans le studio et le moment où nous en sommes sortis. Nous étions fous de joie de nous trouver dans un studio d’enregistrement malgré la contrainte du peu de temps alloué. Je me souviens très bien de cette période. Nous avions encore un travail. Le peu que l’on gagnait partait en sessions dans des studios minuscules. Souvent pour une demie heure, car nous ne pouvions pas nous permettre de payer plus de dix livres sterling à la fois. Nous avons passé des heures à enregistrer des démos dans le but de décrocher un contrat avec une maison de disque. Nous n’avions pas le temps d’y prendre une tasse de thé, ni de faire de pause. Chaque minute gaspillée nous coûtait une fortune ! Avec du recul, j’ai réalisé que le meilleur moyen de se comporter en studio est d’avoir une attitude indifférente et détendue. Il faut mettre tes musiciens le plus à l’aise possible pour qu’ils donnent le meilleur d’eux-mêmes.
À l’époque, qu’est-ce qui te motivait pour faire de la musique ? Etait-ce à cause du mouvement punk ?
Ah oui, absolument.
Et penses-tu que c’est toujours important pour toi ? Je parle de l’état d’esprit…
Oui totalement, car ça part de l’idée que la musique est pour tout le monde. Nous sommes tous musiciens et si tu as suffisamment de chance pour gagner ta vie avec la musique, c’est un bonus, mais ce n’est pas essentiel.



Excellent article et merveilleuse interview, merci !
C est un artiste que j adore et que j écoute encore souvent. Il est resté naturel et humble, vraiment un grand Homme. Parti beaucoup trop tôt 😢
C est une personne magnifique.reposez en paix mr Hollis
Mark Hollis. Une fulgurance dans la pesanteur provinciale des années Mitterand. Combien de fois je me suis demandé ce qu’il était devenu. Combien de fois j’avais trouvé juste et sensible l’idée de se retirer sur la pointe des pieds, comme ça, pour aller s’occuper de ses enfants, avoir une famille, cultiver sa terre, chérir sa chair. On n’a rien su du reste. Toutes ces années. La maladie qui l’a emporté, le lieu ou il repose désormais. Qu’importe. La vie te pousse comme le vent, la vie ne dure qu’un temps. Il faut la mener avec la même intensité. Tout faire et ne jamais se retourner.
Bonjour ,
J’ai le sentiment d’avoir perdu un ami précieux….un temps précieux à le réaliser aussi….
La vie ne dure qu’un temps oui…un laps de temps très court..comme une respiration..
Mais je pense qu’il a vécu comme il le souhaitais et c’est l’essentiel dans une vie humaine
Mark Hollis. repose en paix! Cher Ami
Angélique Grand-Guillaume