
Il y a tous ceux qui commencent tôt et s’épuisent vite. On pourrait aussi recenser quelques exemples – plus rares, il est vrai – de débutants tardifs, qui conquièrent moins précocement une forme de reconnaissance associée à la maturité. Leonard Cohen bien sûr. Guy Chadwick aussi. Et puis, il y a Daniel Wylie. Classé hors-catégorie depuis presque trente ans, ce songwriter écossais ultra-doué n’est jamais vraiment rentré dans les cases de ces parcours balisés. Ces quelques mois de gloire, il les a connus à quarante ans, alors que le groupe dont il était le pilote principal et presque unique, Cosmic Rough Riders, signait sur l’éphémère label Poptones, lubie fin de siècle d’un Alan McGee sorti rincé de l’aventure Creation. Un hit – Revolution In The Summertime – et même un passage à Top Of The Pops à l’âge presque canonique où les superstars adolescentes sont déjà en préretraite. Un petit tour devant les projecteurs et puis c’est tout. Pour ce qui est de la notoriété, les plats ne sont passés qu’une seule fois. Pour ce qui est des chansons, il en va tout autrement. Depuis 2006, Wylie a construit à un rythme soutenu – un albums tous les deux ans environ – une œuvre d’une qualité exceptionnelle, où les références à ses idoles américaines de toujours (Neil Young, R.E.M. pour les plus évidentes) n’excluent jamais la recherche de tonalités plus personnelles. Figure discrète mais centrale de la scène musicale de Glasgow, il vient de publier Atoms And Energy et raconte quelques-uns des jalons d’une trajectoire musicale atypique et essentielle.
 Tu as commencé à jouer dans plusieurs groupes au début des années 1980 – Pioneers West ou The Thieves notamment. A quel moment as-tu commencé à envisager la musique comme une activité à plein temps ?
Tu as commencé à jouer dans plusieurs groupes au début des années 1980 – Pioneers West ou The Thieves notamment. A quel moment as-tu commencé à envisager la musique comme une activité à plein temps ?
J’ai commencé par travailler comme menuisier puis comme charpentier pendant presque neuf ans. Alors que je n’étais qu’un apprenti, plusieurs de mes copains jouaient déjà dans des groupes de reprises, des groupes de bal. Je les accompagnais souvent le week-end, quand ils allaient jouer dans des clubs ou des bases de l’armée de l’air américaine autour de Glasgow. Un soir, l’un d’entre eux m’a proposé de monter sur scène pour chanter un titre. J’ai choisi la version de Knock On Wood de David Bowie. Ils m’ont trouvé plutôt bon et j’ai continué. J’étais un grand fan de musique et j’ai trouvé cette première expérience très agréable. Dès les premières minutes, je suis devenu accro. J’ai ensuite répondu à une petite annonce dans la presse locale et je me suis retrouvé dans le local de répétition avec ceux qui allaient devenir The Thieves – je crois qu’ils n’avaient pas encore de nom à l’époque. Je leur ai proposé d’écouter une des chansons que j’avais composée à la maison et ils l’ont trouvé un peu meilleure que les leurs : c’est comme cela que je suis devenu songwriter. Nous sommes restés ensemble environ cinq ou six ans sans vraiment parvenir à percer en dehors de l’Ecosse. Les représentants des maisons de disques passaient souvent nous voir après les concerts pour nous dire : « Vous y êtes presque ! » Et puis, rien ne se passait. A force d’y être presque, on a fini par laisser tomber. C’est assez classique. En tous cas, la leçon que j’ai retenu de cette période, c’est que je préférais tenter ma chance seul plutôt que de m’astreindre à une discipline collective trop contraignante. Et c’est ce que j’ai plus ou moins réussi à faire avec Cosmic Rough Riders qui n’a jamais été un vrai groupe. Plutôt moi avec des musiciens. Même si McGee était persuadé d’avoir signé un groupe.
Poptones m’est toujours apparu comme un label un peu bizarre, à la fois consacré à des rééditions et à des nouveautés un peu à côté de leur époque. De l’intérieur, comment as-tu vécu cette période ?
J’étais très impressionné par Alan McGee parce que j’étais un grand fan de Creation depuis longtemps. Mon ami Davie Wells, qui réalisait les premières pochettes de Cosmic Rough Riders, avait été dans un groupe, H20, avec Alan McGee en 1978. C’est lui qui lui a envoyé le premier album que nous avions publié, Deliverance, en 1999. Il est venu nous écouter en concert, dans le sous-sol du Nice’N’Sleazy à Glasgow. Et, au bout de trois chansons, il sautait partout en criant : « Est-ce que vous voulez signer un contrat ? » C’est comme cela que nous nous sommes retrouvés sur Poptones. Je n’avais pas très envie de m’engager en tant que membre d’un groupe parce que, fondamentalement, ce n’en était pas un. Mais j’avais déjà quarante et un ans et c’est une opportunité que je ne pouvais pas laisser passer. J’ai saisi ma chance et ça n’a pas marché. C’était de bons musiciens mais sans doute pas les bons musiciens pour moi. Je me souviens que Gus Dudgeon est passé nous voir, quelques mois avant sa mort en 2002, dans les loges d’un concert à Manchester. Il m’a dit qu’il aimait beaucoup les chansons mais que le groupe ne fonctionnait manifestement pas, ni en studio, ni sur scène et que tous les morceaux sonnaient de la même manière, terriblement monotone. Je me suis pris une énorme claque ce jour-là, parce que je trouvais que nous n’étions pas si mauvais que ça, même si nous ne nous entendions pas forcément très bien. C’est en réfléchissant un peu plus tard que j’ai décidé de partir.
S’il y a un point commun entre tous tes albums, tout au long des décennies, c’est un certain amour des mélodies.
Je ne sais pas vraiment d’où ça vient. Je suis conscient que, en Ecosse, il y a pas mal de musiciens de ma génération qui ont ce don commun et cette passion pour les mélodies : Duglas des BMX Bandits, Gerry, Norman et Raymond de Teenage Fanclub ou encore David Scott des Pearlfishers. J’imagine que ce n’est pas complètement un hasard, mais je ne pourrais pas l’expliquer. Pour ce qui me concerne, cela remonte à la plus petite enfance, en tous cas. Mes premiers souvenirs, quand j’avais trois ou quatre ans, se rapportent à la musique : je me rappelle très bien les premiers moments où j’ai entendu les disques de mon père. Beaucoup de country, au début. Hank Williams, ce genre de choses. Et puis, ça a continué à l’école. Quand j’avais douze ou treize ans, j’inventais déjà des chansons pour les chanter à mes copains. Je ne leur avouais pas que c’était de moi. On se baladait dans la rue et, tout à coup, je leur disais : » Eh ! J’ai entendu une super chanson de Steve Miller à la radio ce matin. Je peux vous la chanter si vous voulez : je me souviens des paroles. » Et j’improvisais à moitié un morceau de mon cru. Et souvent, ils trouvaient ça super. J’ai l’impression que j’ai toujours su écrire des chansons. Quand j’étais adolescent, j’adorais les solos de guitare. Je sais que ce n’est pas cool, mais c’est quelque chose que j’ai toujours admiré justement parce que je suis incapable de le faire. Je ne suis pas un guitariste virtuose, loin de là. Pour moi, c’est juste un instrument qui me permet de composer mes chansons et de transposer les mélodies qui me trottent dans la tête depuis que je suis tout petit. Ce sont les mélodies qui me permettaient de m’évader dans les limbes et l’imaginaire.

Tes influences principales semblent souvent plus américaines qu’anglaises.
J’ai grandi en écoutant essentiellement des artistes américains. Mon père écoutait beaucoup de country. Mes premières passions adolescentes se sont développées dans ce sillon : Steve Miller Band, Eagles, Joe Walsh, Steely Dan. Surtout Steely Dan ! J’étais fan inconditionnel. J’ai acheté mon premier disque de Steely Dan en 1972, quand j’avais treize ans. Je n’étais vraiment pas très grand à l’époque et j’arrivais tout juste à la hauteur du comptoir chez le disquaire. J’ai demandé au vendeur : « Est-ce que vous avez le dernier album de Steely Dan ? « Il m’a demandé : « C’est vraiment pour toi ? Tu es sûr que ce n’est pas pour ton grand frère ? « . Il a appelé tout le staff de la boutique : » Eh ! Venez voir ce gamin minuscule ! Il est cool, il aime Steely Dan ! » C’est un souvenir qui m’a énormément marqué. J’ai grandi dans un quartier HLM de Glasgow qui s’appelle Castlemilk. Les tours étaient très hautes et très serrées. De ma chambre, je ne pouvais apercevoir qu’un tout petit morceau de la ville, sur la colline : quelques centimètres de vue panoramique entre deux immeubles. La nuit, j’entrevoyais quelques lumières à l’horizon. Je concentrais toute mon attention sur ces lueurs lointaines en écoutant un de mes albums préférés de tous les temps – Barnstorm de Joe Walsh (1972)– à fond dans mon casque. C’était ma principale source d’évasion. Quand j’ai commencé à écrire des chansons, un peu plus tard, c’est quelque chose que j’ai conservé. Je n’ai jamais eu envie d’écrire sur mon enfance dans la cité. J’ai toujours préféré évoquer l’envie de m’évader de ce quartier dans lequel j’avais grandi et mes rêves de soleil et de palmiers.
Dans quel contexte es-tu parvenu à finaliser ce nouvel album ?
Toutes ces chansons étaient écrites avant que la crise sanitaire démarre. J’avais même commencé à enregistrer l’album mais tout a été ralenti à partir de 2020, notamment parce que je n’avais plus accès au studio. J’avais déjà terminé toutes les parties vocales, et même les harmonies ainsi que certaines parties de guitares. Au départ, j’avais l’intention de publier un album entièrement acoustique. Mais Johnny Smillie qui devait le coproduire avec moi trouvait que certains morceaux méritaient des arrangements un peu plus élaborés. Nous avons fait appel à plusieurs musiciens et notamment à Stu Kidd pour les percussions. C’était tellement compliqué à organiser que j’ai pensé à laisser tomber complètement ces chansons et à patienter jusqu’au déconfinement pour passer directement aux suivantes. Mais Johnny a finalement réussi à me persuader du contraire. Franchement, même quand il a eu terminé le mastering, je n’étais pas certain d’avoir envie de publier cet album : j’en avais un peu marre de ces morceaux qui trainaient depuis trop longtemps dans les tiroirs. J’ai décidé de faire une pause et de ne plus y toucher pendant environ six semaines. Et, quand je les ai réécoutés, je me suis dit qu’ils n’étaient pas si mauvais.
Le confinement n’a donc pas été insurmontable ?
Le confinement a eu tout un tas de conséquences désastreuses pour beaucoup de gens. D’un point de vue très égoïste, je l’ai très bien vécu. J’ai composé l’équivalent de treize albums pendant cette période. J’ai aussi collaboré avec d’autres artistes : j’ai cosigné un Ep avec Ian Bailey, un songwriter anglais que j’aime beaucoup, et aussi un autre disque avec le leader de Stay, un groupe de Barcelone dont le dernier album a été produit par Owen Morris. Donc, tu vois, je n’ai pas eu trop de mal à m’occuper !
Tu as souvent alterné entre des albums plus acoustiques, comme celui-ci, et d’autres pluies électriques. Pourquoi ?
 Au départ, c’est presque accidentel. Quand j’ai enregistré un de mes premiers albums solo, The High Cost Of Happiness (2006), je n’ai pas pu ajouter de guitares électriques tout simplement parce que j’étais complètement fauché et que je ne pouvais plus me payer le temps de studio nécessaire pour finaliser ce que j’avais initialement prévu. Et pourtant, j’ai trouvé que les versions acoustiques sonnaient plutôt correctement. Ça m’a fait réfléchir et ça m’a donné l’envie d’enregistrer un autre album acoustique un peu plus tard. C’est ce que j’ai fait en 2010 avec Fake Your Own Death qui reste un de mes préférés et sur lequel il n’y a aucune guitare électrique. La plupart du temps, quand j’ai composé une dizaine de chansons et que j’ai un petit budget pour les enregistrer, j’essaie de réunir un groupe pour deux ou trois jours de manière à obtenir un résultat qui me satisfait. Si besoin, je rajoute éventuellement une ou deux versions acoustiques quand j’ai dépassé mes limites financières et que je suis obligé de terminer seul ! Pour que ce ne soit pas du remplissage, il faut quand même que les mélodies soient assez bonnes pour soutenir la comparaison avec le reste de l’album.
Au départ, c’est presque accidentel. Quand j’ai enregistré un de mes premiers albums solo, The High Cost Of Happiness (2006), je n’ai pas pu ajouter de guitares électriques tout simplement parce que j’étais complètement fauché et que je ne pouvais plus me payer le temps de studio nécessaire pour finaliser ce que j’avais initialement prévu. Et pourtant, j’ai trouvé que les versions acoustiques sonnaient plutôt correctement. Ça m’a fait réfléchir et ça m’a donné l’envie d’enregistrer un autre album acoustique un peu plus tard. C’est ce que j’ai fait en 2010 avec Fake Your Own Death qui reste un de mes préférés et sur lequel il n’y a aucune guitare électrique. La plupart du temps, quand j’ai composé une dizaine de chansons et que j’ai un petit budget pour les enregistrer, j’essaie de réunir un groupe pour deux ou trois jours de manière à obtenir un résultat qui me satisfait. Si besoin, je rajoute éventuellement une ou deux versions acoustiques quand j’ai dépassé mes limites financières et que je suis obligé de terminer seul ! Pour que ce ne soit pas du remplissage, il faut quand même que les mélodies soient assez bonnes pour soutenir la comparaison avec le reste de l’album.
Quelle place occupe la musique dans ta vie quotidienne ?
J’ai lu quelque part que le bon moment pour écrire une chanson, c’est souvent au réveil, tôt le matin parce que l’esprit est encore à moitié plongé dans le monde des rêves. J’ai commencé à essayer cette méthode il y a un peu plus de deux ans et ça me convient assez bien. J’ai de la chance, j’imagine, mais quand je prends ma guitare et que je laisse venir l’inspiration, j’arrive en général à trouver deux ou trois mélodies correctes. Tous les jours ou presque, je pose un petit enregistreur sur la table et je laisser tourner pendant que je cherche des idées de chansons. Quand j’en ai à peu près 500, je les réécoute et je retiens celles qui me paraissent les plus intéressantes – une dizaine – dans la perspective d’un prochain album. Je ne sais pas pourquoi, mais c’est quelque chose qui m’a toujours paru assez simple. Je crois que si je me pose trop de questions, je risque de briser le charme. Alors j’évite de me poser des questions. Mon seul regret, c’est de ne jamais avoir gagné une somme suffisante à la loterie pour pouvoir finaliser tous ces albums inachevés que j’ai abandonnés en cours de route.
On retrouve pas mal de noms familiers au générique de l’album : Stu Kidd, Neil Sturgeon. Est-ce qu’il existe réellement une forme de communauté entre musiciens à Glasgow ?
Personnellement, j’applique le principe suivant : quand quelqu’un me demande de participer à un album, je ne demande jamais d’argent ; en revanche, je paie toujours les musiciens qui viennent contribuer aux miens. A mes yeux, c’est une manière de reconnaître leur implication et la valeur de leur travail. J’ai l’impression que les Ecossais en général sont des gens plutôt ouverts. Quand j’ai envie d’inviter un musicien, je lui demande donc assez directement. La plupart de ceux que j’ai rencontrés ont toujours accepté. Jim McCulloch de The Soup Dragons par exemple, à qui j’avais proposé de venir jouer sur deux chansons de Car Guitar Star (2008). C’est lui qui a décidé de rester un peu plus que prévu et, finalement, de contribuer à cinq ou six morceaux de cet album. Il est même repassé en 2017 pour Scenery For Dreamers : ce sont des liens qui se développent et s’entretiennent au fil du temps. Cela fait quand même bientôt trente ans que je joue de la musique : je finis par connaître quelques personnes. Ce sont tous d’excellents musiciens et il n’est pas nécessaire de leur donner des consignes très précises. Pour ce qui concerne Jim, par exemple, il a découvert les chansons en studio et m’a demandé ce que je voulais qu’il fasse. J’ai simplement répondu : » Joue quelque chose qui ressemble à du Fleetwood Mac, période Peter Green. « Et, dès la première prise, c’était parfait. Par ailleurs, ils composent tous leurs propres morceaux et ils comprennent très intuitivement ce qui est bon ou mauvais pour une chanson. Cela me permet de gagner du temps en studio et donc de faire des économies. Quand j’ai commencé, j’étais beaucoup plus directif et tatillon. A l’époque de Cosmic Rough Riders, je voulais tout contrôler, jusqu’à la moindre note. Petit à petit, j’ai compris qu’il était préférable, y compris pour ma propre santé mentale, que je laisse davantage de liberté aux autres. C’est ainsi qu’ils peuvent me donner le meilleur d’eux-mêmes.
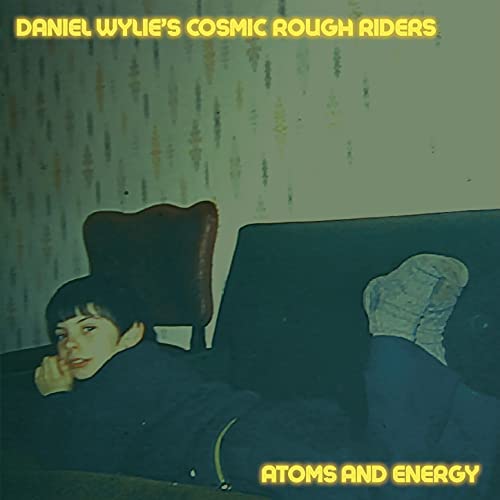 Certaines des chansons d’Atoms And Energy sont plutôt des ballades romantiques. D’autres évoquent des sujets plus généraux : les violences domestiques pour The Bruises And The Blood, la religion pour God Is Nowhere. Comment traiter de ces thèmes dans une chanson sans être pontifiant ou apparaître comme un donneur de leçons ?
Certaines des chansons d’Atoms And Energy sont plutôt des ballades romantiques. D’autres évoquent des sujets plus généraux : les violences domestiques pour The Bruises And The Blood, la religion pour God Is Nowhere. Comment traiter de ces thèmes dans une chanson sans être pontifiant ou apparaître comme un donneur de leçons ?
C’est toujours délicat, en effet. Quand j’aborde ces sujets, je m’efforce d’assumer le plus complètement possible une forme de subjectivité. Je ne prétends pas exprimer une vérité générale : je me contente d’exprimer un point de vue personnel et des sentiments particuliers qui me tiennent à cœur. Pour ce qui est de God Is Nowhere, j’ai reçu une éducation catholique très traditionnelle. Je me souviens que, dès que je suis arrivé à l’école, la première question que posait l’instituteur était : « Qui vous a créé ? » Evidemment, il fallait répondre : Dieu ! Et il enchainait ensuite : « Et qui a créé Dieu ? » C’est là que j’ai commencé à me dire que c’était vraiment un tas de conneries. Très tôt, j’ai compris que la religion n’allait pas occuper une place très importante dans ma vie. Pour ce qui est de l’écriture, j’essaie vraiment de me focaliser sur mes propres sentiments, exactement comme pour une chanson d’amour. En l’occurrence, j’ai essayé de restituer une partie de la fatigue ou de la colère que peut susciter chez moi la bêtise qui accompagne souvent l’adhésion à des dogmes ou une certaine forme de religion institutionnalisée. Pour The Bruises And The Blood, la démarche est un peu équivalente : je ne prétends pas traiter d’un sujet général, j’évoque une situation que je connais et qui m’a affectée indirectement. Il s’agit d’un couple de voisins qui vivait juste au-dessus de chez nous il y a quelques années. Le mec battait régulièrement sa femme. Plusieurs fois, il la virait de chez eux sans aucun vêtement après l’avoir battue et ma femme et moi la recueillions chez nous pour appeler la police. Mais aucune poursuite n’a été engagée à l’époque parce que les policiers considéraient qu’il s’agissait d’un simple problème domestique. J’ai lu récemment que les violences contre les femmes avaient explosé au Royaume-Uni pendant le confinement : ça m’a rappelé cet épisode et donné l’impulsion pour passer à l’écriture.
Il y a plusieurs photos de toi enfant sur la pochette : en quoi ces chansons se rapprochent-elles du monde de l’enfance selon toi ?
C’est une histoire un peu plus longue en fait. Cela remonte à l’album Chrome Cassettes en 2015. J’avais trouvé une vieille photo de mon frère et moi que mon père avait conservée. Comme mon frère n’a jamais joué de musique avec moi, j’avais décidé de l’effacer de l’image et il ne l’avait pas très bien pris, ce que je peux comprendre. Je lui avais donc promis de me rattraper, ce que j’ai fait cette fois-ci sur l’intérieur de la pochette. C’est un cliché qui avait été pris par un photographe professionnel et publié dans la presse locale – elle est même exposée désormais de façon permanente dans un restaurant de Glasgow qui s’appelle The Citizen. On y voit mon frère et moi, quand j’avais environ cinq ans, devant une vitrine de Noël. J’aime bien cette image parce que je trouve qu’on y discerne un mélange de bonheur et de tristesse. Il y a quelque chose de très pur dans le regard de mon frère. En même temps, la photo laisse transparaître une certaine forme de pauvreté, bien réelle à l’époque. Mes parents étaient des gens formidables et nous avons eu une enfance très heureuse. Mais les conditions matérielles étaient vraiment difficiles à cette période. Je vais continuer avec ce thème : j’ai déjà choisi la prochaine photo d’enfance pour la pochette du prochain album. J’aime bien me dire que l’amour de la musique qui était déjà présent dans la tête de ce petit garçon a continué à se développer et à grandir au fil des années, même s’il n’avait aucune idée qu’il deviendrait un jour un songwriter.


