 On en est persuadé depuis longtemps : la transmission de témoin peut devenir parfois, en matière de musique, un art à part entière. Et même une forme majeure pour tous ceux qui bénéficie de l’expertise transitionnelle des passeurs les plus doués et les plus convaincus de la nécessité impérieuse de défendre une cause presque perdue. En 1984, The Long Ryders font partie de ceux-là. Depuis quelques années, les membres du groupe gravitent alors autour de cette scène californienne au sein de laquelle des connections de plus en plus directes s’établissent entre la spontanéité crue et brutale du punk contemporain et la fascination légèrement teintée de nostalgie pour le rock garage des années 1960.
On en est persuadé depuis longtemps : la transmission de témoin peut devenir parfois, en matière de musique, un art à part entière. Et même une forme majeure pour tous ceux qui bénéficie de l’expertise transitionnelle des passeurs les plus doués et les plus convaincus de la nécessité impérieuse de défendre une cause presque perdue. En 1984, The Long Ryders font partie de ceux-là. Depuis quelques années, les membres du groupe gravitent alors autour de cette scène californienne au sein de laquelle des connections de plus en plus directes s’établissent entre la spontanéité crue et brutale du punk contemporain et la fascination légèrement teintée de nostalgie pour le rock garage des années 1960. 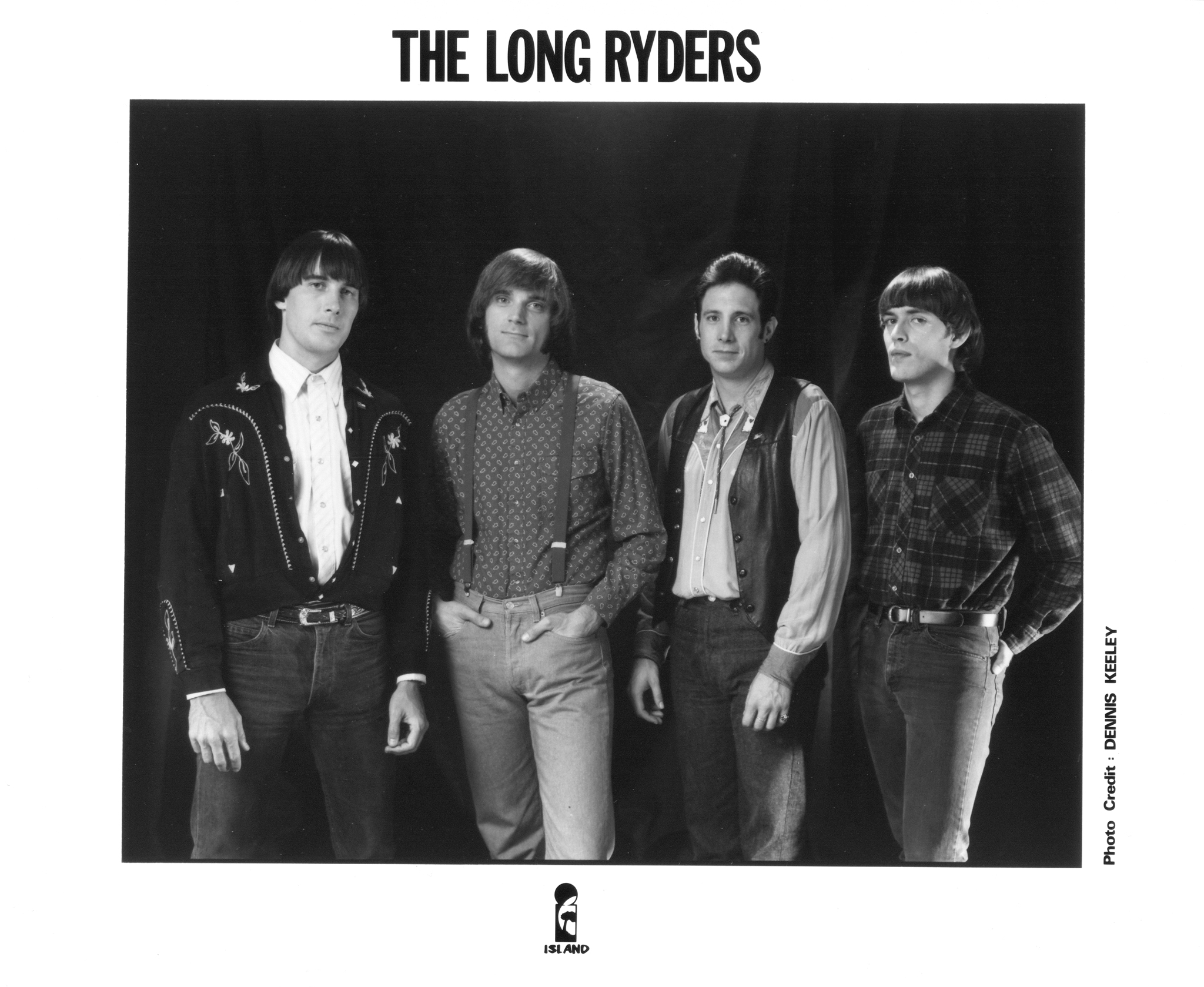 Les groupes s’y font et s’y défont au rythme des sautes d’humeur et des divergences d’interprétation de l’évangile rock. Sid Griffin, un songwriter fraîchement débarqué à Los Angeles en provenance de son Kentucky natal erre ainsi quelques temps, tente un début d’aventure en compagnie du batteur Greg Sowders et d’un certain Steve Wynn, avant que ce dernier décide de consacrer tout son temps à The Dream Syndicate. Sur la foi d’une petite annonce évoquant, pêle-mêle, un intérêt hétéroclite pour folk-rock, la musique Tex-Mex, la soul, la surf-music et les groupes psyché, le guitariste et songwriter Stephen McCarthy puis le bassiste Tom Stevens complètent la formation. En quelques mois, The Long Ryders se taille sur les scènes locales une réputation flatteuse et méritée avant de publier, coup sur coup, un premier Ep – 10-5-60 (1983) – et un album – Native Sons (1984). Ces deux premiers jalons, peut-être les plus importants de leur œuvre, sont ici rassemblés dans un coffret copieux et cohérent qui leur adjoint également l’ensemble des démos et des sessions radio de la période ainsi qu’un live enregistré à Londres en 1985. Quarante ans plus tard, il y a là de quoi dresser un bilan exhaustif des débuts discographiques d’un groupe qui demeure encore sous-évalué.
Les groupes s’y font et s’y défont au rythme des sautes d’humeur et des divergences d’interprétation de l’évangile rock. Sid Griffin, un songwriter fraîchement débarqué à Los Angeles en provenance de son Kentucky natal erre ainsi quelques temps, tente un début d’aventure en compagnie du batteur Greg Sowders et d’un certain Steve Wynn, avant que ce dernier décide de consacrer tout son temps à The Dream Syndicate. Sur la foi d’une petite annonce évoquant, pêle-mêle, un intérêt hétéroclite pour folk-rock, la musique Tex-Mex, la soul, la surf-music et les groupes psyché, le guitariste et songwriter Stephen McCarthy puis le bassiste Tom Stevens complètent la formation. En quelques mois, The Long Ryders se taille sur les scènes locales une réputation flatteuse et méritée avant de publier, coup sur coup, un premier Ep – 10-5-60 (1983) – et un album – Native Sons (1984). Ces deux premiers jalons, peut-être les plus importants de leur œuvre, sont ici rassemblés dans un coffret copieux et cohérent qui leur adjoint également l’ensemble des démos et des sessions radio de la période ainsi qu’un live enregistré à Londres en 1985. Quarante ans plus tard, il y a là de quoi dresser un bilan exhaustif des débuts discographiques d’un groupe qui demeure encore sous-évalué.
Comme bon nombre de leurs confrères ou concurrents du Paisley Underground – Rain Parade, Bangles, The Dream Syndicate – The Long Ryders manifestent d’emblée un désir d’échapper à une interprétation dominante de la modernité musicale en renouant avec des traditions encore largement enfouies. À la froideur synthétique et à la quête illusoire d’une fausse perfection sonore, tous préfèrent l’énergie simple et moins apprêtée du rock qui a bercé leur enfance. Pourtant, même s’ils ont été souvent assimilés à ces autres formations avec lesquels ils ont partagé le même espace-temps, Griffin et ses camarades se démarquent d’emblée par une prédilection assumée pour les racines plus lointaines du folk et de la country. Leur mission consiste à les exhumer, comme pour réaffirmer dans une ère d’artificialité triomphante, l’existence d’une autre Amérique, authentique et cachée. Entre cavalcades de cowboys punks et ballades folk-rock ouvragés, il n’y a quasiment rien à jeter sur ces disques. On reste tout particulièrement frappé par la qualité des guitares de Stephen McCarthy, qui ne palissent pas de la comparaison avec les virtuoses contemporains plus reconnus, Johnny Marr et Peter Buck en tête. Et les rares traces datées qui demeuraient encore sur la version originale de Native Sons – quelques batteries un peu trop clinquantes – sont même effacées par les versions démos, plus proches encore de l’intensité brute recherchée en première intention.

Comme souvent dans les albums que l’on prend autant de plaisir à revisiter qu’on a pu en éprouver au moment des premières découvertes adolescentes, les vertus propres des chansons – et elles sont grandes – sont ici redoublées par leur capacité à ouvrir des portes vers d’autres univers, à proposer des pistes et des liens inédits avec des mondes de l’art méconnus. Comme les amis les plus chers avec lesquels on aime à causer musique, The Long Ryders suggèrent davantage qu’ils n’imposent, glissant, ça et là, leurs allusions érudites à toutes ces passions qu’ils aiment à partager, sans lourdeur ni insistance. Elles sont offertes à qui souhaite les voir et les entendre, avec ce qu’il faut de mystère pour susciter le désir. Le temps nécessaire à l’écoute de ces trois CD’s suffit à peine à recenser l’ensemble des références précises, pointues et de tous les détails érudits qui témoignent, tout autant que les morceaux qu’ils accompagnent, de cette passion communicative pour un passé largement négligé. En commençant par cette pochette, soigneusement pompée sur celle de Stampede (1967) le deuxième album putatif de Buffalo Springfield, celui qui n’est jamais officiellement sorti. Et puis le nom du groupe, qui reprend le titre d’un western de Walter Hill – The Long Riders (1980), Le Gang des Frères James dans sa traduction française – dont l’orthographe est ostensiblement altérée pour rendre hommage à The Byrds, sans doute le point de repère le plus évident. Gene Clark accepte d’ailleurs d’adouber les débutants en les invitant d’abord en première partie puis en enregistrant avec eux les chœurs d’Ivory Tower. Des Byrds, on passe logiquement aux Flying Burrito Brothers : le producteur Henry Lewy – celui de The Gilded Palace Of Sin (1969) – est recruté pour accoucher du premier album. Et la reprise de Sweet Mental Revenge – un morceau country signé Mel Tillis et popularisé par Waylon Jennings – est directement inspirée par une version pirate de l’interprétation qu’en a fait Gram Parsons quelques mois avant sa mort. Et puis on croise aussi Dylan (la reprise très rock de Masters Of War), et les Flamin’ Groovies. Et l’écrivain Nick Tosches – Final Wild Son, le titre du premier morceau de l’album est extrait d’un passage de la biographie qu’il a consacrée à Jerry Lee Lewis, Hellfire (1982). On comprend que tout cela entourne, fascine et donne très envie de filer plus avant les indices qui mènent vers toutes ces sentes et tous ces ponts disposés à rebrousse-temps. Pourtant, il y aussi une issue en aval, vers la génération suivante et dont la dette contractée à l’égard de The Long Ryders ne saurait être surestimée. Plus les années et les écoutes passent, plus il devient évident qu’il n’y aurait pas eu d’Uncle Tupelo – et donc de Wilco – ni de The Jayhawks ni de Whiskeytown sans Native Sons, chaînon indispensable dans cette continuité des traditions musicales américaines.


