
L’arrivée timide du printemps rend d’humeur baroque, forcément. Mes choix de lectures, les disques écoutés ou les films vus semblent se soumettre à un désir de papillonner. L’art de papillonner, c’est une joie que l’on crayonne, avec vivacité, sur le papier peint crasseux d’une période décidément blindée de noirceur. On est en mode Soulages depuis trop longtemps. Il est vrai que l’on peut s’habituer au sombre comme lorsque l’on doit se déplacer dans une pièce plongée de nuit et que, peu à peu, certains détails apparaissent. Détails essentiels. Mais l’obscurité charrie ses mêmes rengaines et on ressent vite le besoin de revoir la lumière et ses éternelles variations. C’est l’impression que donne la parution de l’anthologie consacrée à l’oeuvre de Willie Dunn, Creation Never Sleeps, Creation Never Dies chez Light In The Attic. Oui, c’est marcher maladroitement vers une micro-sortie lumineuse. Car tout est noir fusain chez Dunn et on se prend en pleine poire – aveuglés que nous sommes – toutes ces chansons belles à chialer des heures. Ce mec est un mystère. Ce genre de type qui n’a jamais su situer Hollywood sur la carte et donc, par ricochet, n’a aucunement connu le succès. Voix grave comme nimbée d’alcool, militantisme, art du récit et une même tonalité d’accords – le mélange est sublime. A redécouvrir absolument. Il y a presqu’un an, lorsque je bossais encore dans une librairie, Aurélien Bellanger était venu me demander du Walter Benjamin. Je ne me doutais pas qu’il était entrain de préparer une sorte de roman mélancolique sur un objet, la télé. Car Téléréalité n’est pas un récit à charge mais plutôt l’analyse subtile d’un média longtemps créateur de situations et de réalités qui influençaient fortement l’imaginaire collectif. Mais depuis, les réseaux sociaux ont déboulé. Plus forts et plus tordus. Ils nous font même croire que l’on peut parler sérieusement de littérature sur Instagram. Laissons les hashtags et autres placement de produits pour aller se perdre dans un film terrifiant. La bande-son fascinante de Va, va vierge, pour la deuxième fois impressionne autant que le grain de ce beau noir et blanc. Sur le toit d’un immeuble, une jeunesse s’essaie à ne plus regarder l’horizon. Kōji Wakamatsu filme l’ultra-violence, les viols, les discours stupéfiants – dans tous les sens du terme. C’est souvent insoutenable, c’est parfois d’une rare beauté. Car dans ce long plan séquence de pulsions, il arrive par instants la clarté de certain intermède. Et ces belles parenthèses, entre deux grands blocs d’horreurs, nous poursuivent encore après avoir vu le film. Pour tout dire, la noirceur a ses limites et on en n’a jamais trouvé à la lumière.

 Anthologie de
Anthologie de 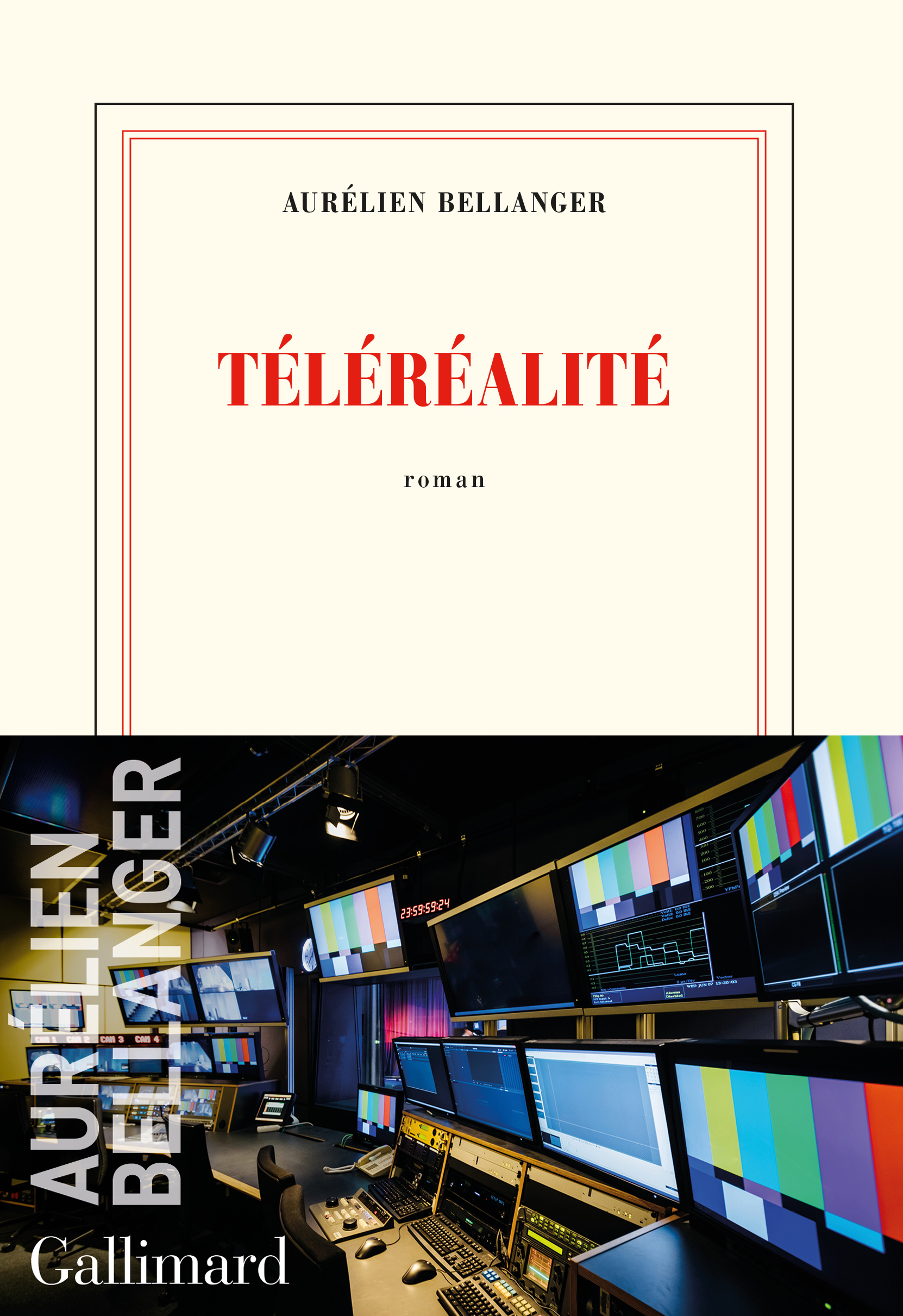
 Va, va vierge, pour la deuxième fois
Va, va vierge, pour la deuxième fois
