 Même si c’est la stricte ou la triste vérité, il serait réducteur et malhonnête de ne voir rétrospectivement en Codeine que le groupe qui a énoncé les bases d’un genre (Slow-core ou Sad-core) qui, constituant l’acte de naissance d’un certain rock américain des années 90 à nos jours (Low, Bedhead, Red House Painters, Idaho, Spain) et même au-delà (Diabologum, Mogwai) n’a pourtant jamais ou trop rarement été reconnu à sa juste valeur.
Même si c’est la stricte ou la triste vérité, il serait réducteur et malhonnête de ne voir rétrospectivement en Codeine que le groupe qui a énoncé les bases d’un genre (Slow-core ou Sad-core) qui, constituant l’acte de naissance d’un certain rock américain des années 90 à nos jours (Low, Bedhead, Red House Painters, Idaho, Spain) et même au-delà (Diabologum, Mogwai) n’a pourtant jamais ou trop rarement été reconnu à sa juste valeur.
Cette musique, à la fois discrète et monumentale, énonçant la lenteur comme une poétique nouvelle et frigorifique à la fin du XXe siècle n’avait certes que peu de contemporains (Galaxie 500, Melvins, Slint, Bitch Magnet), une ascendance assez floue (Black Sabbath, Pink Floyd, Swans, Spacemen 3, Brian Eno sous kétamine ?) et pour seules influences revendiquées The Jesus And Mary Chain, Joy Division* ou plus étrangement encore Dusty Springfield. Aussi, et pour élargir considérablement le sujet, on ne fut que très peu surpris, lors de conversations récentes avec deux pontes du Drone Metal (Dylan Carlson de Earth et Stephen O’Malley de Sunn O))), pour ne pas les nommer) d’entendre que le trio originaire de New York, faisait également partie de leur catéchisme avoué.

Or le nom de Codeine n’est plus si familier, régulièrement passé sous silence dans la genèse du Post-Rock alors qu’il en définit une préhistoire fondamentale pour ne pas dire, sa pierre de rosette**. Cette injustice devrait être réparée avec la parution de cette intégrale d’un très haut niveau artistique et esthétique, doublée comme il se doit d’une reformation temporaire, disponible via un superbe coffret pour complétistes chevronnés (6 vinyles, 6 Cd) ou sous la forme des trois albums originaux en double CD, agrémentés d’inédits (Live, Singles, Peel sessions, tous d’une qualité bouleversante) qui doubleront pour la postérité le volume des enregistrements moyennement disponibles jusqu’alors, du groupe, autant dire un rêve de fan.
Encore aujourd’hui on imagine mal la formidable isolation, voire une forme assez marquée d’autisme ayant présidé à l’élaboration de ces chansons ( ?), ces rythmes ralentis comme des cascades figées par le gel, ces lignes de basses tendues comme des câbles de téléphériques à l’agonie, et ces vaines et pourtant prégnantes mélodies qu’on ne laisse qu’à la guitare, qui suit à peine ou peine à suivre cette intenable tension émotive que la rythmique impose en plein sommeil, comme une crise de nerfs au ralenti. C’est dire si les disques de Codeine paraissent joyeux et plein d’entrain dans une époque (la nôtre), qui a vu le chant choral festif érigé en nouvelle valeur de l’Indie-rock, et si leur force de persuasion n’a rien perdu de leur immensité contradictoire, bien au contraire. Alors qu’elle paraît comme l’indigne bande sonore de la dépression et de l’intranquilité la plus totale, elle est pourtant d’une dynamique lente, absolue et incroyable, comme un coup de massue sans fin déposé délicatement sur tous les maux du siècle, et de tous ceux à venir, si toutefois on en sort vivants.
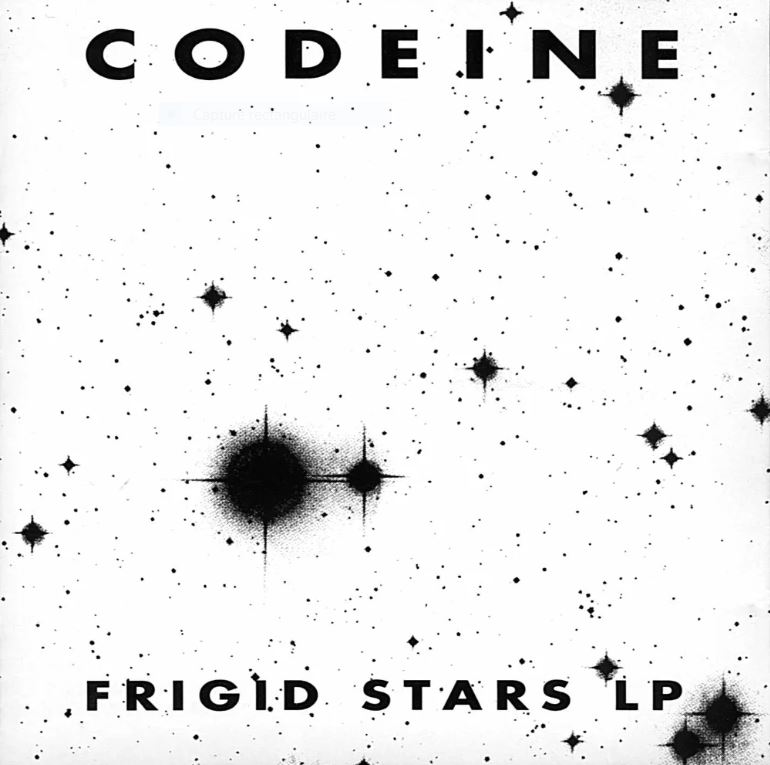 Le premier album Frigid Stars paraît d’abord chez les Allemands de Glitterhouse, en Aout 1990 puis ressort chez Sub Pop (dont le groupe restera l’une des signatures les plus foncièrement atypiques) au printemps 91, soit quelques mois seulement après Spiderland de Slint (Mars 91) qui n’aura de cesse de lui voler depuis le trophée de chef d’œuvre originel du Post-Rock. Pourtant les deux disques se valent, à la fois complémentaires dans leur gestion de la tension, et différenciables dans ce même domaine, soit dit simplement, deux méthodes sidérurgiques pas fondamentalement opposées. Mais Codeine est probablement déjà plus éloigné des scories du Hardcore, proposant une musique pleine et profonde, presque pop et même, dans une forme pervertie, encore dans le schéma de la chanson, avec le chant nasal et décidé du bassiste Stephen Immerwhar***, comme si Neil Young ou un très jeune adolescent n’ayant pas encore vraiment mué, s’essayait à reproduire naïvement la diction de Ian Curtis pour s’endormir en se masturbant. Mais c’est surtout cette lenteur, cette sensation de dérive monolithique qui impressionne, sur un morceau comme Pick Up Song en mode Country laconique, 3 Angels en progression négative ou encore Gravel Bed ou Second Chance sur lesquels on croit même entendre du Sunn O)) passé en quarante-cinq tours; même si le ton se fait plus recueilli sur Pea, presque une ballade folk atypique et minimaliste reprise en son temps par Michel Cloup au sein de Diabologum, et dont les paroles « When I see the sun, I hope it shines on me, and gives me everything…well, almost. » donnent un juste titre à ce coffret. Et probablement aussi, la profondeur de la dépression et de la tristesse du renoncement qui se dégage de ces titres, une position rarement aussi magnifiquement revendiquée depuis Nick Drake. À l’aube de nos vingt ans, on en restera définitivement étourdi.
Le premier album Frigid Stars paraît d’abord chez les Allemands de Glitterhouse, en Aout 1990 puis ressort chez Sub Pop (dont le groupe restera l’une des signatures les plus foncièrement atypiques) au printemps 91, soit quelques mois seulement après Spiderland de Slint (Mars 91) qui n’aura de cesse de lui voler depuis le trophée de chef d’œuvre originel du Post-Rock. Pourtant les deux disques se valent, à la fois complémentaires dans leur gestion de la tension, et différenciables dans ce même domaine, soit dit simplement, deux méthodes sidérurgiques pas fondamentalement opposées. Mais Codeine est probablement déjà plus éloigné des scories du Hardcore, proposant une musique pleine et profonde, presque pop et même, dans une forme pervertie, encore dans le schéma de la chanson, avec le chant nasal et décidé du bassiste Stephen Immerwhar***, comme si Neil Young ou un très jeune adolescent n’ayant pas encore vraiment mué, s’essayait à reproduire naïvement la diction de Ian Curtis pour s’endormir en se masturbant. Mais c’est surtout cette lenteur, cette sensation de dérive monolithique qui impressionne, sur un morceau comme Pick Up Song en mode Country laconique, 3 Angels en progression négative ou encore Gravel Bed ou Second Chance sur lesquels on croit même entendre du Sunn O)) passé en quarante-cinq tours; même si le ton se fait plus recueilli sur Pea, presque une ballade folk atypique et minimaliste reprise en son temps par Michel Cloup au sein de Diabologum, et dont les paroles « When I see the sun, I hope it shines on me, and gives me everything…well, almost. » donnent un juste titre à ce coffret. Et probablement aussi, la profondeur de la dépression et de la tristesse du renoncement qui se dégage de ces titres, une position rarement aussi magnifiquement revendiquée depuis Nick Drake. À l’aube de nos vingt ans, on en restera définitivement étourdi.
 Le mini album Barely Real (1992) ne comporte que six morceaux, c’est dire la productivité aliénante dont on fait montre ici, mais chaque note, chaque humeur semble avoir été longuement ajustée, pensée et pesée, confirmant le groupe au panthéon d’un style qui commence tout juste à faire école, celle dite du Quiet/Loud-calme/vacarme sur laquellle des formations comme Mogwai ou Godspeed YBE! bâtiront des carrières entières. On remarquera peut être un peu plus de finesse, notamment dans la précision fragmentaire du jeu de guitare de John Engle, sur Realize, Jr (probablement leur meilleur morceau) ainsi que le travail percussif intense et concentré de Chris Brokaw à la batterie sur Promise Of Love. Brokaw, qui sera d’ailleurs le seul membre de Codeine à faire carrière, quittant alors le groupe pour rejoindre Thalia Zedek au sein de Come, puis en solo ou au sein de The New Year (liste non-exhaustive).
Le mini album Barely Real (1992) ne comporte que six morceaux, c’est dire la productivité aliénante dont on fait montre ici, mais chaque note, chaque humeur semble avoir été longuement ajustée, pensée et pesée, confirmant le groupe au panthéon d’un style qui commence tout juste à faire école, celle dite du Quiet/Loud-calme/vacarme sur laquellle des formations comme Mogwai ou Godspeed YBE! bâtiront des carrières entières. On remarquera peut être un peu plus de finesse, notamment dans la précision fragmentaire du jeu de guitare de John Engle, sur Realize, Jr (probablement leur meilleur morceau) ainsi que le travail percussif intense et concentré de Chris Brokaw à la batterie sur Promise Of Love. Brokaw, qui sera d’ailleurs le seul membre de Codeine à faire carrière, quittant alors le groupe pour rejoindre Thalia Zedek au sein de Come, puis en solo ou au sein de The New Year (liste non-exhaustive).
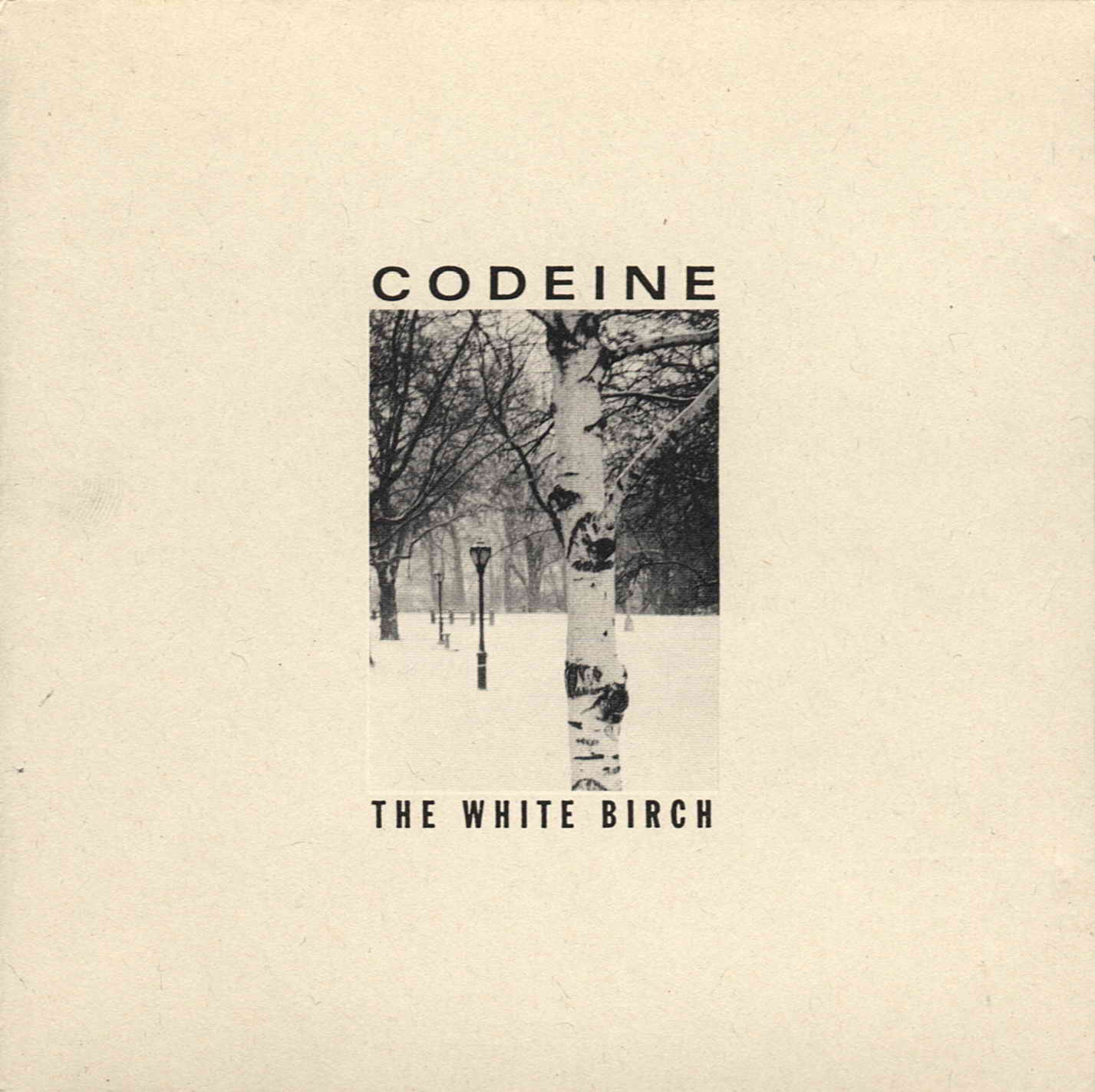 Du reste, l’histoire pourrait s’arrêter là, mais Engle et Immerwhar vont tout de même dénicher un remplaçant de choix en la personne de Douglas Scharin (Rex, HiM), confirmant une proximité de fait avec la scène de Louisville, Kentucky. David Grubbs (Squirrel Bait, groupe dont naquit Slint, Bastro, ledit futur Gastr Del Sol en compagnie de Jim O’Rourke) déjà présent sur Barely Real vient parfois se greffer au trio pour un troisième album de haute volée et que certains considèrent à juste titre comme leur chef d’œuvre définitif, The White Birch (1994). De l’implacable Sea, où flotte « un vaisseau blanc sur une mer noire », possible définition d’un groupe définitivement singulier, à Smoking Room en passant par Tom (dont on se réjouira d’entendre une version « rapide » dans les bonus, autant dire que la croisière s’amuse à son niveau), le groupe est en effet au sommet de son art. Et comme seul le silence pouvait succéder à pareil effort de guerre, quittera donc la scène sur ses entrefaits, et ne donnera pas suite. Incompris, seul au monde et vraisemblablement épuisé de se contenter d’un succès d’estime qui va se transformer au fil du temps en un culte de renom.
Du reste, l’histoire pourrait s’arrêter là, mais Engle et Immerwhar vont tout de même dénicher un remplaçant de choix en la personne de Douglas Scharin (Rex, HiM), confirmant une proximité de fait avec la scène de Louisville, Kentucky. David Grubbs (Squirrel Bait, groupe dont naquit Slint, Bastro, ledit futur Gastr Del Sol en compagnie de Jim O’Rourke) déjà présent sur Barely Real vient parfois se greffer au trio pour un troisième album de haute volée et que certains considèrent à juste titre comme leur chef d’œuvre définitif, The White Birch (1994). De l’implacable Sea, où flotte « un vaisseau blanc sur une mer noire », possible définition d’un groupe définitivement singulier, à Smoking Room en passant par Tom (dont on se réjouira d’entendre une version « rapide » dans les bonus, autant dire que la croisière s’amuse à son niveau), le groupe est en effet au sommet de son art. Et comme seul le silence pouvait succéder à pareil effort de guerre, quittera donc la scène sur ses entrefaits, et ne donnera pas suite. Incompris, seul au monde et vraisemblablement épuisé de se contenter d’un succès d’estime qui va se transformer au fil du temps en un culte de renom.
On entendra encore, en guise de juste épitaphe, une cover habitée d’Atmosphere de Joy Division sur la compilation A Means To An End (1995), manière de boucler la boucle et de préciser son implication dans la très grande histoire des musiques souffrantes. Ne dit-on pas d’ailleurs que la codeine, l’un des rares opiacé encore disponible sans ordonnance, et détournée de son usage, peut parvenir à guérir temporairement la dépression en plongeant le sujet dans un état de grand calme ?
À la fois sacerdoce, profession de foi et palais des glaces, la réinvention du Rock par Codeine est toujours d’actualité, comme un refus salutaire de l’accélération permanente et de la précipitation perverse du monde moderne. Ce qui lui confère aujourd’hui une pureté totale, et une force visionnaire, voire politique, aussi rare que précieuse.
La boxset de Codeine, When I See The Sun, est paru en 2012 chez Numero Group, date de la publication de cet article dans la RPM.
*Voire les chapitres un, deux et six dans mes mémoires (La Pléiade) **Je vous ai déjà fait le coup avec le Carnage Visors de Cure, parce que contrairement aux apparences, j’adore m’amuser ***certains noms ne s’inventent pas.


