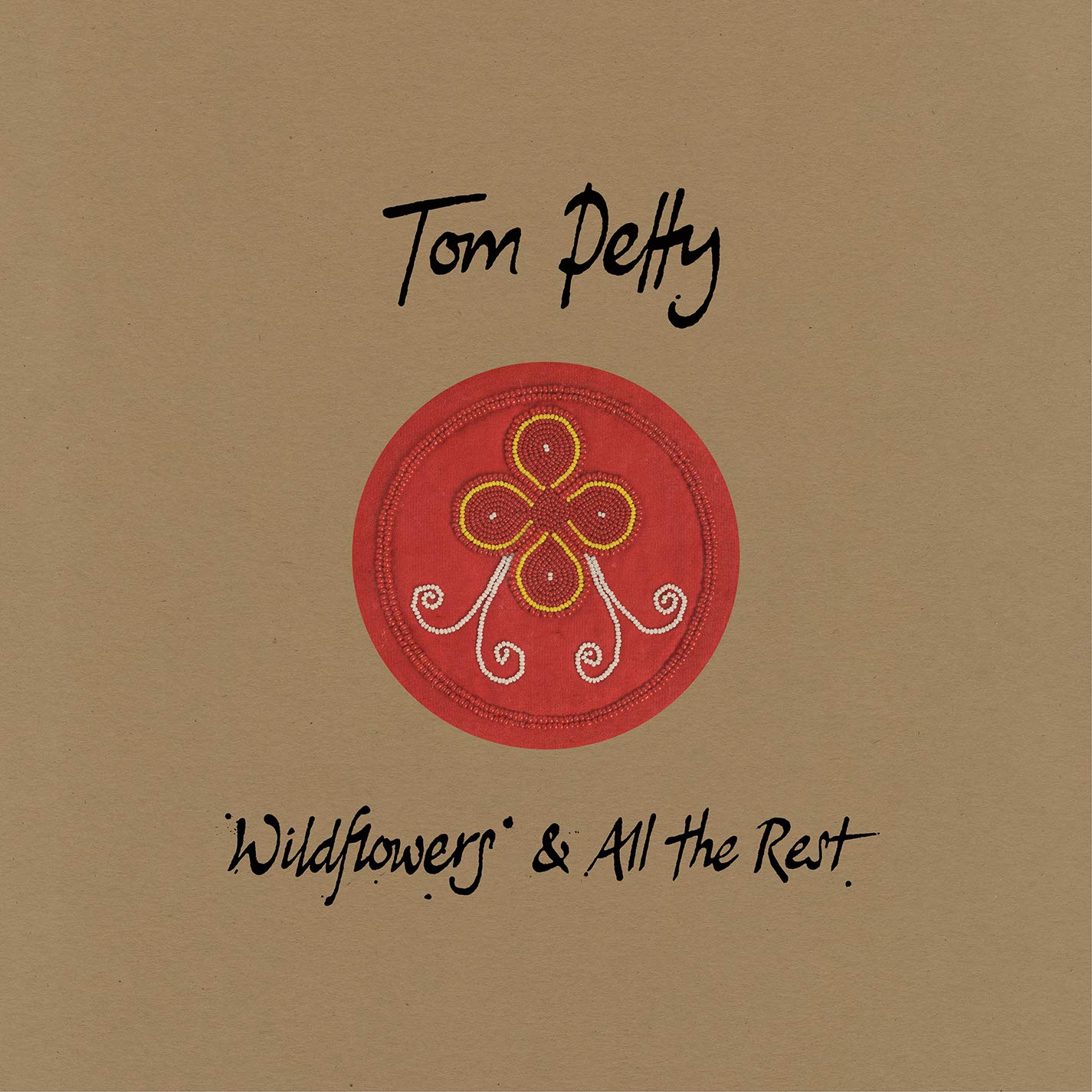 1994. Il y a deux manières – plus complémentaires que réellement contradictoires – de resituer l’instant dans l’enchainement des années. Côté adret, Tom Petty vient d’atteindre le point culminant de la trajectoire ascendante entamée dans la seconde moitié des années 1970. Pour Full Moon Fever (1989) et Into The Great Wide Open (1991), il a consenti à reléguer certains de ses compagnons d’aventure – les Heartbreakers – au second plan, pour privilégier un travail en studio plus ambitieux. Certains d’entre eux le supportent plus mal que d’autres – le pianiste Benmont Tench peu enclin à se plier à la stricte discipline taylorienne désormais instaurée pendant les enregistrements, le batteur Stan Lynch qui critique en coulisse les nouveaux penchants pop de son leader et finit par s’exclure lui-même du mouvement. Qu’importe leurs états d’âme. Les détails du générique paraissent presque secondaires tant les deux albums présentent de similarités formelles, façonnés à quatre mains par Petty et Jeff Lynne.
1994. Il y a deux manières – plus complémentaires que réellement contradictoires – de resituer l’instant dans l’enchainement des années. Côté adret, Tom Petty vient d’atteindre le point culminant de la trajectoire ascendante entamée dans la seconde moitié des années 1970. Pour Full Moon Fever (1989) et Into The Great Wide Open (1991), il a consenti à reléguer certains de ses compagnons d’aventure – les Heartbreakers – au second plan, pour privilégier un travail en studio plus ambitieux. Certains d’entre eux le supportent plus mal que d’autres – le pianiste Benmont Tench peu enclin à se plier à la stricte discipline taylorienne désormais instaurée pendant les enregistrements, le batteur Stan Lynch qui critique en coulisse les nouveaux penchants pop de son leader et finit par s’exclure lui-même du mouvement. Qu’importe leurs états d’âme. Les détails du générique paraissent presque secondaires tant les deux albums présentent de similarités formelles, façonnés à quatre mains par Petty et Jeff Lynne.

Bien davantage que le groupe des origines, c’est ce dernier qui contribue à façonner un mélange stylistique presque incongru mais très efficace entre le raffinement ultra-précis d’Electric Light Orchestra et la rusticité traditionnelle revendiquée depuis toujours par le natif de Gainesville. Le cocktail plait, c’est peu dire. Les tubes s’enchaînent sans pour autant altérer le crédit dont leur auteur a toujours bénéficié auprès de la critique. Comme Springsteen dix ans plus tôt, Petty devient une sorte d’institution américaine, à la fois populaire et authentique. C’est le temps des tournées massives et des clips à rallonge – plus de sept minutes dans la version intégrale de Into The Great Wide Open diffusée en boucle sur MTV – où Johnny Depp et Faye Dunaway consentent à incarner les personnages d’Eddie Rebel et de sa manageuse sous la direction de Julien Temple. De ce point de vue, la publication trois ans plus tard de Wildflowers, un album – presque double – aux tendances presque ascétiques, dépourvu de tous les artifices étincelants de ses deux prédécesseurs ne peut que surprendre et constitue incontestablement une fracture importante.
L’histoire est pourtant double et c’est sans doute sur le versant le moins éclairé que se trouvent les principaux éléments qui permettent d’inscrire Wildflowers dans une forme de continuité. Côté ubac, Petty n’a eu de cesse, en effet, de cheminer à rebrousse-temps. Considéré à leurs débuts – en tous cas aux USA – comme les représentants de cette Nouvelle Vague musicale assimilée aux soubresauts du punk, les Heartbreakers et leur leader ont progressivement dissipé tous les malentendus en assumant avec de moins en moins de fard un classicisme formel. Cette valorisation librement consentie des traditions choisies les a poussés à cultiver et approfondir au fil des ans leurs relations fraternelles ou filiales avec leurs maîtres reconnus dans une forme de deal amical toujours respectueux et, la plupart du temps, équilibré : la déringardisation bienveillante opérée par les plus jeunes contre la caution enthousiaste des anciens. Au début des années 1990, la check-list est de ce point de vue déjà bien fournie : succéder à The Band comme accompagnateurs de Bob Dylan, côtoyer deux anciens Beatles, repositionner sur le devant de la scène Roy Orbison en fin de vie… Entre la réhabilitation de Roger McGuinn – Back From Rio (1991) – et celle, à venir, de Johnny Cash, l’étape Wildflowers s’intercale de manière plutôt limpide. D’un vétéran à l’autre, Petty remonte jusqu’aux sources de sa passion musicale. De ce point de vue, ce deuxième album en nom propre apparaît comme une forme d’apothéose bien davantage qu’un reniement. Séduit par Full Moon Fever qu’il raconte avoir écouté en boucle au moment de sa sortie, Rick Rubin se charge d’une mise en sons radicalement opposée à celle de Lynne. Dans un contexte où la simplicité et la spontanéité du jeu collectif sont à nouveau à l’ordre du jour, les Heartbreakers excellent, y compris le nouveaux venu – le batteur Steve Ferrone. En témoigne, par exemple, ce Honey Bee mémorable où des quadragénaires renouent enfin avec le plaisir communicatif qu’ils pouvaient éprouver à seize ans dans leur garage en scandant sans crainte du ridicule un hymne rock aussi bêta que réjouissant.

Dès sa sortie, Wildflowers est salué à sa juste mesure. Une fois n’est pas coutume, la réédition automnale et considérablement augmentée ne se contente pas de confirmer un diagnostic consensuel et solidement établi. A côté des points de passage obligés qui ponctuent comme d’habitude la visite commémorative de ce genre de mausolée – démos inédites et plutôt intéressantes qui témoignent, une fois encore, de la précision de l’écriture de Petty dès les premiers brouillons ; versions live moins indispensables – figurent en effet une série de dix chansons – dont la moitié étaient demeurées complètement inédites – qui s’ajoutent au quatorze d’origine et reconstituent Wildflowers, l’album favori de son auteur et, souvent, de ses fans dans la version copieuse et intégrale qui aurait toujours dû être la sienne. Bien loin des fonds de tiroirs et autres rebus d’archives, chacune de ces chansons supplémentaires complète harmonieusement un tableau pourtant déjà très réussi et témoigne de la richesse foisonnante de l’inspiration d’un songwriter au sommet de son art. La mélodie étincelante de Leave Virginia Alone, les accents délicieusement mélancoliques de Confusion Wheel, l’acoustique spartiate de Climb That Hill Blues : rien ne méritait ici d’être éliminé. Harry Green, récit déchirant d’un suicide annoncé apparaît ainsi comme l’une des meilleures ballades jamais signées par son auteur, pourtant prolixe. Comme souvent chez Petty, l’écriture associe un sens très précis du détail concret, parfois trivial et une forme d’association libre, d’enchainement un peu décousu entre les épisodes qui laisse toujours une place importante à l’imagination. On croyait connaître un chef d’œuvre par cœur ; on se retrouve avec un chef d’œuvre encore plus considérable et dont on découvre une moitié avec l’émerveillement non feint des premières fois.


