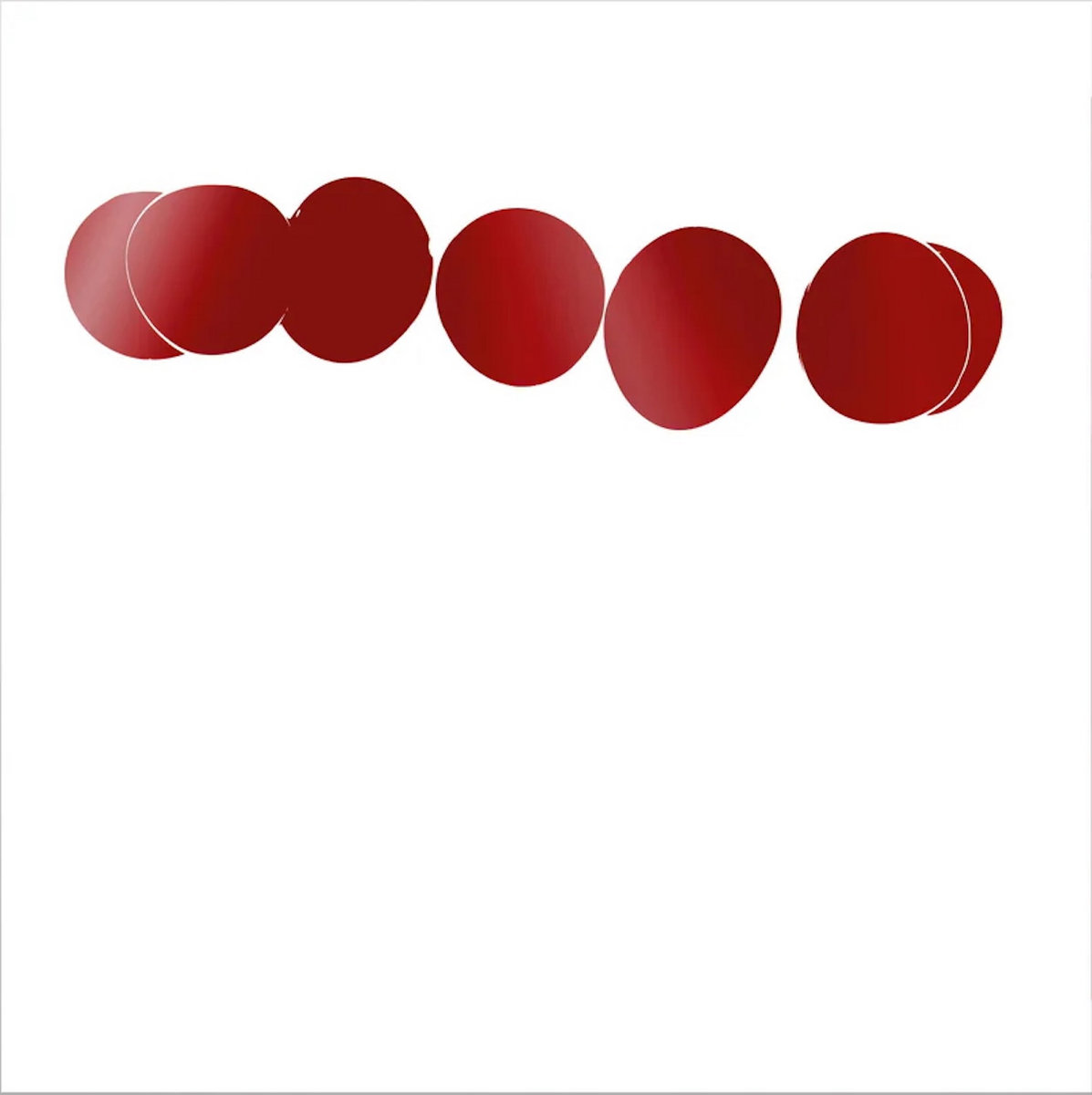 Pour une fois, l’ampleur presque démesurée de l’hommage vaut à elle seule d’être saluée. Il n’est pas certain que Astronauts (1991) soit le meilleur album de The Lilac Time – ni même le jalon majeur de la première partie de l’existence du groupe, celle qui s’est déroulée entre 1987 et 1991, avant une parenthèse solo longue de huit ans. Pourtant, Pete Paphides a fait fi de ces réserves éventuelles pour consacrer à ce quatrième volume des longues aventures de Stephen Duffy un mausolée digne des plus grand chefs d’œuvre sur son label Needle Mythology : trois volumes, pas moins, contenant une version remasterisée de l’album original, une large ration de démos et une autre d’enregistrements live datant de la même période. Un écrin dispendieux, dont l’architecte assume – revendique même : il faut lire le texte remarquable récemment publié par Paphides sur Medium à propos de ce projet – l’irrationalité des dimensions, érigé par pure passion pour ces chansons et pour se hausser à la hauteur du souvenir qu’en conservent les quelques amoureux, convaincus de leur importance. Trente-trois ans plus tard, Astronauts apparaît encore comme un disque de transition, d’entre-deux. Résolument à côté de son époque, de son label – Creation, donc – et même de son auteur qui, dans plusieurs interviews données au printemps 1991, étale publiquement ses insatisfactions et ses envies de tout abandonner, y compris cet album qu’il envisage d’avorter avant même sa publication.
Pour une fois, l’ampleur presque démesurée de l’hommage vaut à elle seule d’être saluée. Il n’est pas certain que Astronauts (1991) soit le meilleur album de The Lilac Time – ni même le jalon majeur de la première partie de l’existence du groupe, celle qui s’est déroulée entre 1987 et 1991, avant une parenthèse solo longue de huit ans. Pourtant, Pete Paphides a fait fi de ces réserves éventuelles pour consacrer à ce quatrième volume des longues aventures de Stephen Duffy un mausolée digne des plus grand chefs d’œuvre sur son label Needle Mythology : trois volumes, pas moins, contenant une version remasterisée de l’album original, une large ration de démos et une autre d’enregistrements live datant de la même période. Un écrin dispendieux, dont l’architecte assume – revendique même : il faut lire le texte remarquable récemment publié par Paphides sur Medium à propos de ce projet – l’irrationalité des dimensions, érigé par pure passion pour ces chansons et pour se hausser à la hauteur du souvenir qu’en conservent les quelques amoureux, convaincus de leur importance. Trente-trois ans plus tard, Astronauts apparaît encore comme un disque de transition, d’entre-deux. Résolument à côté de son époque, de son label – Creation, donc – et même de son auteur qui, dans plusieurs interviews données au printemps 1991, étale publiquement ses insatisfactions et ses envies de tout abandonner, y compris cet album qu’il envisage d’avorter avant même sa publication.

Davantage encore que d’autres œuvres de The Lilac Time, Astronauts conserve en lui les traces d’un projet initial très clair et des combats inaboutis pour l’inscrire dans une réalité hostile. L’anecdote fondatrice a souvent été évoquée : elle raconte comment, au milieu des années 1980, l’apprenti popstar de Birmingham fait l’expérience d’une révélation alors qu’il se trouve en Jamaïque. Alors qu’il se recueille – ou qu’il digère un cachet d’ecstasy, ou les deux – sur la tombe de Noel Coward, Stephen Duffy écoute River Man de Nick Drake. Au troisième couplet, la messe est dite : « Gonna see the river man / Gonna tell him all I can / About The Plan / For lilac time ». L’éphémère chanteur de Duran Duran abandonne alors la gloriole pop de ses débuts et les plateaux de Top Of The Pops pour se consacrer, en compagnie de son frère Nick, à l’approfondissement de ses souvenirs d’enfance et de ses premières émotions musicales : l’écoute de The White Album des Beatles (1968) en famille, les bouleversements fondateurs produits par la découverte des disques de Tyrannosaurus Rex ou d’Incredible String Band. L’avenir se niche dans la mémoire de ce passé, il en est convaincu. Et dans les formes musicales de la tradition folk, à condition de se les approprier le plus librement possible. Le projet est clair, le combat commence. La succession des premiers rounds est semblable à beaucoup d’autres, presque trop prévisible : un premier album sur un label indépendant – Swordfish – qui engendre un succès d’estime mérité et permet au groupe d’intégrer une plus grosse écurie – Fontana. Un deuxième pour amorcer la reconnaissance et même entrouvrir les portes du marché américain – Paradise Circus (1989). Puis les tournées qui épuisent les corps et attisent les tensions et, dans la foulée, un troisième album qu’on abandonne, par nécessité ou par paresse, aux pattes un peu lourdes de producteurs zélés – Andy Partridge et John Leckie. A force de chercher les compromis qui permettent de contenter un peu tout le monde, & Love For All (1990) ne plait complètement à personne : ni à son auteur qui n’y retrouve plus ses chansons qu’il juge dénaturées, ni au public, ni au label qui constate, dépité, que l’album plafonne dans les tréfonds des charts.

La nouvelle décennie commence donc tristement pour Stephen Duffy : sa maison de disques le lâche et son frère quitte le groupe. Seule l’inspiration, heureusement, demeure intacte. De retour dans sa maison de Malvern, au beau milieu de la campagne du Worcestershire où il panse ses plaies, Duffy compose quelques-unes de ses œuvres les plus mélancoliques. Il y est question, comme d’habitude, de haies et de bicoques, de sentiers ruraux embrumés dont surgissent, comme des spectres, des figures féminines imaginaires ou fantasmées. Un nouveau guitariste – Sagat Guitrey – est même recruté pour remplacer le frangin démissionnaire. Il apporte à ces nouveaux morceaux des touches de jazz que l’on entend ça et là, dans la partie finale de In Inverna Gardens et surtout sur le volume consacré aux interprétations d’anciens titres. Alan McGee se propose même pour renflouer le songwriter en détresse et publier sur Creation l’album en gestation. Nouvelle piste prometteuse et nouveau malentendu. Il s’intitule, en l’occurrence, Dreaming – ce pas de côté dans la modernité électronique, cette glissade pas complètement contrôlée et impulsée par Alan McGee, suivant une de ces bonnes intentions dont les routes vers l’enfer sont pavées : pourquoi ne pas reproduire avec The Lilac Time la formule encore fraîche du succès de Screamadelica (1991) en confiant le traitement de ces chansons aux bons soins d’une bande de remixeurs – Hypnotone en l’occurrence, déjà signé sur Creation ?
Après tout, comme le confesse McGee avec une candeur encore désarmante dans les témoignages passionnants qui accompagnent cette réédition, les compositions de Duffy ne sont pas plus mauvaises que celles de Bobby Gillespie : elles résisteront à tous les maquillages. Dans les discussions préalables, la possibilité est même évoquée d’hybrider ainsi l’intégralité de l’album. Ou au moins la moitié. Duffy consent du bout des lèvres, puis négocie, renâcle, au point d’envisager de saborder tout le bébé avec l’eau du bain. Seul un titre finit donc par subsister. Pas une réussite intégrale dans un contexte avec lequel il détonne plus ostensiblement, sans doute, mais pas non plus ce furoncle disgracieux auquel certains critiques l’ont assimilé à chaud. Simplement la trace d’une tentation, d’une bifurcation possible et, rétrospectivement, l’annonce de ces mélanges que l’on retrouvera bien plus tard sur Intensive Care (2005), cet autre mi-cuit à la fois fascinant et frustrant issu de la collaboration entre Duffy et Robbie Williams. Sous les oripeaux plaqués de l’electro, on passe à côté de l’essentiel. Ces deux citations explicites qui ne sont pas des samples. Plutôt des références à des univers pas encore consacrés, classiques avant l’invention du classic rock – en 1991, l’étiquette n’existe pas encore pour désigner la musique de vieux : ces trois accords plaqués directement empruntés au Free Man In Paris de Joni Mitchell qui parcourent Dreaming – et In Inverna Gardens – et cette bribe de mélodie vocale respectueusement dérobée à Suite : Judy Blue Eyes de Crosby, Stills & Nash. Une bonne partie de ce que l’on apprendra à aimer ensuite est déjà présent ici, en filigrane, sans que l’on en soit conscient.
Un peu éclipsé par ce single bien peu représentatif, tout le reste d’Astronauts brille pourtant d’un éclat incontestable, que les décennies ont même contribué à rendre encore plus manifeste. Le contraste entre les moments d’euphorie amoureuse – A Taste Of Honey, ou The Whisper Of Your Mind, tube absolu – et les ruminations méditatives des rêves déjà brisés – The Darkness Of Her Eyes ou Madersfield superbe chant funèbre où l’on ne peut s’empêcher d’entendre l’annonce de la disparition du groupe – y est particulièrement saisissant. Entre le chaud et le froid, l’écriture sert de trait d’union, portée par des mélodies toujours très inspirées et un sens parfait de l’imagerie poétique naturaliste. Ces miniatures gracieusement esquissées à l’aquarelle ne pouvaient sans doute passer qu’inaperçues au beau milieu des néons musicaux criards de son époque. Miraculeusement restaurées, elles méritent aujourd’hui un détour de plus. Et même davantage.


