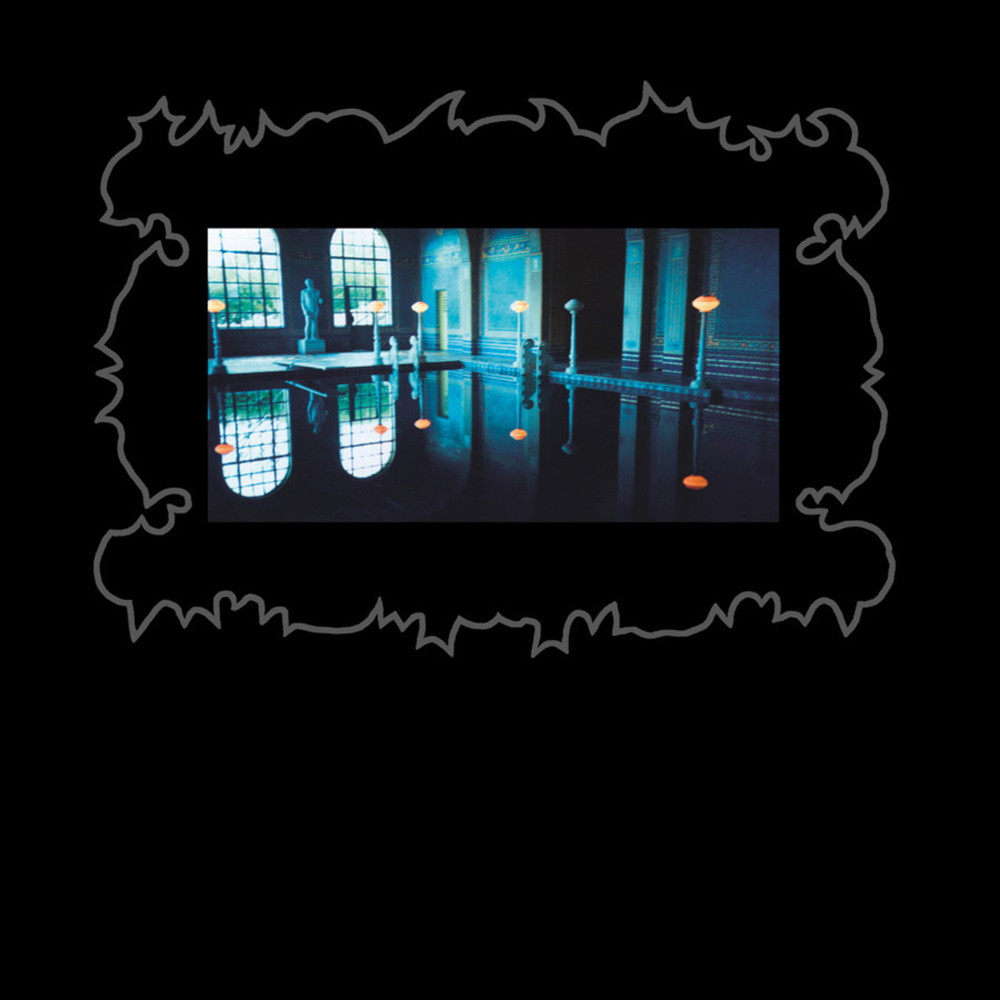
Comment s’y remet-on ? Comment reprendre la main quand on nous a bien fait comprendre qu’on avait fait mieux que les autres ? Qu’on avait potentiellement et absolument tout dit.
Ça n’a pas du être simple d’être Brian McMahan après 1991, après la dissolution de son groupe, Slint, et la sortie (posthume donc) de Spiderland, disque immense sur lequel j’ai à peu près tout dit ici. La légende voudrait qu’avant même la fin de l’enregistrement McMahan soit parti, on l’a dit pudiquement, « en maison de repos ». Puis ait repris soit ses études, soit une vie « normale ». C’est impossible. Alpagué par son vieux compère Will Oldham, il commencera par s’y remettre dans la première formation des Palace, faux frères mais vrais amis. Pas forcement le pied à l’étrier mais un peu poussé au derche par le succès persistant de son grand œuvre et la suggestion, suite à l’édition d’un faux nouvel Ep de Slint (les deux morceaux datent en fait d’avant l’enregistrement de Tweez, premier album lui aussi récemment réédité de la formation de Louisville, Kentucky) par Touch And Go, de donner suite, il reprend contact avec les autres. Mais ça ne pourra jamais s’appeler Slint, ce sera donc The For Carnation (parfois sans The, parfois sans eux), qui sort finalement un premier Ep, Fight Songs, en 1995 chez Matador. David Pajo a ramené du soutien — vu qu’il est à l’époque guitariste chez Tortoise — John McEntire, Bundy K Brown et John Herndon sont de la partie. Comme on est amateur à un degré psychiatrique on ne critiquera pas, on ne comprendra pas tout, mais on sera absolument ravi. Le mini-album Marshmallows (1996) nous fera un peu le même effet et les deux sont regroupés par la suite sur la compilation Promised Works. Il faudra donc attendre le tournant du millénaire pour que l’entité change en partie son escadrille, même si John McEntire reste à la production et Britt Walford fera trembler les fûts sur un seul morceau (mais ça suffit amplement) et sorte enfin un véritable premier album. On peine à penser qu’icelui, sans titre, soit d’une part sorti avant le 11 septembre de l’année suivante et ait été enregistré à Los Angeles, tant le souffle glacial de l’incertitude, du doute, de la douleur et d’un certain confort dans la dépression, nous figent toujours comme des gisants, 25 ans après.
Il faut dire que le silence est à la mode, Mark Hollis vient de mettre fin à sa musique mais ça on ne le sait pas encore ; et les souffles glaciaires (Labradford) ou bien très bien ourlés (Tortoise) de ce qu’on appelle alors le post rock mettent le binaire comme en apnée. Même Massive Attack opère un virement très net des musiques noires (dub, soul et tutti quanti) vers une musique noirâtre qui doit tout aux glaciations de l’after punk avec l’impressionnant Mezzanine paru deux ans avant. C’est donc dans une plaine morose mais sacrément inspirante que Brian McMahan va véritablement refaire (si peu) parler de lui.
Court de seulement six plages dont la plus courte dépasse les cinq minutes et la plus longue atteint presque les dix, cet album sans titre s’inscrit lui aussi dans ces grands disques de l’immensité silencieuse. Ce sera son Rock Bottom mais contrairement à Robert Wyatt, ce sera quasiment* sa dernière apparition sur bande. Quarante-quatre minutes, une demi cassette à l’heure où les cd se gavent au-delà de l’heure prévue. L’heure de l’avènement des médiocres et du remplissage.
Mais quel disque alors hein. Pas le genre qui s’écoute d’une oreille distraite, en faisant autre chose ou même en présence d’un tiers. On n’est pas bien comme ça, dans l’obscurité, avec quelques volumes de Pessoa sur la table de nuit et un shilom de benzodiazépine à portée de main ? Si.
Et un quart de siècle plus tard, c’est bien pratique, rien n’a changé.
Emp Man’s Blues c’est rien que deux notes d’orgue du temple à l’origine, puis cette ligne de basse, quatre notes peu ou prou, Jah Wobble en sandales dans la neige (ça n’était pas prévu, cette neige), il gèle en Enfer. Vient l’un des meilleurs sons de guitares jamais couché sur bande, tenu tendu, la vérité. Puis arrivent les cordes. Pas celles de Will Malone pour U.N.K.L.E., pas celles d’Alpha**, pas de chichis précieux. Des strates, des phalènes, des engelures aux doigts. Et là-dessus McMahan nous colle une litanie d’homme brisé qui reprend le dessus. De type : je reviens dans la cité mais nous n’existons plus. Et tant mieux.
Venant de renoncer à une histoire d’amour absurde, adultère et inaboutie, j’ai écouté ce morceau en boucle. En y trouvant du réconfort, peut-être un recul consolatoire, mais aucun éclaircissement. Juste une force surnaturelle et complètement désesperée. EMP c’est pour quoi ? Empowerment ? J’imagine peut-être mal. Je m’en fous maintenant. Nous sommes restés amis.
A Tribute To fait bien une sorte de jonction entre Slint et des finesses d’avant qu’on vénère aussi et autrement (Felt, Durutti Column), transe abstraite et minimale, très marquée d’une scansion de type afro beat qu’on va trouver pas loin à l’époque chez d’autres immenses petits blancs surdoués d’Amérique***.
Being Held, abstraction qui pourrait illustrer un scène tournée au XVIIIe siècle si le cinématographe avait existé. Les rennes reviennent dans la petite localité, il neige à peine, mais tout est glacé. Le père Noël gît dans le traîneau, la gorge tranchée. On connait le coupable : Britt Walford, le vieux complice. L’architecte du rythme qui s’échine en vain. Manière de dire, on a effectivement tout dit. La violence de Slint n’était qu’une chimère. Tenter de la recréer maintenant serait complètement vain. D’ailleurs Being Held est instrumental. Et il est très bien comme ça. Let the dead bury the dead.
Snoother a quelque chose de familier, des arpèges, des humeurs, des sons mais l’humeur change, il y a une femme qui chante (Rachel Haden, That Dog, la sœur du fils de Charlie, Josh**** des gens biens, je le sais) et ça ne fait pas grand-chose et en même temps ça amène tout un monde, voire une galaxie. Son de gratte minimaliste et pas au diapason non plus, c’est immense de contrariété poétique, du coup.
Tales (live from the crypt) c’est notre héros qui prend en stop une autostoppeuse, une autre femme, donc, qui vu ses démêlés récents avec le succès interplanétaire et la drogue tient à rester incognito (Kim Deal), ils se touchent un peu sur le bas côté mais bien trop fatigués décident de rester bons amis et préfèrent aller défoncer des jeux d’arcade avant d’aller voir une rediffusion de The Keep de Michael Mann. Une fois que la raison et la créature ont eu raison des nazis, une aube inquiète apparaît. C’est assez rare dans la musique rock, d’être aussi près d’un tableau ensoleillé où tout le monde est mort récemment. Un peu d’orgue à nouveau, on n’est pourtant pas à l’église, c’est beaucoup plus important que ça. C’est une cathédrale modeste, la vraie forteresse noire.
Quelqu’un s’accorde, une seule note de guitare, puis à nouveau la basse, Peter Hook et Jah Wobble tombés dans les bras l’un de l’autre sous kétamine. C’est Moonbeams et il y en a pour 9 minutes mais ça pourrait durer infiniment. À un moment il y a quelque chose de l’ordre du solo de guitare mais c’est juste un peu de tension, le seul truc que Brian McMahan a peut être appris à dompter. Et c’est largement aussi beau que Washer, si vous savez.
Si vous saviez qu’alors The For Carnation furent annoncés en première partie de Smog au Café De La Danse (Paris XI) mais qu’ils ne vinrent jamais, vous auriez eu un aperçu de notre anxiété jubilatoire et de notre déception d’alors.
Mais Brian McMahan ne devait pas être jadis le genre de type que l’on forçait à faire ce dont il n’avait pas envie. Ce disque, un peu à contrecœur en est l’illustration glaçante, impériale, imparfaite.
Il ne reviendra sur scène que pour faire revivre l’héritage de Slint. Sans être la suite de Spiderland, st en est probablement sa plus belle épitaphe, en tout cas la seule possible. On peut respecter ça, et tout irait toujours aussi mal. C’est désormais l’Amérique. On peut tout aussi bien avoir envie de le fouetter jusqu’aux sangs de ne pas lui avoir donné de suite.
L’album éponyme de The For Carnation est sorti en avril 2000 chez Touch And Go / Domino
* Un feat chez Dntel en 2001, une apparition sur le Highway Songs de David Pajo en 2016. ** pour prendre des repères de l’époque. *** Bloodflow de Smog sur Dongs Of Sevotion, même label anglais, tu noteras. **** Josh Haden de Spain, pas le dernier pour ne presque rien dire et faire chialer tout le monde naguère.


