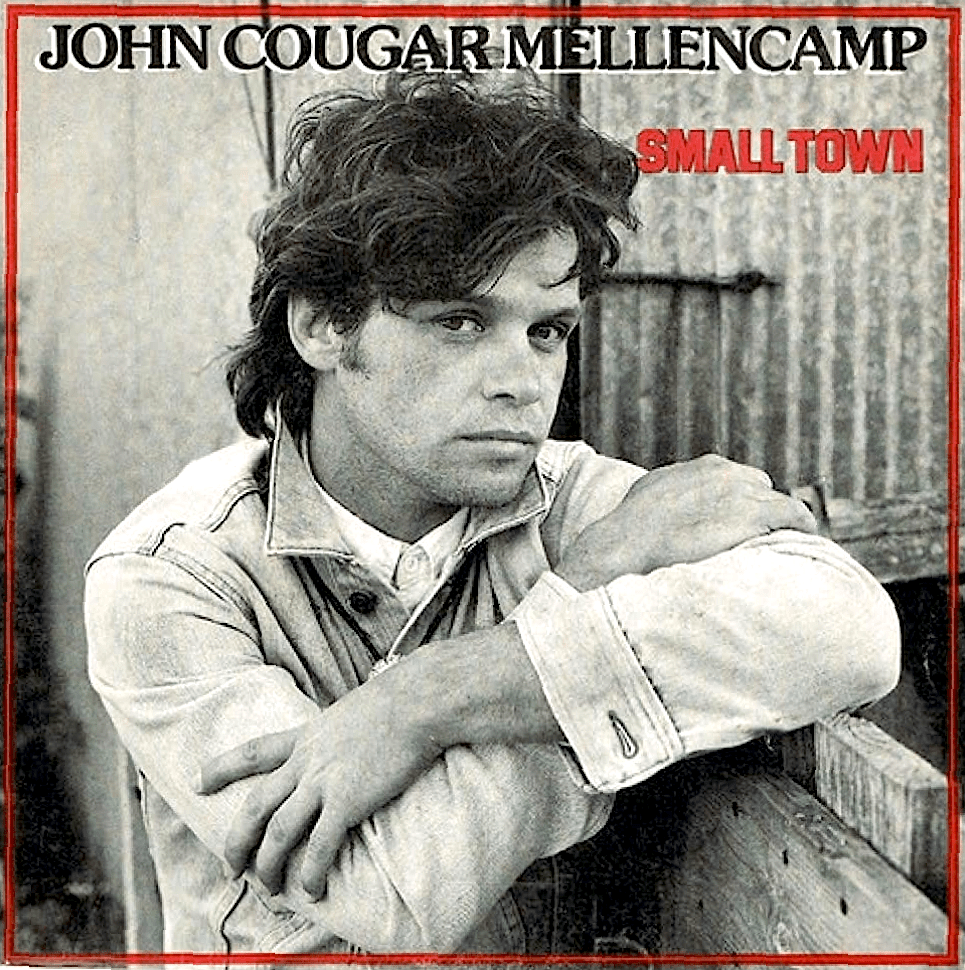
 Je ne suis pas certain que l’on puisse être réellement transformé par un groupe ou une œuvre du passé. Cela n’engage que moi, mais j’ai l’impression que les attachements les plus décisifs, ceux qui in fine marquent le plus, ne peuvent survenir qu’avec des artistes ou des groupes dont on sait qu’ils nous sont contemporains, dont on va pouvoir (et surtout devoir) attendre les prochains albums et que l’on pourra espérer voir en concert. Cela ne signifie évidemment pas que l’on ne puisse pas être touché, bouleversé même, par des œuvres du passé ; ayant traversé l’essentiel de mes années de lycée avec des disques des Beatles, de Jimi Hendrix, du Velvet Underground, de Neil Young ou de la Tamla Motown, je serais d’ailleurs bien mal placé pour soutenir une telle idée. De fait, il est tout à fait possible de connaître des chocs esthétiques majeurs via de vieux enregistrements qui chamboulent notre compréhension de la musique, mais il me semble que le rapport que l’on entretient avec eux est aussi, forcément, plus intellectuel.
Je ne suis pas certain que l’on puisse être réellement transformé par un groupe ou une œuvre du passé. Cela n’engage que moi, mais j’ai l’impression que les attachements les plus décisifs, ceux qui in fine marquent le plus, ne peuvent survenir qu’avec des artistes ou des groupes dont on sait qu’ils nous sont contemporains, dont on va pouvoir (et surtout devoir) attendre les prochains albums et que l’on pourra espérer voir en concert. Cela ne signifie évidemment pas que l’on ne puisse pas être touché, bouleversé même, par des œuvres du passé ; ayant traversé l’essentiel de mes années de lycée avec des disques des Beatles, de Jimi Hendrix, du Velvet Underground, de Neil Young ou de la Tamla Motown, je serais d’ailleurs bien mal placé pour soutenir une telle idée. De fait, il est tout à fait possible de connaître des chocs esthétiques majeurs via de vieux enregistrements qui chamboulent notre compréhension de la musique, mais il me semble que le rapport que l’on entretient avec eux est aussi, forcément, plus intellectuel.
 Selon moi, il est difficile d’éprouver un attachement profond si l’on ne se retrouve pas soi-même dans les œuvres en question, si l’on n’a pas, surtout, le sentiment qu’elles reflètent une réalité que l’on connaît ou, disons, une certaine idée d’un monde dans lequel on peut se projeter. Je crois qu’il faut que l’on puisse y trouver un écho, quelque chose qui fasse “résonance” avec notre propre personnalité. Ainsi, il y a des disques que l’on reconnaît et dont on comprend, dès les premiers instants, qu’on avait en quelque sorte “rendez-vous” avec eux. Blood on the Tracks est un album que j’ai “reconnu”. Je n’étais pas de la génération de Bob Dylan et, lorsque je l’ai découvert, vers 19 ans, j’étais même bien plus jeune que Dylan ne l’était lui-même au moment de l’enregistrement, mais je pense qu’il y avait dans ces chansons quelque chose qui m’interpellait singulièrement et qui faisait que je pouvais m’y retrouver. Pour moi, ce phénomène relevait de la “reconnaissance”, mais cela restait un lien d’ordre intellectuel et lié à l’imaginaire.
Selon moi, il est difficile d’éprouver un attachement profond si l’on ne se retrouve pas soi-même dans les œuvres en question, si l’on n’a pas, surtout, le sentiment qu’elles reflètent une réalité que l’on connaît ou, disons, une certaine idée d’un monde dans lequel on peut se projeter. Je crois qu’il faut que l’on puisse y trouver un écho, quelque chose qui fasse “résonance” avec notre propre personnalité. Ainsi, il y a des disques que l’on reconnaît et dont on comprend, dès les premiers instants, qu’on avait en quelque sorte “rendez-vous” avec eux. Blood on the Tracks est un album que j’ai “reconnu”. Je n’étais pas de la génération de Bob Dylan et, lorsque je l’ai découvert, vers 19 ans, j’étais même bien plus jeune que Dylan ne l’était lui-même au moment de l’enregistrement, mais je pense qu’il y avait dans ces chansons quelque chose qui m’interpellait singulièrement et qui faisait que je pouvais m’y retrouver. Pour moi, ce phénomène relevait de la “reconnaissance”, mais cela restait un lien d’ordre intellectuel et lié à l’imaginaire.
Bref, si je ne choisis pas un titre comme Help! des Beatles, It’s the Same Old Song des Four Tops, Higher and Higher de Jackie Wilson ou The Black Angel’s Death Song du Velvet Underground pour répondre à cette requête estivale, c’est avant tout parce que je me sens obligé de choisir plutôt un disque que j’ai vu sortir.
Rétroviseur
J’ai toujours été intéressé par le va-et-vient des œuvres dans notre mémoire personnelle. Je pense qu’on n’est évidemment pas la même personne à 15, 25, 35 ou 45 ans et qu’il est donc tout à fait logique qu’on n’écoute pas exactement les mêmes choses à ces différents âges. Pourtant, certains disques, films ou livres demeurent et s’enracinent dans notre mémoire malgré le passage du temps, l’évolution de la vie, de la culture et des goûts personnels, alors que d’autres s’éloignent, puis reviennent, ou ne reviennent jamais. Bref, je trouve que, pour peu que l’on y soit attentif, ces aléas racontent un peu de la vie qu’on a menée et de notre personnalité qui, avec les années et au fil des expériences, se révèle toujours un peu plus précisément. Aujourd’hui, arrivé à un âge charnière (la cinquantaine), je m’aperçois de plus en plus clairement que c’est au moment de l’adolescence, dans les années de collège et de lycée, que se sont tracées les grandes lignes de la cartographie mentale de ma culture musicale. Le rock, le folk, la soul, le rhythm’n’blues, le punk, la country : tout était déjà là, confusément et sous des formes plus ou moins nettes. Tout était là, mais encore fallait-il que cela se précise et s’affine.
 Dans mes jeunes années, donc, outre Prince qui était vraiment le truc dominant de l’époque (on parle quand même de son âge d’or qui va de 1982, avec 1999 – 1984, avec Purple Rain, en ce qui me concerne –, à, au moins, 1987 et Sign « O » the Times), il me semble que j’étais surtout baigné dans le funk et la soul de l’époque (pour des raisons qui avaient sans doute plus à voir avec la sociologie des lycées qu’avec la musique elle-même, je m’étais très vite détourné des groupes comme The Cure, Depeche Mode, Simple Minds et autres). Ainsi, je pourrais citer des singles comme Fresh de Kool & The Gang (novembre 1984), Nighshift des Commodores (janvier 1985) ou Word Up de Cameo (mai 1986), mais je ne crois pas avoir vraiment suivi ces groupes au-delà de ces quelques singles emblématiques. Je pense aussi à des singles marquants comme West End Girls des Pet Shop Boys (octobre 1985) ou Happy Hour des Housemartins (mai 1986), voire à des titres qui m’ont durablement marqué, mais que je n’avais pas en 45 tours, comme It’s My Life de Talk Talk (janvier 1984), Drive des Cars (juillet 1984), Forest Fire de Lloyd Cole & The Commotions (octobre 1984), Love Like Blood de Killing Joke (janvier 1985), Road to Nowhere des Talking Heads (septembre 1985) ou encore The Future’s So Bright, I Gotta Wear Shades de Timbuk 3 (été 1986), mais si je dois dégager un single significatif, un titre qui, pour moi, a pu constituer une sorte de point de basculement, c’est au 45 tours Small Town de celui qui, à l’époque, se faisait encore appeler John “Cougar” Mellencamp que je pense spontanément.
Dans mes jeunes années, donc, outre Prince qui était vraiment le truc dominant de l’époque (on parle quand même de son âge d’or qui va de 1982, avec 1999 – 1984, avec Purple Rain, en ce qui me concerne –, à, au moins, 1987 et Sign « O » the Times), il me semble que j’étais surtout baigné dans le funk et la soul de l’époque (pour des raisons qui avaient sans doute plus à voir avec la sociologie des lycées qu’avec la musique elle-même, je m’étais très vite détourné des groupes comme The Cure, Depeche Mode, Simple Minds et autres). Ainsi, je pourrais citer des singles comme Fresh de Kool & The Gang (novembre 1984), Nighshift des Commodores (janvier 1985) ou Word Up de Cameo (mai 1986), mais je ne crois pas avoir vraiment suivi ces groupes au-delà de ces quelques singles emblématiques. Je pense aussi à des singles marquants comme West End Girls des Pet Shop Boys (octobre 1985) ou Happy Hour des Housemartins (mai 1986), voire à des titres qui m’ont durablement marqué, mais que je n’avais pas en 45 tours, comme It’s My Life de Talk Talk (janvier 1984), Drive des Cars (juillet 1984), Forest Fire de Lloyd Cole & The Commotions (octobre 1984), Love Like Blood de Killing Joke (janvier 1985), Road to Nowhere des Talking Heads (septembre 1985) ou encore The Future’s So Bright, I Gotta Wear Shades de Timbuk 3 (été 1986), mais si je dois dégager un single significatif, un titre qui, pour moi, a pu constituer une sorte de point de basculement, c’est au 45 tours Small Town de celui qui, à l’époque, se faisait encore appeler John “Cougar” Mellencamp que je pense spontanément.
Second rôle américain
 L’histoire commence donc en novembre 1985. L’album Scarecrow de John Mellencamp était sorti en août, mais je ne crois pas que j’en avais entendu parler avant la parution de Small Town en 45 tours. Comment étais-je tombé sur cette chanson ? J’avoue que je ne sais plus vraiment. J’avais 14 ans, je lisais Best, j’écoutais le déroulé du Top 40 américain sur Europe 2 ou RFM (là, j’avoue que je cale) et je regardais assidument Les Enfants du Rock. Je pense donc que ma découverte de ce disque de John “Cougar” Mellencamp avait dû se jouer sur une combinaison de ces trois canaux : j’avais dû entendre la chanson dans le Top 40 (vérification faite, il était tout de même monté jusqu’à la 6e place), voir le clip dans MusiCalifornia ou sur Canal Plus (déjà à l’antenne depuis un an) et suivre l’affaire plus attentivement dans les pages de Best. Bref…
L’histoire commence donc en novembre 1985. L’album Scarecrow de John Mellencamp était sorti en août, mais je ne crois pas que j’en avais entendu parler avant la parution de Small Town en 45 tours. Comment étais-je tombé sur cette chanson ? J’avoue que je ne sais plus vraiment. J’avais 14 ans, je lisais Best, j’écoutais le déroulé du Top 40 américain sur Europe 2 ou RFM (là, j’avoue que je cale) et je regardais assidument Les Enfants du Rock. Je pense donc que ma découverte de ce disque de John “Cougar” Mellencamp avait dû se jouer sur une combinaison de ces trois canaux : j’avais dû entendre la chanson dans le Top 40 (vérification faite, il était tout de même monté jusqu’à la 6e place), voir le clip dans MusiCalifornia ou sur Canal Plus (déjà à l’antenne depuis un an) et suivre l’affaire plus attentivement dans les pages de Best. Bref…
Pour un collégien de 14 ans qui, comme moi, avait commencé à acheter des disques dans la première moitié des années quatre-vingt, Small Town était un vrai dépaysement. À Lyon, dans les grands lycées de la petite bourgeoisie locale, personne n’écoutait ça. Bien sûr, cela n’avait aucune importance, mais je crois que cela suffisait à suggérer à l’adolescent que j’étais que quelque chose de spécial devait se jouer sur ce 45 tours.
La chanson en elle-même n’avait rien de très révolutionnaire ; John Mellencamp n’a, de toute façon, jamais appartenu à la catégorie d’artistes qui changent leur époque. Lui, c’était plutôt le second couteau, l’outsider qui se fait remarquer dans un coin de l’image. Il avait bien connu quelques succès (que je découvrirais plus tard), des titres comme Hurts So Good ou Jack & Diane notamment, mais en 1985, le rock américain n’avait qu’une seule icône, un seul représentant qui engloutissait tous les autres : le Bruce Springsteen de Born in the U.S.A. À cette époque, le Boss chantait dans les stades avec un bandana sur la tête et vendait ses disques par dizaines de millions, tandis que les clips de Dancing in the Dark, I’m on Fire et Glory Days passaient en boucle sur MTV. Comme Mellencamp, il chantait la vie des gens modestes, celle des grands oubliés du reaganisme flashé, mais son succès monumental avait aussi fini par brouiller son propre discours. Ainsi, Born in the U.S.A. était devenu l’hymne favori des crétins nationalistes, ce qui contribuait à en faire l’une des chansons les plus mal comprises de son temps, et ses tirades sur les difficultés de l’Amérique des petites villes avait, dès lors, plus de mal à passer. De fait, l’auteur de Darkness on the Edge of Town était devenu une authentique star américaine : comme Michael Jackson, Diana Ross ou Ray Charles, il chantait We Are the World et était même cité en exemple par Ronald Reagan. Moins exposé, John Mellencamp semblait plus proche de cette réalité de la vie des gens modestes des petites villes des États du centre et c’était sans doute pour cette raison que Small Town semblait si juste.
 Un an plus tôt, Bruce Springsteen avait pourtant écrit une chanson de même nature. Sur Born in the U.S.A., My Hometown avait également célébré cette Amérique modeste qui travaille dur, rêve comme elle peut et n’envisage ni de migrer, ni de s’élever socialement. Finement ciselée, la chanson de Springsteen racontait les mutations de l’industrie dans les villes de moyenne envergure, la vie qui passe plus vite que ce qu’on imagine, l’enracinement passif, la transmission de certaines valeurs et, surtout, l’importance de ne jamais oublier d’où l’on vient. Dans Small Town, Mellencamp avait repris le même thème avec, à l’esprit, les petites villes de l’Indiana (Seymour et Bloomington) où il avait grandi. Martelant l’idée de cette « petite ville » idéalisée avec une insistance qui pouvait faire naître quelques doutes sur la subtilité de son propos (I was born in a small town / And I live in a small town / Probably die in a small town / Oh, those small communities), Mellencamp rendait hommage à une Amérique du hors-champ, celle dont le reaganisme triomphant avait toujours refusé de tenir compte. Par certains côtés, cette description d’un petit monde autosuffisant qui écrivait son histoire dans l’ombre sans espérer quoi que ce soit, sinon la transmission de certaines valeurs, pouvait sembler un brin réactionnaire et il est même possible qu’elle l’ait été un peu, mais dans le contexte de l’Amérique des années quatre-vingt, celle de Rambo II et Rocky IV, elle avait surtout l’air d’être tout l’inverse : Used to daydream in that small town / Another boring romantic, that’s me. Ce qui est sûr, c’est que, pour l’adolescent que j’étais, il y avait dans cette chanson quelque chose qui semblait être en prise avec le réel : la vie, telle que la racontait Mellencamp, n’avait certes rien de flamboyant, mais je dirais qu’elle était « good enough for me ». Surtout, et je crois que c’était ce qui m’avait le plus frappé à l’époque, Small Town donnait le sentiment d’embrasser toute une vie, de l’enfance à l’âge adulte, avec ses bouleversements et le défilement des années, le tout en trois minutes et quelques. Il y avait aussi l’idée d’une écriture à hauteur d’hommes, humaine et chaleureuse : No, I cannot forget where it is that I come from / I cannot forget the people who love me / Yeah, I can be myself here in this small town / And people let me be just what I want to be. Ce n’était pas forcément grand-chose, mais cela suffisait à me donner envie de me projeter.
Un an plus tôt, Bruce Springsteen avait pourtant écrit une chanson de même nature. Sur Born in the U.S.A., My Hometown avait également célébré cette Amérique modeste qui travaille dur, rêve comme elle peut et n’envisage ni de migrer, ni de s’élever socialement. Finement ciselée, la chanson de Springsteen racontait les mutations de l’industrie dans les villes de moyenne envergure, la vie qui passe plus vite que ce qu’on imagine, l’enracinement passif, la transmission de certaines valeurs et, surtout, l’importance de ne jamais oublier d’où l’on vient. Dans Small Town, Mellencamp avait repris le même thème avec, à l’esprit, les petites villes de l’Indiana (Seymour et Bloomington) où il avait grandi. Martelant l’idée de cette « petite ville » idéalisée avec une insistance qui pouvait faire naître quelques doutes sur la subtilité de son propos (I was born in a small town / And I live in a small town / Probably die in a small town / Oh, those small communities), Mellencamp rendait hommage à une Amérique du hors-champ, celle dont le reaganisme triomphant avait toujours refusé de tenir compte. Par certains côtés, cette description d’un petit monde autosuffisant qui écrivait son histoire dans l’ombre sans espérer quoi que ce soit, sinon la transmission de certaines valeurs, pouvait sembler un brin réactionnaire et il est même possible qu’elle l’ait été un peu, mais dans le contexte de l’Amérique des années quatre-vingt, celle de Rambo II et Rocky IV, elle avait surtout l’air d’être tout l’inverse : Used to daydream in that small town / Another boring romantic, that’s me. Ce qui est sûr, c’est que, pour l’adolescent que j’étais, il y avait dans cette chanson quelque chose qui semblait être en prise avec le réel : la vie, telle que la racontait Mellencamp, n’avait certes rien de flamboyant, mais je dirais qu’elle était « good enough for me ». Surtout, et je crois que c’était ce qui m’avait le plus frappé à l’époque, Small Town donnait le sentiment d’embrasser toute une vie, de l’enfance à l’âge adulte, avec ses bouleversements et le défilement des années, le tout en trois minutes et quelques. Il y avait aussi l’idée d’une écriture à hauteur d’hommes, humaine et chaleureuse : No, I cannot forget where it is that I come from / I cannot forget the people who love me / Yeah, I can be myself here in this small town / And people let me be just what I want to be. Ce n’était pas forcément grand-chose, mais cela suffisait à me donner envie de me projeter.
 Musicalement, Small Town avait un petit côté stonien. Je le réalise aujourd’hui, mais ces accords qui claquent nerveusement ressemblaient à ceux que j’apprécierais plus tard en découvrant Street Fighting Man et certains titres d’Exile on Main Street. Avec le recul, je me dis qu’alors que je l’écoutais en boucle, ramenant inlassablement le bras de la platine vers le début du microsillon, dans un exercice que seule l’adolescence permet de pratiquer avec autant d’ardeur, ce titre aura été pour moi une porte ouverte vers un monde englobant à la fois l’americana, le folk, la country et le rock américain. Dans un sens, je pense donc que je peux considérer que la découverte de Small Town m’aura aussi permis de préparer le terrain des grandes découvertes ultérieures que seront celles d’Uncle Tupelo, Wilco (celui de Being There) ou Magnolia Electric Co., mais aussi de Damien Jurado, Will Oldham, ainsi que d’autres figures plus classiques comme celles de Townes Van Zandt ou Kris Kristofferson, notamment. Et, quand je revois le clip, avec trente-sept années de recul, et que je vois défiler ces images de Super 8, je retrouve aussi une atmosphère que j’ai pu apprécier, plus tard, dans les premiers films de Gus Van Sant, comme dans le remarquable The Indian Runner de Sean Penn. Je crois qu’on parvient toujours à trouver ce qui compte vraiment ; le chemin importe peu, et le point de départ encore moins. Il y a avait sans doute beaucoup de voies à suivre pour atteindre tous ces points d’arrivée, mais pour l’adolescent que j’étais en 1985, c’était avec Small Town que cette histoire-là avait commencé.
Musicalement, Small Town avait un petit côté stonien. Je le réalise aujourd’hui, mais ces accords qui claquent nerveusement ressemblaient à ceux que j’apprécierais plus tard en découvrant Street Fighting Man et certains titres d’Exile on Main Street. Avec le recul, je me dis qu’alors que je l’écoutais en boucle, ramenant inlassablement le bras de la platine vers le début du microsillon, dans un exercice que seule l’adolescence permet de pratiquer avec autant d’ardeur, ce titre aura été pour moi une porte ouverte vers un monde englobant à la fois l’americana, le folk, la country et le rock américain. Dans un sens, je pense donc que je peux considérer que la découverte de Small Town m’aura aussi permis de préparer le terrain des grandes découvertes ultérieures que seront celles d’Uncle Tupelo, Wilco (celui de Being There) ou Magnolia Electric Co., mais aussi de Damien Jurado, Will Oldham, ainsi que d’autres figures plus classiques comme celles de Townes Van Zandt ou Kris Kristofferson, notamment. Et, quand je revois le clip, avec trente-sept années de recul, et que je vois défiler ces images de Super 8, je retrouve aussi une atmosphère que j’ai pu apprécier, plus tard, dans les premiers films de Gus Van Sant, comme dans le remarquable The Indian Runner de Sean Penn. Je crois qu’on parvient toujours à trouver ce qui compte vraiment ; le chemin importe peu, et le point de départ encore moins. Il y a avait sans doute beaucoup de voies à suivre pour atteindre tous ces points d’arrivée, mais pour l’adolescent que j’étais en 1985, c’était avec Small Town que cette histoire-là avait commencé.


