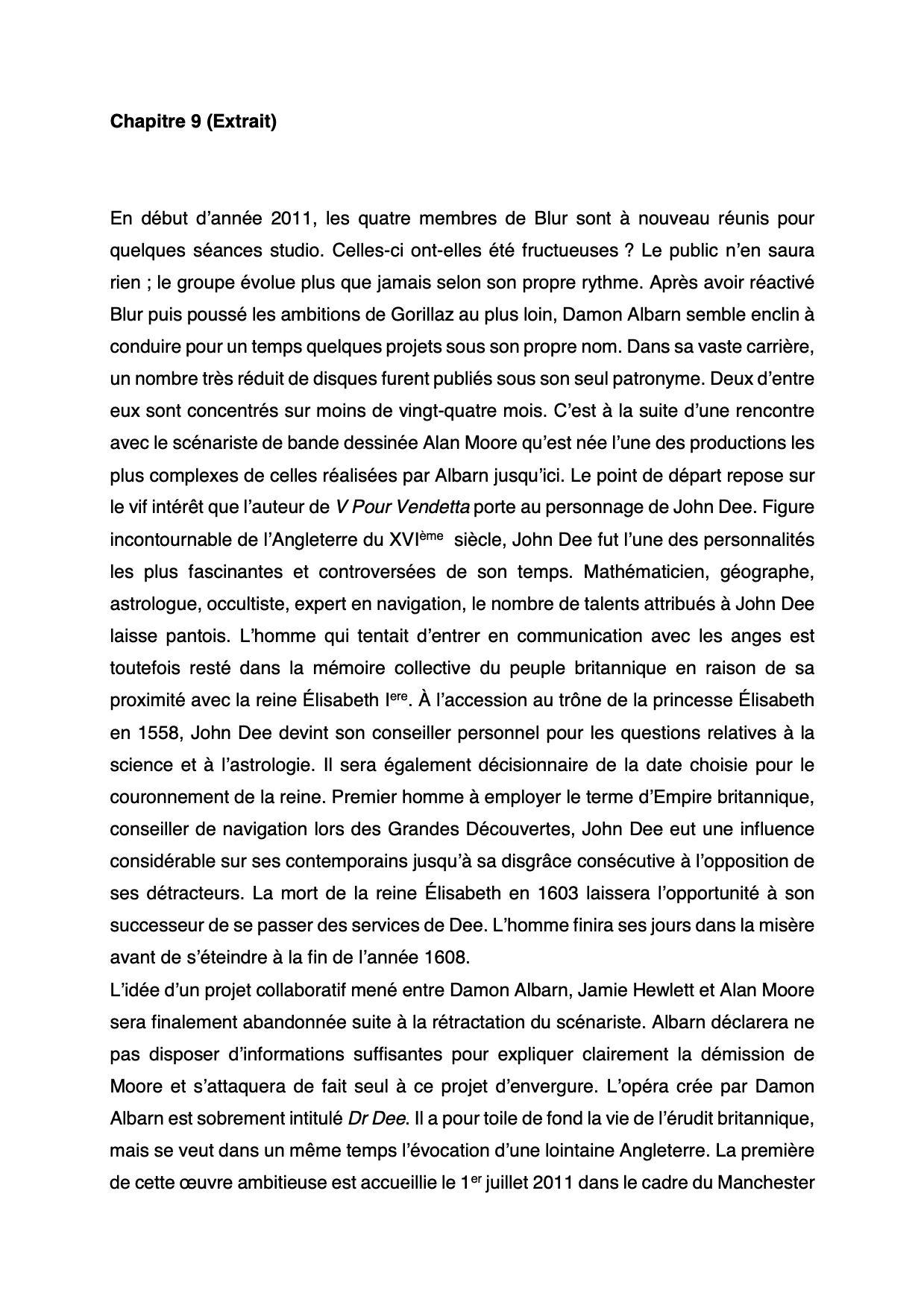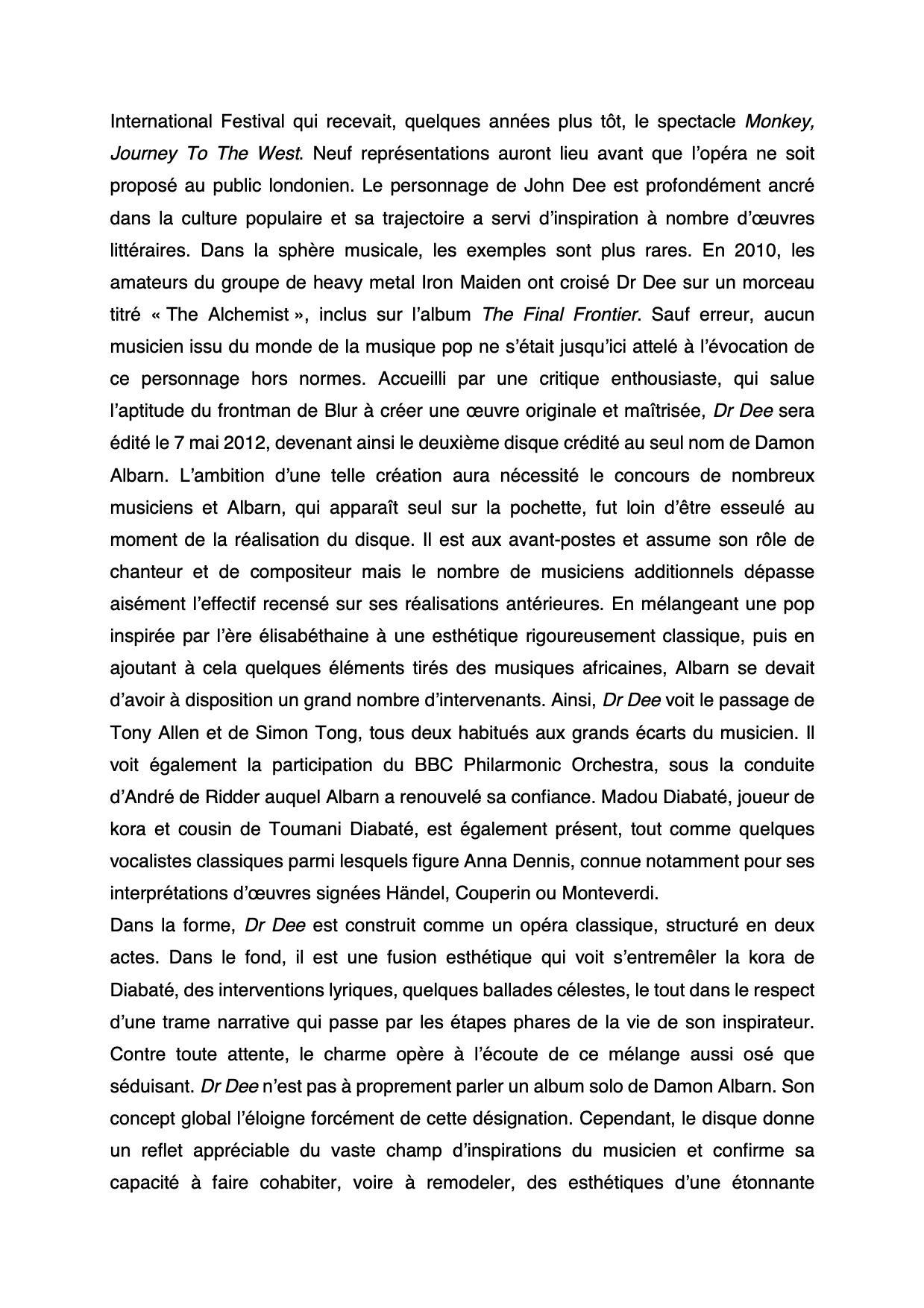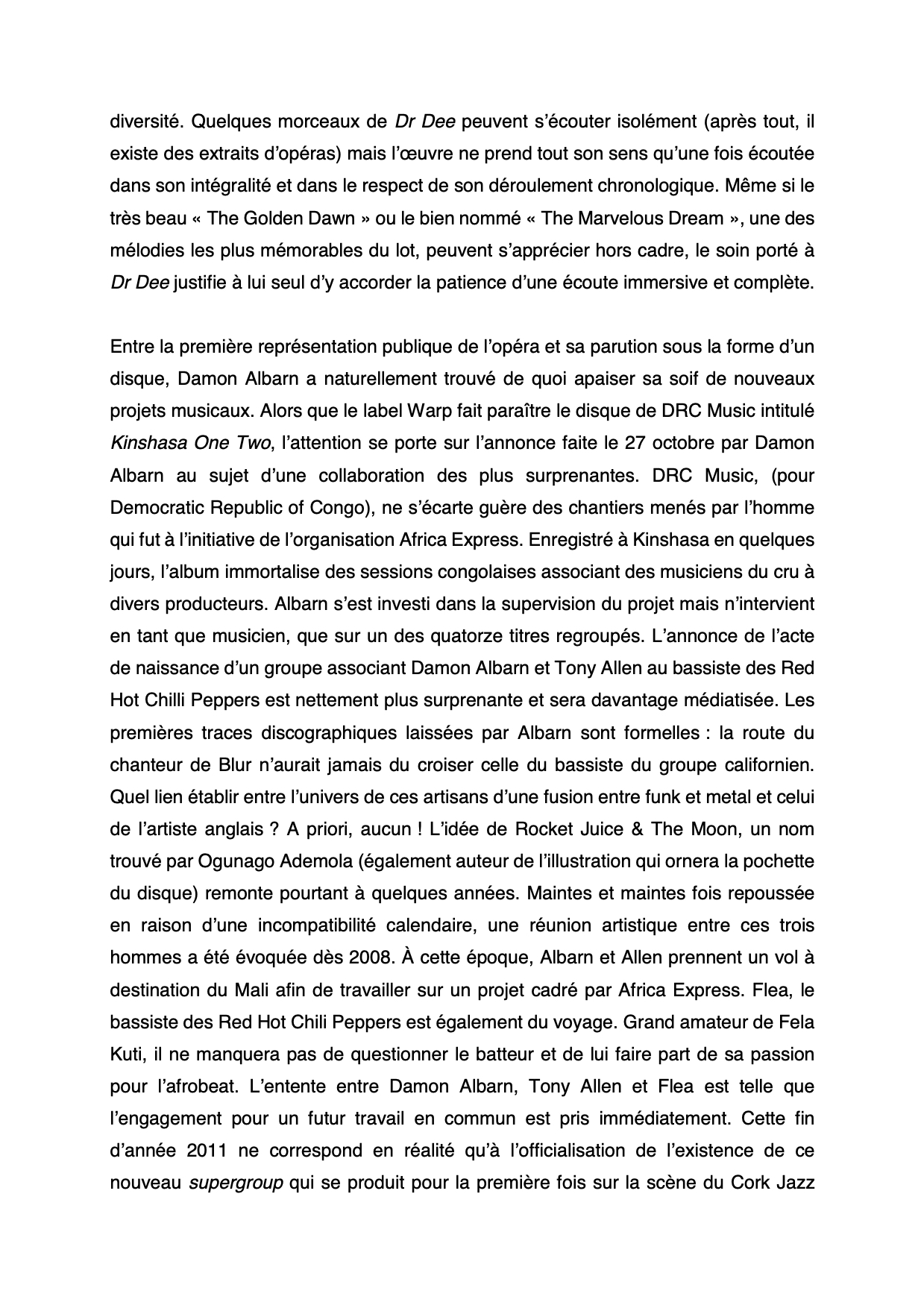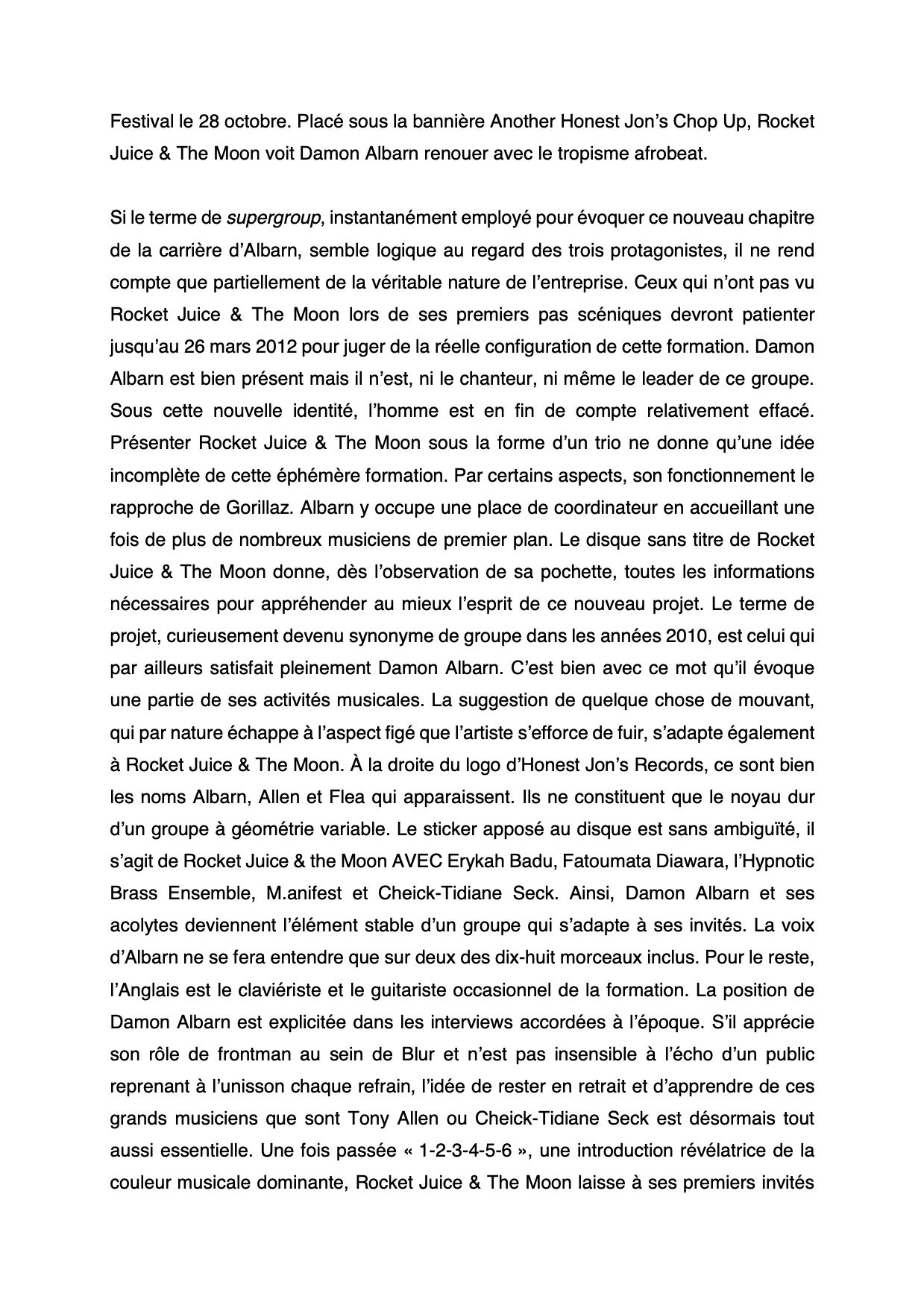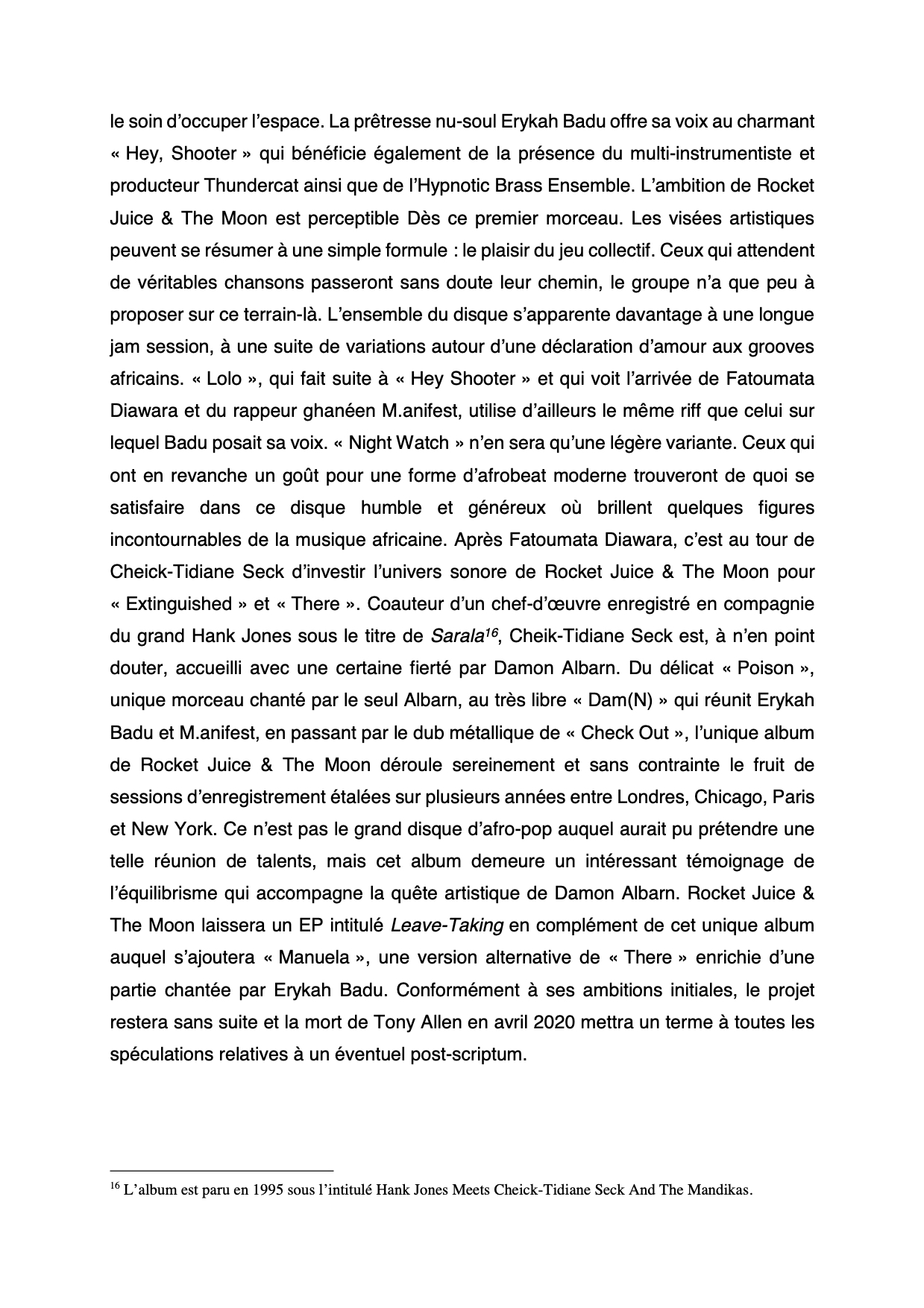Après un premier ouvrage sur Paul Weller, Nicolas Sauvage publie Damon Albarn : L’échappée Belle aux éditions du Camion Blanc. Contrairement à ce que clame haut et fort Peter Hook, il n’a pas été le seul à avoir marqué au fer rouge l’histoire de la musique avec deux groupes différents. C’est ce que nous raconte avec passion et érudition Nicolas Sauvage en retraçant le parcours atypique d’Albarn. Peu ont réussi au long de leur carrière à se frotter à des styles aussi différents que le baggy, la pop, la musique africaine ou le hip hop sans se ridiculiser. En plaçant systématiquement l’œuvre d’Albarn dans le contexte de l’époque, Nicolas Sauvage réussit la prouesse d’accrocher le lecteur comme dans un roman. À aucun moment, il n’impose sa connaissance pourtant encyclopédique du sujet. Il préfère aller à l’essentiel, suggérer, partager modestement. Les fans hardcore y apprendront quelques informations et les néophytes rentreront aisément dans l’univers d’Albarn. Au-delà de la référence à la carrière du musicien, titrer son livre L’Echappée Belle est également un excellent résumé du plaisir que l’on prend à le lire.
A écouter ce soir sur section26 : Le Club du Samedi Soir #26 consacré à Damon Albarn.
Bonus à la fin de l’article : quelques bonnes feuilles de l’ouvrage de Nicolas Sauvage.
Après Paul Weller, pourquoi avoir choisi d’écrire un livre sur Damon Albarn ?
Pour le livre précédent, je me suis servi de Paul Weller en tant que colonne vertébrale. J’ai élargi le sujet en fonction de l’évolution de la pop anglaise tout au long de son parcours. La partie la plus décisive allait du début de sa carrière jusqu’à ses premiers albums solo. Je trouvais ça intéressant d’avoir une contextualisation. J’ai été frustré de ne pas avoir pu aller au fond des choses à partir du début des années 90. C’est l’histoire que j’ai essayé de raconter autour de Damon Albarn. Parler d’un musicien sans aborder tout ce qui se passe autour de lui ne me passionne pas. Je suis intéressé par les univers dans lesquels on peut se promener et découvrir des choses au fur et à mesure.

Pourquoi ne pas avoir mené d’interviews de proches de Damon Albarn pour le livre ?
Dans les biographies rock britanniques, on place souvent la personne au-dessus de son œuvre. Je préfère parler de musique. Quand on traite de l’œuvre de quelqu’un, il y a des passerelles, des influences, une porosité avec le contexte qui l’entoure. Je trouve cette approche globale plus intéressante. Idéalement, j’aimerais que le lecteur puisse accéder à ce que j’ai vécu moi-même en suivant le parcours de Damon Albarn. Quand on a 20 ans et que l’on découvre le premier Blur, on lit la presse anglaise, on s’intéresse donc au mouvement baggy ou bien au shoegaze. On écoute aussi les groupes cités comme influences par les critiques pour remonter jusqu’à la source. A mon humble niveau, j’essaie moi aussi de servir de passeur.
Le livre arrive à remplir ce rôle sans que tu imposes tes goûts ou opinions de façon écrasante. L’équilibre a-t-il été difficile à trouver ?
Je préfère que chacun se fasse son idée en offrant un maximum de clés pour comprendre le parcours. Il y a par exemple un certain clivage entre les fans de Blur et de Gorillaz. Si certains ne comprennent pas pourquoi il a fait certains choix musicalement, il est possible de l’expliquer. Il est intéressant de décortiquer les mécanismes de création qui entourent son œuvre et de permettre au lecteur de circuler dans tout ça.
Quel a été ton premier contact avec la musique d’Albarn ?
 J’ai découvert Blur avec le single There’s No Other Way que j’ai trouvé sympathique mais sans plus. A l’époque, j’étais en pleine immersion dans la culture Mod qui me fascinait. J’étais plus attiré par The Jam, The Kinks ou The Small Faces. Ce n’est que plus tard avec la sortie de Modern Life Is Rubbish, leur deuxième album, que je suis rentré de plain-pied dans la musique de Blur. L’univers m’attirait davantage. J’ai commencé à aller les voir sur scène et à acheter régulièrement leurs disques. Je ne trouve pas Leisure, leur premier album particulièrement réussi. Même avec du recul. Je ne pense pas être le seul à partager cette opinion puisque même Albarn ne le trouve pas très bon. Leisure a beau être porteur de promesses, je pense que j’aurais lâché le groupe s’ils n’avaient pas donné une suite aussi différente. Pour moi, l’histoire de Blur commence en 1993.
J’ai découvert Blur avec le single There’s No Other Way que j’ai trouvé sympathique mais sans plus. A l’époque, j’étais en pleine immersion dans la culture Mod qui me fascinait. J’étais plus attiré par The Jam, The Kinks ou The Small Faces. Ce n’est que plus tard avec la sortie de Modern Life Is Rubbish, leur deuxième album, que je suis rentré de plain-pied dans la musique de Blur. L’univers m’attirait davantage. J’ai commencé à aller les voir sur scène et à acheter régulièrement leurs disques. Je ne trouve pas Leisure, leur premier album particulièrement réussi. Même avec du recul. Je ne pense pas être le seul à partager cette opinion puisque même Albarn ne le trouve pas très bon. Leisure a beau être porteur de promesses, je pense que j’aurais lâché le groupe s’ils n’avaient pas donné une suite aussi différente. Pour moi, l’histoire de Blur commence en 1993.
La sortie de Modern Life Is Rubbish correspond aux frémissements de la Britpop. A l’époque avais-tu ressenti que quelque chose se passait ?
 Blur est arrivé entre deux périodes. La fin du mouvement baggy et du shoegaze. Aucun de ces styles ne fonctionnait vraiment dans leur musique. Il a fallu attendre la sortie de Modern Life Is Rubbish pour qu’ils soient en phase avec leur époque. Je me souviens d’un concert de cette tournée à l’Ubu à Rennes. On les sentait vraiment sûrs de leur truc. Un membre du groupe European Sons était à côté de moi. Il m’avait dit que ce groupe représentait l’avenir de la pop anglaise. J’étais plutôt d’accord avec lui. Il y avait une évidence. Entre les chansons et le charisme d’Albarn, le dandysme d’Alex James et la qualité du jeu de Graham Coxon, tout était rassemblé pour que ça décolle. Au même moment, on commençait à beaucoup parler de Suede, The Auteurs, Pulp et du retour de Lawrence de Felt. Un changement allait arriver.
Blur est arrivé entre deux périodes. La fin du mouvement baggy et du shoegaze. Aucun de ces styles ne fonctionnait vraiment dans leur musique. Il a fallu attendre la sortie de Modern Life Is Rubbish pour qu’ils soient en phase avec leur époque. Je me souviens d’un concert de cette tournée à l’Ubu à Rennes. On les sentait vraiment sûrs de leur truc. Un membre du groupe European Sons était à côté de moi. Il m’avait dit que ce groupe représentait l’avenir de la pop anglaise. J’étais plutôt d’accord avec lui. Il y avait une évidence. Entre les chansons et le charisme d’Albarn, le dandysme d’Alex James et la qualité du jeu de Graham Coxon, tout était rassemblé pour que ça décolle. Au même moment, on commençait à beaucoup parler de Suede, The Auteurs, Pulp et du retour de Lawrence de Felt. Un changement allait arriver.
Il aura pourtant fallu que Blur patiente avant de rencontrer son heure de gloire. Suede a raflé la mise médiatique et publique avec leur premier album. Ils avaient le soutien de Bowie et de Morrissey. Blur méritait autant que les autres d’avoir sa part du gâteau dès le début 1993. Comment abordes-tu cet aspect dans le livre ?
 Alex James résume parfaitement la situation dans son livre. Il dit que c’est Damon Albarn qui a posé les fondations de la britpop. Je trouve ça plutôt juste. Ils ont vécu plus que d’autres l’omniprésence d’une musique qui ne les représentait pas en tournant aux USA à l’époque de Nevermind. Pourtant, il y a eu ce camouflet avec Suede qui leur a barré la route. C’est Brett Anderson qui était en couverture du fameux numéro de Select “Yanks Go Home” d’avril 1993. Cette une a lancé la britpop. Blur a été écarté de tout ça. Ça a créé un côté revanchard chez Albarn qui est quelqu’un de très ambitieux. Il a senti qu’il avait nourri un courant sans qu’on lui rende son dû.
Alex James résume parfaitement la situation dans son livre. Il dit que c’est Damon Albarn qui a posé les fondations de la britpop. Je trouve ça plutôt juste. Ils ont vécu plus que d’autres l’omniprésence d’une musique qui ne les représentait pas en tournant aux USA à l’époque de Nevermind. Pourtant, il y a eu ce camouflet avec Suede qui leur a barré la route. C’est Brett Anderson qui était en couverture du fameux numéro de Select “Yanks Go Home” d’avril 1993. Cette une a lancé la britpop. Blur a été écarté de tout ça. Ça a créé un côté revanchard chez Albarn qui est quelqu’un de très ambitieux. Il a senti qu’il avait nourri un courant sans qu’on lui rende son dû.
 C’est une des raisons pour laquelle ils ont énormément travaillé sur Parklife. Le dosage était idéal. Avec Girls And Boys, single hyper direct qui marque les esprits, ils ont accroché les fans d’indie pop et le grand public. N’oublions pas qu’à l’époque Damon Albarn sortait avec Justine Frischmann, l’ex petite amie de Brett Anderson. Cela a aussi créé un esprit de compétition entre les deux groupes. La britpop n’a pas duré longtemps, mais elle a eu un effet décisif sur la carrière d’Albarn.
C’est une des raisons pour laquelle ils ont énormément travaillé sur Parklife. Le dosage était idéal. Avec Girls And Boys, single hyper direct qui marque les esprits, ils ont accroché les fans d’indie pop et le grand public. N’oublions pas qu’à l’époque Damon Albarn sortait avec Justine Frischmann, l’ex petite amie de Brett Anderson. Cela a aussi créé un esprit de compétition entre les deux groupes. La britpop n’a pas duré longtemps, mais elle a eu un effet décisif sur la carrière d’Albarn.
 Sa personnalité arrogante et son énorme ambition lui ont joué des tours à l’époque des deux premiers albums. Irais-tu jusqu’à dire qu’il s’est lui-même tiré une balle dans le pied au moment où Blur aurait mérité de décoller en 1993 ?
Sa personnalité arrogante et son énorme ambition lui ont joué des tours à l’époque des deux premiers albums. Irais-tu jusqu’à dire qu’il s’est lui-même tiré une balle dans le pied au moment où Blur aurait mérité de décoller en 1993 ?
Dans le livre, j’utilise la formule d’arroseur arrosé. Il savait comment faire pour attirer les médias, mais il s’en est vite mordu les doigts. C’est l’une des raisons pour laquelle il a vite tourné le dos à la britpop. Des années plus tard, nous avons toujours en tête la rivalité Blur-Oasis. Mais ramenée à l’échelle de la carrière d’Albarn, c’est une période plutôt courte.
Dans le livre, tu es plutôt positif à propos de The Great Escape, un album jugé parfois un peu trop facile. Penses-tu que le groupe était vraiment sincère au moment de son enregistrement ?
 C’est un disque qui a été enregistré très vite. Les premières sessions ont eu lieu pendant le succès de Parklife. Il y a forcément un aspect tome 2. Il s’inscrit dans le courant et le mouvement de l’époque. Ils n’ont pas eu le temps de prendre du recul. Ils étaient sans arrêt sollicités par les tournées et les interviews. Je pense qu’ils ont voulu aller au bout de la démarche mise en place avec Modern Life Is Rubbish. Certains titres enregistrés pour The Great Escape dataient de plus de deux ans.
C’est un disque qui a été enregistré très vite. Les premières sessions ont eu lieu pendant le succès de Parklife. Il y a forcément un aspect tome 2. Il s’inscrit dans le courant et le mouvement de l’époque. Ils n’ont pas eu le temps de prendre du recul. Ils étaient sans arrêt sollicités par les tournées et les interviews. Je pense qu’ils ont voulu aller au bout de la démarche mise en place avec Modern Life Is Rubbish. Certains titres enregistrés pour The Great Escape dataient de plus de deux ans.
C’est justement au moment où il souhaite s’éloigner de tout le cirque britpop que les premières grosses tensions apparaissent dans le groupe. Sans sous-estimer le rôle des autres membres, le livre montre bien à quel point Damon Albarn est le capitaine du navire.
 C’est un sujet qui n’a pas été souvent abordé, même à l’époque. Le principal songwriter de Blur, est Damon Albarn. On avait tendance à réduire son rôle à celui de chanteur-leader ou de jeune premier qui attire les midinettes. Pourtant, il apportait 80% des chansons. Le groupe lui a laissé les clés dès Modern Life Is Rubbish pour suivre le pari de l’identité 100% britannique. Le seul semblant de démocratie qu’il y a eu par la suite a été pour l’album homonyme qui a suivi The Great Escape. A cette époque, le groupe avait perdu la guerre contre Oasis. Ils étaient obligés de passer à autre chose. Cet épisode de la bataille de la britpop monté artificiellement par les médias aura finalement été un mal pour un bien.
C’est un sujet qui n’a pas été souvent abordé, même à l’époque. Le principal songwriter de Blur, est Damon Albarn. On avait tendance à réduire son rôle à celui de chanteur-leader ou de jeune premier qui attire les midinettes. Pourtant, il apportait 80% des chansons. Le groupe lui a laissé les clés dès Modern Life Is Rubbish pour suivre le pari de l’identité 100% britannique. Le seul semblant de démocratie qu’il y a eu par la suite a été pour l’album homonyme qui a suivi The Great Escape. A cette époque, le groupe avait perdu la guerre contre Oasis. Ils étaient obligés de passer à autre chose. Cet épisode de la bataille de la britpop monté artificiellement par les médias aura finalement été un mal pour un bien.
Cela correspond à une période où Albarn commence à collaborer avec d’autres artistes. Dans le livre, tu n’évoques pas la lassitude comme une des raisons de cette échappatoire. Pourrais-tu nous dire pourquoi ?
Parce que je pense que c’est surtout lié aux tensions au sein de Blur, la séparation avec Justine Frischmann et un voyage en Islande déterminant. Beaucoup de choses se sont cumulées. Il s’est retrouvé à l’âge de trente ans à se demander ce qu’il voulait vraiment accomplir en tant que musicien. Le paysage global commençait à changer. La britpop était sur le déclin. Un album comme le Ok Computer de Radiohead ouvrait de nouvelles pistes. On commençait à parler de dad rock pour décrire le paysage musical des groupes à guitares. Ceux qui ont persévéré dans cette veine ont fini par sombrer. Pour trouver ce qui se faisait de plus excitant, il fallait aller chercher du côté des musiques électroniques ou du hip hop. Damon Albarn ne pouvait pas y rester indifférent. En découvrant d’autres styles musicaux, Albarn renouait avec son éducation. Il est issu d’un milieu où la musique pop était secondaire. Ses parents développaient un intérêt pour les musiques indiennes et africaines. Il a vécu dans des quartiers cosmopolites. C’est la raison pour laquelle, à ce moment-là, le format pop était devenu trop restrictif pour lui. Avec plus ou moins de réussite, il a décidé de faire fi de toute frontière. Post britpop, il est devenu plus aventureux et plus joueur, comme s’il s’était libéré.
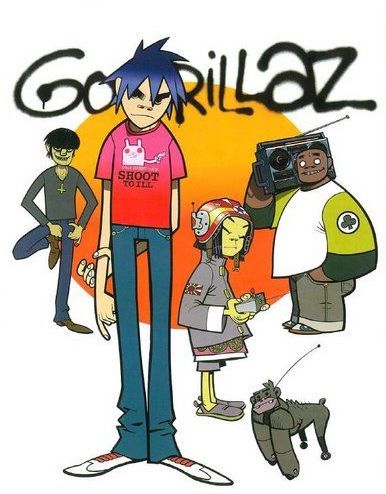 Cela se ressent d’ailleurs dès les débuts de Gorillaz. Comment analyses-tu le lancement de ce nouveau groupe dans lequel il ne met pas son nom ni son image en avant ?
Cela se ressent d’ailleurs dès les débuts de Gorillaz. Comment analyses-tu le lancement de ce nouveau groupe dans lequel il ne met pas son nom ni son image en avant ?
Je pense qu’il avait besoin d’anonymat. Cela n’aurait pas été une bonne idée de se mettre en avant. C’est là où l’on s’aperçoit qu’Albarn est quelqu’un de malin. Il a toujours gardé la maîtrise de sa trajectoire. Il sentait que le vent tournait et il a probablement senti que Blur pouvait faire un disque de trop à ce moment-là. Il aurait certainement voulu emmener Blur dans cette direction. Certains titres de Gorillaz, notamment Tomorrow Comes Today, ont fait l’objet de tentatives avec Blur. Les autres membres n’ont pas été convaincus. C’est une période importante pour Albarn car l’anonymat apporté par Gorillaz est venu servir son propre propos.
Gorillaz est un projet en duo avec le dessinateur Jamie Hewlett. Pourtant Albarn le mettra à un moment sur la touche en privilégiant les invités à outrance et en rompant l’anonymat du groupe. Dans le livre, tu choisis de ne jamais vraiment juger ses écarts. Pourquoi cette décision ?
 On a senti un tournant avec la sortie de Demon Days, le deuxième album de Gorillaz. Avec Plastic Beach c’est devenu une évidence. Les visuels de Hewlett occupaient beaucoup moins de place sur scène. En même temps, c’est une sacrée revanche pour lui. En 2010 il se retrouve sur scène avec Paul Simonon et Mick Jones de The Clash qui jouent dans son groupe. Il est encore debout alors que la majorité des vétérans de la britpop ont jeté l’éponge. Avec Gorillaz, il a vendu encore plus de disques qu’avec Blur. Il jouait en tête d’affiche à Glastonbury. L’anonymat n’avait plus du tout sa place. Je pense qu’il l’a vécu comme une sorte de revanche.
On a senti un tournant avec la sortie de Demon Days, le deuxième album de Gorillaz. Avec Plastic Beach c’est devenu une évidence. Les visuels de Hewlett occupaient beaucoup moins de place sur scène. En même temps, c’est une sacrée revanche pour lui. En 2010 il se retrouve sur scène avec Paul Simonon et Mick Jones de The Clash qui jouent dans son groupe. Il est encore debout alors que la majorité des vétérans de la britpop ont jeté l’éponge. Avec Gorillaz, il a vendu encore plus de disques qu’avec Blur. Il jouait en tête d’affiche à Glastonbury. L’anonymat n’avait plus du tout sa place. Je pense qu’il l’a vécu comme une sorte de revanche.
S’il est facile de citer des groupes influencés par Blur, il est plus compliqué d’en trouver influencés par Gorillaz. Définirais-tu Gorillaz comme un groupe à part, sous quelle forme as-tu essayé de l’aborder dans le livre ?
Je pense qu’il n’y aura jamais de groupes influencés par Gorillaz. L’impact de Gorillaz se mesure de manière différente. Gorillaz a récemment fait la couverture des Inrockuptibles. L’accroche était un peu choc : “On a inventé la pop moderne”. On se rend compte qu’une pop un peu polymorphe avec beaucoup de featurings est très représentative de notre époque. On a de plus en plus de difficultés à mettre des artistes dans une case avec un style musical précis. Gorillaz avait un peu anticipé tout ça. Les “enfants” de Gorillaz sont un peu partout autour de nous.
Tu parlais précédemment de projets pas toujours réussis tout au long de sa carrière. Comment as-tu procédé pour t’en détacher et à ne pas imposer une opinion trop tranchante pour les évoquer dans ton livre ? Trouver le bon angle n’a pas dû toujours être évident.
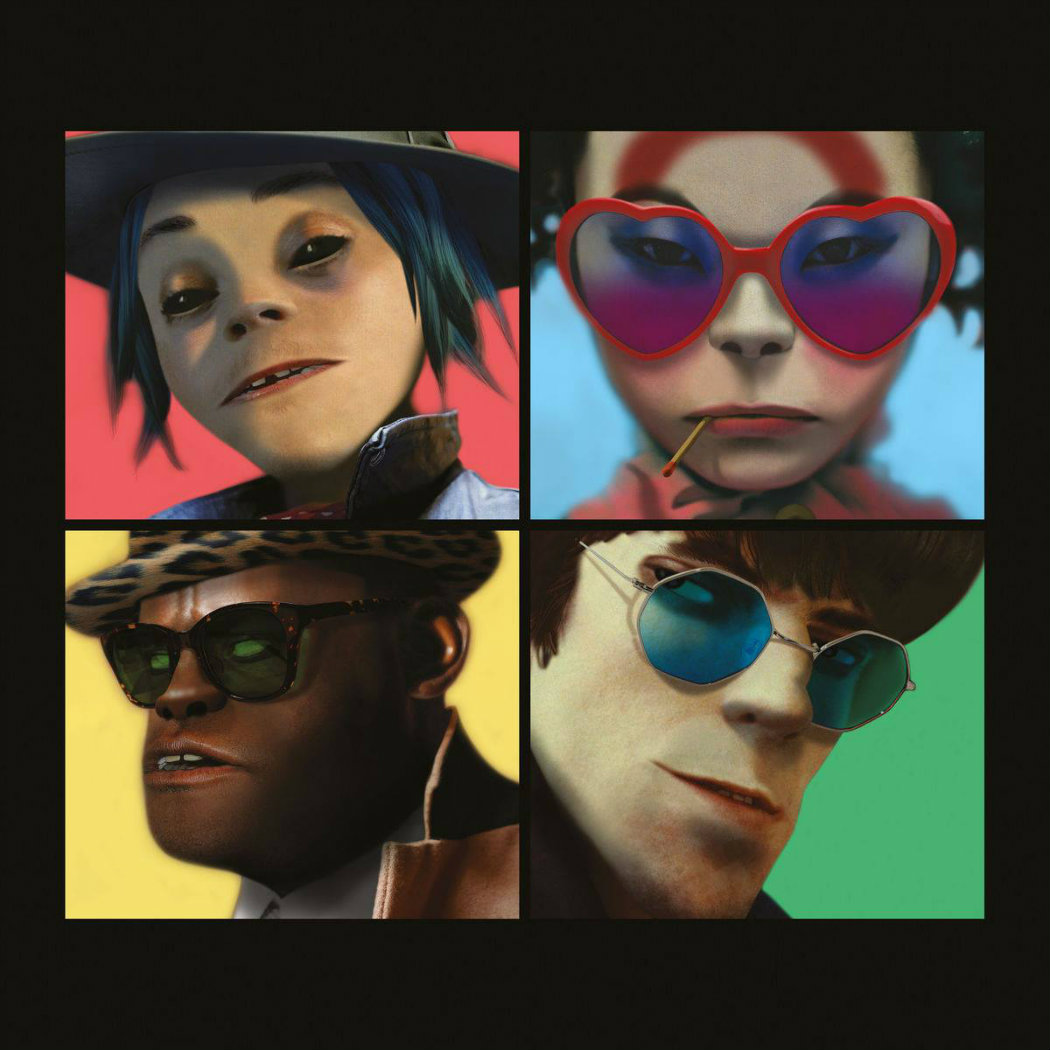 Je propose mon avis en restant factuel. J’essaie juste d’expliquer pourquoi ça fonctionne ou pas. Dans le cas de Humanz, un album de Gorillaz, j’accentue un maximum sur le fait qu’Albarn va au bout de sa logique de featurings. Ça apporte quelque chose de très dense, à tel point que je m’interroge dans le livre de savoir où se trouve Albarn dans Humanz. On ne l’entend plus. On ne retrouve plus sa personnalité, il ne chante presque pas. A l’aveugle, sur certains titres, personne n’est capable de dire que c’est du Gorillaz. On a le sentiment qu’il a déserté son propre disque. C’est ma façon de le voir. J’essaie toujours de ne pas être sentencieux car d’autres lecteurs ont peut-être une autre vision des choses. Ce qui est certain, c’est que dans les tournées qui ont suivi, très peu de titres de Humanz ont été joués. Quelque part, Albarn doit se dire qu’il n’y a pas beaucoup de choses à exploiter dans ce disque.
Je propose mon avis en restant factuel. J’essaie juste d’expliquer pourquoi ça fonctionne ou pas. Dans le cas de Humanz, un album de Gorillaz, j’accentue un maximum sur le fait qu’Albarn va au bout de sa logique de featurings. Ça apporte quelque chose de très dense, à tel point que je m’interroge dans le livre de savoir où se trouve Albarn dans Humanz. On ne l’entend plus. On ne retrouve plus sa personnalité, il ne chante presque pas. A l’aveugle, sur certains titres, personne n’est capable de dire que c’est du Gorillaz. On a le sentiment qu’il a déserté son propre disque. C’est ma façon de le voir. J’essaie toujours de ne pas être sentencieux car d’autres lecteurs ont peut-être une autre vision des choses. Ce qui est certain, c’est que dans les tournées qui ont suivi, très peu de titres de Humanz ont été joués. Quelque part, Albarn doit se dire qu’il n’y a pas beaucoup de choses à exploiter dans ce disque.

Dirais-tu qu’avec The Good The Bad & The Queen, Albarn s’est offert un Blur bis dans le sens où il est revenu à un format beaucoup plus pop et centré sur l’Angleterre, chose qu’il a souvent déclaré vouloir retrouver avec ses anciens compères ?
Pour moi c’est de la britpop au sens premier du terme. De la pop anglaise extrêmement classique. On y perçoit des aspects de la musique des Kinks ou de Madness. Il est revenu avec un autre regard et avec beaucoup plus de distance qu’il pouvait en avoir à l’époque de Parklife. Les textes d’Albarn sont souvent en décalage avec la musique. Pour Parklife et The Great Escape, certains y ont perçu quelque chose de très révérencieux vis-à-vis de l’Angleterre. Il y a pourtant différents degrés de lecture. C’est la même chose pour The Good The Bad & The Queen. Sauf que c’est un adulte avec du vécu qui est aux manettes. On y sent plus de distance.
Tout au long du livre, deux influences majeures d’Albarn sont régulièrement citées : Madness et The Specials. Penses-tu que ces groupes ont eu une influence sur lui qui va au-delà de leur musique ?
Je pense que l’esprit de The Specials l’a profondément marqué. Particulièrement celui de Jerry Dammers et de Terry Hall. Il a vu dans le deuxième album des Specials une musique ouverte à des influences variées. On y entend quelque chose d’assez hybride et de multiculturel, ce qui fascine Albarn depuis le début. Pour Madness, il a dit très ouvertement en interview que c’était un groupe qui ne l’avait jamais déçu. Comme chez les Kinks, on retrouve dans les albums de Madness le récit d’une Angleterre oubliée. Quelque chose de très poétique, mais avec une sensibilité pop bien présente. C’est quelque chose qui lui parle.

Tu as écouté toute son œuvre pendant l’écriture du livre. As-tu été parfois surpris par des redécouvertes ?
Même si je connaissais très bien le disque, j’ai été frappé par le travail du son de Everyday Robots, son album solo. Le dépouillement presque total était une option plutôt gonflée. Ce disque pourrait presque être une porte d’entrée pour quelqu’un qui n’a jamais écouté Damon Albarn. Tout ce qui fait de lui un songwriter intéressant et un mélodiste singulier se retrouve dans cet album. Il est comme un squelette de ce qu’Albarn a pu faire avant et après. Il y a une proximité que l’on ne retrouve pas ailleurs. On le constate sur les concerts tardifs de Blur. Le répertoire a pris de l’épaisseur. J’avais été surpris par les versions de She’s So High qui ouvraient la première reformation. L’interprétation était différente.
L’intérêt d’Albarn pour les musiques autres que la pop a-t-il à un niveau personnel ouvert des portes à ta culture musicale ?
Quelques-uns mais pas tant que ça. C’est même plutôt l’inverse. C’est mon goût pour les musiques périphériques à la pop qui a suscité mon intérêt pour la carrière d’Albarn. Appréciant particulièrement le hip-hop, son incursion dans ce style me convenait bien. Je l’ai suivi naturellement.

Si tu ne devais retenir qu’un album de sa carrière, lequel choisirais-tu et pourquoi ?
Curieusement The Magic Whip de Blur. Ce disque m’a vraiment impressionné. Musicalement, on y trouve de grandes réussites. Le choix décisif a sans doute été de remettre Stephen Street à la production. J’y ai trouvé un condensé de tout ce que j’apprécie dans Blur. On y retrouve le groupe intact. Arriver à un tel résultat après un parcours accidenté rend l’album touchant. Il n’y a pas eu beaucoup de retours aussi marquants dans l’histoire de la pop anglaise.
 Damon Albarn : L’échapée belle par Nicolas Sauvage est disponible aux éditions du Camion Blanc. Préface de Christophe Basterra, 410 pages.
Damon Albarn : L’échapée belle par Nicolas Sauvage est disponible aux éditions du Camion Blanc. Préface de Christophe Basterra, 410 pages.
BONUS : Quelques bonnes feuilles du livre de Nicolas Sauvage.