
Maria McKee n’avait plus donné de nouvelles depuis près de treize ans. Retirée de la musique pour se consacrer au cinéma et, plus précisément, aux films de son mari, Jim Akin, la chanteuse n’avait donc plus rien sorti depuis Late December en 2007, jugeant notamment que sa carrière ne lui ressemblait plus et que son heure était sans doute aussi un peu passée. Pourtant, cette pionnière de la scène néo-country, encensée depuis ses débuts au sein des éphémères Lone Justice, a toujours été une femme de tête et demeure une figure difficilement contournable du rock américain de ces quarante dernières années. Dans les années 90, elle avait ainsi réussi à s’imposer comme une véritable artiste solo, signant quelques albums de haute tenue, parmi lesquels le remarquable You Gotta Sin to Get Saved (1), un classique de l’americana produit par George Drakoulias et pour lequel elle avait embrigadé des membres des Jayhawks, des Posies et des Heartbreakers de Tom Petty.
Mais, aujourd’hui, tout est différent. Maria McKee a quitté son mari après plus de vingt ans de vie commune et partage désormais son temps entre Londres et Los Angeles, avec sa nouvelle compagne. Inspiré par Dante, La Vita Nuova est le disque de sa renaissance, celui qui a accompagné son basculement vers une autre sexualité et sa décision d’assumer enfin son identité queer. Très orchestré et porté par un lyrisme et une ambition qui rappellent le Scott Walker des années soixante, ce nouvel album au parfum très anglais est probablement ce que la demi-sœur de Bryan MacLean (2) a réalisé de plus original. C’est, en tout cas, ce que suggère le romantisme vibrant, et souvent bouleversant, qui émane de titres comme Page of Cups et Right Down to the Heart of London et l’éblouissant Let Me Forget. La Vita Nuova, cette nouvelle vie qui aura été rêvée avant d’être vécue, est donc aussi la preuve qu’une artiste peut tout à fait sortir son meilleur album à 55 ans. Et surtout renaître, en voyant son cœur battre plus fort que jamais.
Vous n’aviez plus rien sorti depuis treize ans. Que s’est-il passé ?
Je n’étais pas complètement satisfaite de ce que j’avais pu faire depuis High Dive, en 2003. J’avais enregistré plusieurs disques live, je chantais des chansons qui n’étaient plus les miennes et qu’on m’avait plus ou moins imposées, bref, j’étais de moins en moins investie dans ce que je faisais. Donc je me suis arrêtée. Ensuite, mon ex-mari a commencé à tourner ses propres films et, comme je croyais beaucoup en lui, j’ai fait tout ce que je pouvais pour l’aider. J’enregistrais des musiques pour ses films, mais il m’arrivait aussi de jouer dedans. Nous avons travaillé comme ça pendant quelques années et le dernier film que nous avons fait ensemble, dans lequel je jouais le rôle principal, a été un tournant. C’était un film très noir, un peu comme ceux de Lars Von Trier. Ce rôle m’a vraiment poussée au-delà de mes limites ; il m’a presque tuée, je ne plaisante pas ! Bref, j’en suis sortie dévastée, mais je crois que cela m’a aussi permis d’ouvrir les yeux. D’un coup, j’ai réalisé que la vie que je menais ne me correspondait plus du tout. J’étais mariée, mais ce mariage n’en était plus vraiment un. Notre vie de couple était devenue totalement platonique et je n’avais pas, non plus, d’aventures, car il me semblait que cela ne se faisait pas. En fait, nous avions trouvé une sorte d’équilibre dans le travail : je l’épaulais beaucoup dans la réalisation de ses films, de la même façon que lui m’avait soutenue dans mes derniers projets musicaux. Mais le couple, ce n’est pas le travail. Et je crois que je me mentais à moi-même et que tout cela n’était qu’une fuite.
Vous avez beaucoup tourné avec votre mari ?
Oui, mais j’ai toujours joué, vous savez. J’avais même commencé dans le théâtre. Et puis, Lone Justice était aussi un jeu pour moi. Notre premier album avait été comme un film dans lequel je devais jouer la fille de la campagne, fan de la Carter Family, etc. Moi, je sortais du lycée de Beverley Hills. Je n’avais rien à voir avec tout ça.
Cette image de la fille de la campagne dans Lone Justice, c’était une chose que vous aviez décidée ou qu’on vous avait imposée ?

Non, c’était une phase que je traversais. J’avais fabriqué ce personnage de fille des montagnes, habillée dans des robes des années 30… Pour moi, c’était comme une pièce de théâtre. Ensuite, comme j’étais plutôt une bonne actrice, j’avais même fini par croire, moi aussi, que j’étais une chanteuse country. Bref, tout ça pour dire que le film de mon mari a ouvert une brèche en moi. Et, une fois qu’elle était ouverte, il était impossible la refermer. Ensuite, des choses ont commencé à remonter à la surface et je me suis mise à voir très distinctement tout ce que j’avais cherché à fuir pendant des années. J’étais en état de choc et, pour moi, la seule manière de faire face à tout ça était de me mettre à écrire. Alors j’ai écrit sans relâche pendant des semaines… A partir du moment où je m’étais remise à écrire, je ne pouvais plus m’arrêter. Les chansons arrivaient sans cesse, les unes après les autres. Je n’avais pas connu une fièvre créatrice aussi intense depuis l’époque de Life Is Sweet (3).
Mais, ce film dont vous parlez, comment s’appelle-t-il ?
Il s’appelle Beauty, Majesty and Terror, mais il n’est pas sorti. Et je ne sais pas s’il sortira un jour. Il est beaucoup trop noir ! C’est l’histoire d’une femme suicidaire qui poursuit un tueur en série. C’est aussi un film incroyablement féministe. En tout cas, je n’ai jamais vu un personnage de femme d’âge moyen aussi fort sur un écran. Mais le film est aussi très dérangeant, car la femme cherche à attirer l’attention de ce tueur en série. Dans sa pulsion suicidaire, elle cherche une forme de reconnaissance dans l’esprit du tueur, comme si elle avait besoin de se sentir digne de devenir l’une de ses victimes.
Est-ce que votre mari savait, en écrivant ce rôle, que vous étiez au bord d’une telle crise existentielle ?
Il ne le savait pas, mais je pense qu’il devait le sentir. Le film parle de l’idée selon laquelle il n’est pas toujours bénéfique de s’efforcer de tenir à une ligne de moralité stricte, car, le plus souvent, on le fait contre son gré et… On ne vit pas. Donc le personnage essaye ensuite de vivre plus librement, mais elle s’aperçoit que cela ne marche pas, non plus, et qu’il n’y a pas de bonne manière de mener sa vie. Il y a quelque chose d’absurde dans cette histoire ! A la fin, le personnage trouve une issue et le public peut respirer, mais avant cela il y a tout un voyage.
Vous vous êtes retrouvée dans ce personnage ?
Oui, moi non plus je ne savais pas comment mener ma vie et j’avais l’impression de me tromper de chemin. Et puis, je me suis aussi reconnue dans cette femme qui, sentant la mort arriver, se disait qu’elle était devenue obsolète et qu’elle ne comptait simplement plus dans la société. Comme elle, j’étais dans ma cinquantaine et je ne savais même plus quels étaient mes désirs. Je voyais juste que je n’en avais plus. Mon mariage était agréable, mais nous n’étions désormais plus que des amis ou des collaborateurs. Donc je me suis mise à repenser à ma vie d’avant mon mariage, avant que j’arrête de boire, avant que je me mette à enregistrer des disques un peu mécaniquement et… J’avais l’impression d’observer la vie de mon doppelgänger.
Donc vous avez voulu reprendre le contrôle…
Oui, je me suis mise à écrire en pensant à Dante. J’ai beaucoup tourné autour de l’idée de la muse qui, pour moi, était une métaphore de la beauté, du désir, de la romance, de la nouveauté, des opportunités… Et j’ai commencé à écrire des poèmes d’amour à cette muse. Pour moi, c’était comme une élégie et cela me permettait de me libérer de beaucoup de choses. Et puis, vers la fin de ce long processus, j’ai réalisé que ce n’était pas du tout une élégie, mais plutôt une forme de renaissance et une tentative ultime de vivre enfin la vie que je voulais vivre.
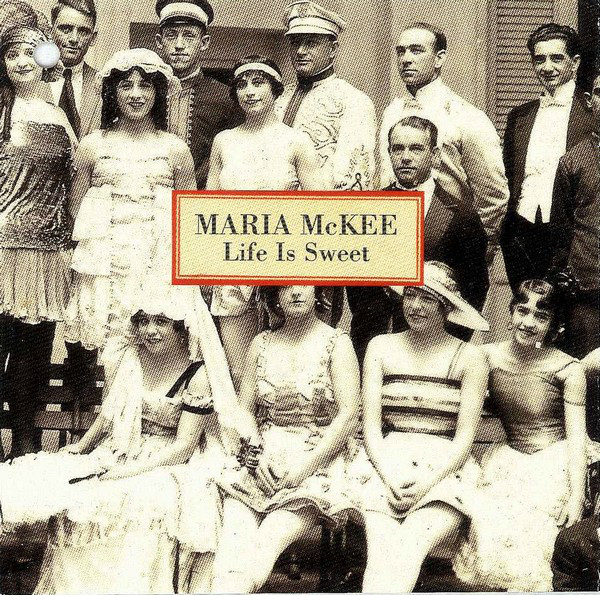 Tout à l’heure, vous disiez que cette expérience d’écriture était la plus intense que vous ayez vécue depuis la préparation de Life Is Sweet, il y a plus de vingt ans. Quelle différence faîtes-vous entre ces deux expériences ?
Tout à l’heure, vous disiez que cette expérience d’écriture était la plus intense que vous ayez vécue depuis la préparation de Life Is Sweet, il y a plus de vingt ans. Quelle différence faîtes-vous entre ces deux expériences ?
Life Is Sweet est mon album préféré en dehors du dernier. Ces deux disques ont été écrits de façon similaire. Je crois que je peux dire que, dans les deux cas, les chansons ont littéralement jailli de moi. Elles s’écrivaient toutes seules. J’ai des troubles obsessionnels, donc quand je suis dans ce genre de phase créative très intense, les chansons prennent vite toute la place. Mais, sinon, je dirais que La Vita Nuova est un peu une réponse tardive à Life Is Sweet. Comme si j’avais grandi entre-temps.
Dans quelle mesure l’œuvre de Dante a-t-elle influencé ce disque ?
L’idée d’écrire pour une muse m’a toujours intéressée. Il y a quelque chose de très spirituel, là-dedans. Bien sûr, on projette des choses sur une personne qu’on idéalise, mais il en ressort quelque chose de différent. Bref, les muses sont souvent évoquées par des hommes, donc cela m’intéressait, aussi, d’écrire en apportant une approche plus féminine. Ensuite, quand j’ai commencé à comprendre dans quoi je m’engageais, j’ai relu Dante et ça m’a donné un cadre. Mais je crois aussi qu’écrire sur la beauté, sur le désir et sur un être aimé, fut-il imaginaire, conduit à une ritualisation de ce rapport à la muse. Et il me semble qu’au bout du compte, on approche une forme de gnose.
Ce disque s’inspire aussi de votre propre vie, non ?
Oui, mais de façon métaphorique. Par exemple, une des muses de cet album est l’enfant que je n’ai jamais eu. Pendant des années, la possibilité était là, mais je la repoussais. Et puis, un jour, c’était fini et, aujourd’hui, je crois qu’en mon for intérieur, je regrette de ne pas avoir eu cette chance. Le pire, c’est que je pense que j’étais vraiment faite pour ça.

Est-ce que ce regret de ne pas avoir eu d’enfant n’est pas aussi l’une des raisons qui vous pousse, aujourd’hui, à rompre avec votre vie d’avant et le style de musique qui y était associé ?
Je ne sais pas… Ce qui est sûr c’est que pendant toutes ces années, Jim et moi, nous nous étions toujours dit que c’était finalement une chance de ne pas avoir d’enfant, de pouvoir voyager et dormir comme nous le voulions. Lorsque nous étions avec nos amis qui en avaient, nous nous félicitions toujours de ne pas en avoir. Et puis, un jour, Jim a engagé une jeune fille pour jouer dans un de ses films. Il voulait que cette jeune actrice, qui n’avait que douze ans à l’époque, joue l’enfant qu’il avait été, mais en fille. Ensuite, tout s’est tellement bien passé entre eux qu’il a fini par développer une sorte d’affection paternelle pour elle et, maintenant, ils tournent leur troisième film ensemble. En ce qui me concerne, je dirais qu’une grande part de mon identité queer comprend le rapport maternel que je peux avoir avec beaucoup de garçons et de filles isolés, abandonnés par leurs familles et livrés à eux-mêmes. M’occuper d’eux, essayer de les guider dans leur vie, c’est aussi ma façon de vivre au sein de cette communauté. En tout cas, il est clair que, mon identité queer ne saurait se limiter à mon attirance pour les femmes. Pour moi, c’est aussi une famille, une communauté, une cause à défendre et quelque chose de complètement politique. Bref, je pense que mon coming out, cette nouvelle vie et mon engagement dans la communauté queer m’a aussi aidée à apaiser les tensions intérieures que je pouvais ressentir.
J’imagine que cette attirance pour les femmes ne devait pas être nouvelle…
Non, je l’ai toujours su. Déjà, à l’école primaire j’étais attirée par une de mes camarades. Mais, vous savez, j’ai grandi dans une famille très catholique. Mes parents sont nés dans les années 40 et nous ont élevés, mon frère et moi, dans le cadre d’une éducation très rigoureuse. Moi, on m’avait appris que je devais être protégée par un homme. Au départ, il s’agissait de mon frère ; ensuite, les différents hommes que j’ai connus, notamment dans ma vie professionnelle, ont pris le relais. Ce qui est sûr, c’est que j’étais tellement conditionnée que j’avais besoin de me sentir désirée, et notamment par des hommes puissants ou que j’admirais, pour être en confiance. Même avec mon mari… Au départ, je pense que je cherchais mon père en lui.

Pourtant, vous étiez déjà une musicienne accomplie, très connue, sans doute bien plus que lui l’était dans son métier…
Oui, c’est bizarre. En plus, lorsque j’évoquais mon attirance pour les femmes, mes amis me disaient toujours que j’étais probablement plus lesbienne que bisexuelle. Donc, pendant mes vingt-deux ans de mariage, et même si j’étais restée fidèle à mon mari, je m’étais toujours dit que si je franchissais le pas, je serais sans doute totalement lesbienne. Au fond de moi, je savais que je ne pourrais pas assouvir mes désirs en sortant ponctuellement avec des femmes bisexuelles. J’avais conscience d’être une goudou et j’étais prête à l’assumer.
La chanson Let Me Forget est particulièrement impressionnante sur le disque. S’agit-il, pour vous, une façon d’affirmer votre besoin d’oublier votre ancienne vie ?
Oui, dans un sens… Mais c’est aussi une façon de dire à ma muse : « Maintenant que tu m’as permis d’accomplir tout ce travail et d’entrer dans une nouvelle phase de ma vie, laisse-moi t’oublier et vivre au mieux cette nouvelle vie. » Et, lorsque j’ai commencé le disque, j’ai fait des changements dans mon mariage et j’ai commencé à passer de plus en plus de temps à Londres, puis à entamer une relation avec une femme et, quand l’album a été terminé, j’ai rencontré la femme avec qui je vis actuellement.
 Sur ce nouvel album, les arrangements sont très impressionnants, presque baroques ; même votre façon de chanter semble très différente de ce qu’elle était jusque-là. En fait, c’est comme si cette nouvelle vie vous avait aussi conduite vers une autre incarnation musicale. Bref, je me demandais si toute cette emphase et tout ce lyrisme avaient été imposés par le contenu des chansons ou s’ils étaient liés à ce que vous écoutiez.
Sur ce nouvel album, les arrangements sont très impressionnants, presque baroques ; même votre façon de chanter semble très différente de ce qu’elle était jusque-là. En fait, c’est comme si cette nouvelle vie vous avait aussi conduite vers une autre incarnation musicale. Bref, je me demandais si toute cette emphase et tout ce lyrisme avaient été imposés par le contenu des chansons ou s’ils étaient liés à ce que vous écoutiez.
J’ai écouté énormément de musique classique pendant la préparation de cet album. Je pensais à ce disque, et surtout à ma vie, et je marchais pendant des heures dans Los Angeles avec de la musique classique plein les oreilles. J’ai beaucoup écouté Brahms, Ravel, Debussy, John Williams, mais je me suis aussi replongée dans les premiers Scott Walker. Au final, les chansons ont fini par prendre très naturellement une dimension presque cinématique.
L’album m’a aussi rappelé Both Sides Now (4), un disque tardif de Joni Mitchell sur lequel elle reprenait certains standards, accompagnée par un grand orchestre.
Je ne connais pas cet album, mais j’adore la version de Both Sides Now qui en est extraite. C’est vraiment une version incroyable…
Page of Cups rappelle vraiment le style de compositions de Joni Mitchell.
Oh, merci ! En fait, j’adore Joni, mais je m’aperçois que je l’écoute finalement assez peu. Je la trouve absolument géniale, mais j’ai toujours du mal à trouver mon chemin dans ses disques. Son génie a quelque chose d’écrasant, donc je l’écoute rarement. Je suis consciente de mes limites et je sais, quand j’écoute ses chansons, que c’est au-dessus de mes capacités.
Une question complètement anecdotique… J’ai découvert tardivement que vous étiez l’auteure de A Good Heart (5), une chanson qui fut un tube pour Feargal Sharkey au milieu des années 80. A l’époque, vous étiez encore très jeune, le premier album de Lone Justice venait à peine de sortir, donc comment cette chanson s’était elle retrouvée dans les mains de l’ex-chanteur des Undertones ?
J’étais incroyablement jeune lorsque j’ai écrit cette chanson. Je n’avais que 18 ans ! Et le plus fou, c’est que je vis encore sur ses royalties ! En fait, Dave Stewart, qui a produit le single, était ami avec Jimmy Iovine, qui était mon producteur et manageur. Bref, je ne me souviens plus des détails, mais Dave Stewart était à Los Angeles et je leur avais fait écouter cette chanson que je venais d’écrire pour Lone Justice, mais Jimmy n’était pas emballé. A l’inverse, Dave Stewart avait tout de suite dit : « Tu es dingue ! C’est un numéro 1 ! » Donc il a pris la chanson avec lui et, quand il est rentré en Angleterre et il l’a enregistrée avec Feargal Sharkey. Et quand la chanson est devenue numéro 1, j’ai dit à Jimmy : « Tu vois ? Je te l’avais bien dit que c’était un numéro 1 ! » En fait, le single a été numéro 1 un peu partout, mais pas aux États-Unis.
Votre album You Gotta Sin to Get Saved en 1992 avait réuni la crème de la scène americana naissante, avec les membres des Jayhawks en invités, George Drakoulias aux manettes… Ce disque est un classique du genre !
Oui, je le pense aussi. Pour moi, il est même plus réussi que les disques de Lone Justice.
Quand vous repensez à ces années, à vos débuts en solo, mais aussi à Lone Justice, n’avez-vous pas l’impression que certaines choses sont arrivées trop vite dans votre vie et que vous aviez trois ou quatre ans d’avance sur l’époque ?
Oui, ça c’est certain. Et ça a continué plus tard. Par exemple, lorsque j’ai entendu Anna Calvi pour la première fois j’ai tout de suite pensé à Life Is Sweet. Mais qui l’a vraiment relevé ?
Quels artistes écoutez-vous aujourd’hui ? Est-ce que vous aimez Josephine Foster, par exemple ?
Ah oui, elle je l’adore ! Actuellement, mon artiste préférée est Lauren Auder. Nous avons chanté ensemble, à Londres, fin novembre. Elle m’a accompagnée sur une reprise de Orange Skies de Love. Elle a 21 ans, elle est absolument géniale, mais elle est aussi un peu comme ma fille spirituelle, donc je ne suis pas certaine d’être objective. J’aime aussi Billie Eilish, Lana Del Rey… Sinon, j’aime aussi beaucoup Roselit Bone, un groupe de Portland qui fait une sorte de country gothique très cinématique. La chanteuse, Charlotte McCaslin, est une grande fan du Gun Club, de Roy Orbison et de Marty Robbins. Elle est aussi queer et c’est une amie à moi. Je ne rate jamais ses concerts.
La Vita Nuova de Maria McKee est sorti le 13 mars chez Afar Records.
(1) Maria McKee, You Gotta Sin to Get Saved (Geffen, 1993). (2) Chanteur-guitariste de Love, auteur de chansons aussi mémorables que Old Man, Softly to Me et surtout, l’inoubliable Alone Again Or. (3) Maria McKee, Life Is Sweet (Geffen, 1996). (4) Joni Mitchell, Both Sides Now (Reprise, 1999). (5) Sorti en septembre 1985, A Good Heart sera le plus grand succès solo de l’ancien chanteur des Undertones. Produit par Dave Stewart d’Eurythmics, il sera numéro 1 en Angleterre, en Irlande, en Australie, en Belgique et un grand succès dans de nombreux pays d’Europe.



Certainement son meilleur album, personnellement.
Dire qu’en 1985, je croyais vraiment que Lone Justice venait de la cambrousse…!
Ben oui à l’époque, pas internet … Je les avait découvert aux Enfants du Rock… j’ai accroché tout de suite … et j’ai jamais décroché depuis.
C’est vrai que cette livraison inespérée, c’est de l’or en barre