
Six ans après le très sobrement nommé Sylvie, un premier album qui avait fait forte impression, Sylvie Simmons ressort son ukulélé (!) et présente Blue on Blue, un deuxième LP qui semble l’installer enfin comme une chanteuse à part entière, et plus seulement comme une “journaliste ayant enregistré un disque”. Mais, derrière cette réussite, il y a également l’histoire d’une gestation très mouvementée et marquée, notamment, par un grave accident, par une interruption de deux ans dans le processus d’enregistrement et, surtout, par l’idée que ce disque a vraiment failli ne jamais voir le jour.
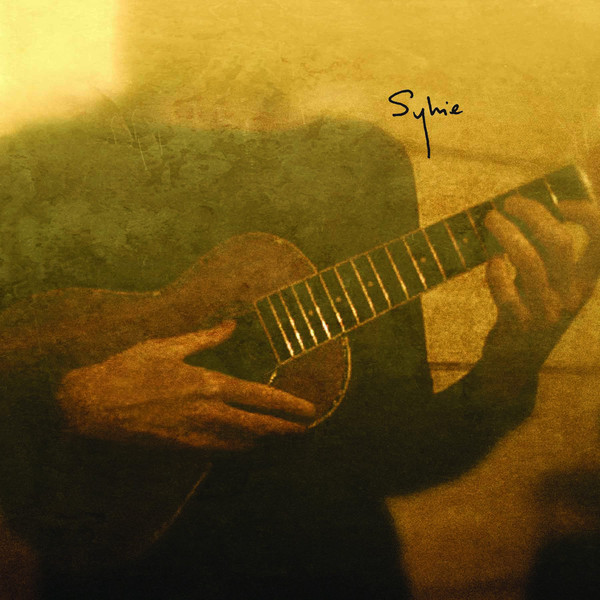 En 2014, le premier album de Sylvie Simmons avait fait l’effet d’une double surprise. D’abord, parce que personne ne s’attendait vraiment à ce que cette journaliste-vedette de Mojo, passée par la plupart des grands titres de la presse anglo-saxonne depuis la fin des années soixante-dix (Creem, Sounds, Kerrang, Mojo, donc…), ayant interviewé à peu près tout le monde, de Johnny Cash à Michael Jackson, en passant par Neil Young, Brian Wilson ou Lou Reed, et largement reconnue pour ses talents de biographe (son monumental I’m Your Man : The Life of Leonard Cohen a déjà fait l’objet de près d’une trentaine de traductions), décide de se lancer dans une carrière de chanteuse. Et ensuite, surtout, parce que personne ne s’attendait à ce que le disque en question soit si réussi, perché quelque part entre l’atemporalité des ballades de Brenda Lee ou de Patti Page et la déglingue romantique des albums de Tom Waits. Enregistré sous le parrainage malin du toujours impeccable Howe Gelb et sorti sur le prestigieux catalogue de Light in The Attic, Sylvie bravait donc la vieille légende selon laquelle les journalistes de rock seraient forcément des aspirants musiciens, ou des musiciens frustrés, pour suggérer qu’à défaut d’être une journaliste s’étant tardivement découvert des talents de chanteuse, cette Anglaise exilée en Californie depuis plus de quarante ans (avec deux longues parenthèses européennes, l’une en Angleterre et l’autre en France) avait peut-être surtout été une musicienne qui s’était trop longtemps bridée, ou ignorée.
En 2014, le premier album de Sylvie Simmons avait fait l’effet d’une double surprise. D’abord, parce que personne ne s’attendait vraiment à ce que cette journaliste-vedette de Mojo, passée par la plupart des grands titres de la presse anglo-saxonne depuis la fin des années soixante-dix (Creem, Sounds, Kerrang, Mojo, donc…), ayant interviewé à peu près tout le monde, de Johnny Cash à Michael Jackson, en passant par Neil Young, Brian Wilson ou Lou Reed, et largement reconnue pour ses talents de biographe (son monumental I’m Your Man : The Life of Leonard Cohen a déjà fait l’objet de près d’une trentaine de traductions), décide de se lancer dans une carrière de chanteuse. Et ensuite, surtout, parce que personne ne s’attendait à ce que le disque en question soit si réussi, perché quelque part entre l’atemporalité des ballades de Brenda Lee ou de Patti Page et la déglingue romantique des albums de Tom Waits. Enregistré sous le parrainage malin du toujours impeccable Howe Gelb et sorti sur le prestigieux catalogue de Light in The Attic, Sylvie bravait donc la vieille légende selon laquelle les journalistes de rock seraient forcément des aspirants musiciens, ou des musiciens frustrés, pour suggérer qu’à défaut d’être une journaliste s’étant tardivement découvert des talents de chanteuse, cette Anglaise exilée en Californie depuis plus de quarante ans (avec deux longues parenthèses européennes, l’une en Angleterre et l’autre en France) avait peut-être surtout été une musicienne qui s’était trop longtemps bridée, ou ignorée.
<a href= »http://sylviesimmons.bandcamp.com/album/sylvie »>Sylvie by Sylvie Simmons</a>
Aujourd’hui, Sylvie Simmons revient avec Blue on Blue, un superbe deuxième album imprégné de mélancolie californienne, dans une évocation (le bleu des tourments qui se confond avec celui de l’océan, ndA) digne des Beach Boys de l’époque Surf’s Up (1971), mais qui, surtout, en plus de valider complètement son nouveau statut de chanteuse (puisque, grâce à lui, son premier LP Sylvie devient le début d’une véritable discographie et n’est plus un simple one-shot), semble la faire grandir un peu plus en tant que songwriter. C’est, en tout cas, ce que suggèrent des titres comme Keep Dancing, une ballade pleine de grâce et aux airs de standard atemporel, où il est question de danser les pieds nus sur des morceaux de verre brisé (« The man said you were dancing / With no shoes on amid the broken glass »), Carey’s Song, une ballade en apesanteur et subtilement mélancolique que la chanteuse a dédié à l’un de ses amis californiens, également amateur de ukulélé, voire comme le très pimpant 1000 Years Before I Met You, chanté en duo avec l’impayable Howe Gelb et dont les airs de classique country rappellent inévitablement les merveilleux duos de Nancy Sinatra et Lee Hazlewood.
Le coquelicot qui dépasse

Interrogée par téléphone, Sylvie Simmons répond depuis son appartement de San Francisco, où elle s’est installée il y a une quinzaine d’années. Très naturellement, elle commence par évoquer l’idée du passage à l’acte et le long cheminement qu’il lui a fallu pour dépasser sa timidité naturelle, oublier temporairement sa carrière de journaliste et prendre enfin conscience de ce qu’allait impliquer sa décision de se présenter non seulement comme une chanteuse, mais aussi comme l’auteure de ses propres chansons. « Je crois que lorsque j’ai enregistré mon premier album, il y avait chez moi une forme d’insouciance, mais aussi de déni, qui m’empêchait de voir ce qu’allait impliquer le fait de sortir ce disque. En gros, comme beaucoup d’Anglais, je suis, d’instinct, assez mal à l’aise avec l’idée de sortir du lot. Un jour, Leonard Cohen m’avait dit que, comme lui, je devais être très méfiante à l’idée de me retrouver dans la position du “coquelicot qui dépasse”, celle de la personne qui se fait remarquer par sa taille au milieu de la pièce. Je pense qu’il avait raison… Bref, ce n’était que lorsque Light In The Attic avait commencé à annoncer la sortie de mon album que j’avais réellement pris conscience de ce qui se profilait et du fait que c’était vraiment moi qui allait me retrouver au centre de l’attention. » Pour la première fois de sa vie, Sylvie Simmons allait donc tenir le rôle de la chanteuse dont on allait disséquer l’album et plus seulement dans celle de la journaliste qui cherche à comprendre le disque en question et à raconter une histoire. « Très vite, je m’étais retrouvée partagée entre, disons, un certain amusement et une forme de terreur, car je connaissais parfaitement tous les clichés auxquels je m’exposais, ceux qu’on associe aux journalistes de presse musicale qui se mettent à enregistrer des disques. Et je savais que je m’y exposais d’autant plus que ce changement arrivait, pour moi, dans la cinquantaine. Bien sûr, j’avais en tête les exemples de Patti Smith et de Chrissie Hynde (également journalistes de rock au départ, ndA) qui avaient eu le même cheminement et pour qui cela s’était bien passé, mais, chez elles, cette évolution s’était aussi produite bien plus tôt. Finalement, le disque était sorti et je dois reconnaître que j’avais été vraiment ravie et étonnée de le voir si bien reçu. Je me souviens notamment de la critique du Guardian qui avait écrit quelque chose comme : “Vous avez toutes les raisons de détester ce disque, il a été réalisé par une journaliste de rock qui joue du ukulélé, et pourtant il s’agit bien de l’un des meilleurs albums que vous entendrez cette année”. Que dire de plus ? »
A cette époque, Sylvie Simmons commençait tout juste à travailler sur les mémoires de Debbie Harry, livre qu’elle a co-signé avec la chanteuse. « J’avais repris mon activité de journaliste et d’auteure, notamment pour travailler avec Debbie Harry, mais, dans le même temps, je continuais aussi à écrire des chansons, à jouer du ukulélé quotidiennement, etc. Il y avait vraiment une forme d’insouciance ; je ne me disais jamais que cette activité allait devenir ma deuxième carrière. En même temps, si je prenais un minimum de recul, j’étais bien obligée de voir que je faisais tout pour qu’elle le devienne. »
Pour Sylvie Simmons, ce refus d’envisager cette nouvelle activité comme le début d’une nouvelle carrière s’était même prolongé bien au-delà du raisonnable et, en l’occurence, jusqu’au premier jour d’enregistrement de son deuxième album. « Je me souviens que, même lorsque nous avions commencé à enregistrer les premières chansons de Blue on Blue, je ne parvenais toujours pas à me dire que j’étais en train de concrétiser l’idée de faire de cette nouvelle activité une véritable carrière. En fait, je crois que je repoussais surtout, vraiment, l’idée d’en faire “ma” carrière ! »
Une journée particulière

Pour la chanteuse, ce premier jour d’enregistrement sera spécialement mémorable, puisque la moitié de son deuxième album sera enregistré en quelques heures et une seule session. Mais il le sera aussi parce que la journée s’achèvera de façon dramatique, sur un terrible accident. « Le premier jour d’enregistrement du deuxième album avait été très particulier. Je me souviens que Howe avait éclaté un pneu de sa Plymouth Barracuda en venant me chercher, le matin. Il y avait eu beaucoup d’accidents, ce jour-là… » Contrairement à leurs habitudes, les musiciens avaient décidé de ne pas enregistrer au studio Wave Lab, ce jour-là. « Gabriel Sullivan, qui joue dans Giant Sand et qui a aussi son propre groupe, Xixa, nous avait emmené dans le studio de Winston Watson, le batteur de Giant Sand. C’était une sorte de garage aménagé, un endroit minuscule où il était difficile de s’isoler du reste du groupe. C’était complètement du studio Wave Lab, où nous avions enregistré le premier album ! » Heureusement, le groupe s’était avéré très inspiré et efficace. « Nous avions beaucoup enregistré, ce jour-là. Gabriel découvrait tout juste les chansons. Moi-même, je n’avais fait qu’une mise en place rapide, la veille, avec Howe. Au départ, nous devions juste enregistrer une ou deux bricoles et voir celles qui passaient le mieux, mais nous avions fini par faire bien plus que cela. Presque la moitié du disque avait été enregistrée ainsi, en quelques heures. »
Le monde d’après
A la suite de cet accident, Sylvie Simmons se retrouve avec de graves blessures à la main gauche et l’effrayante perspective de, peut-être, finir par perdre l’usage de celle-ci. « La période qui a suivi l’accident a été très compliquée pour moi, à tous les niveaux. J’ai quand même eu douze opérations… Bien sûr, j’étais très angoissée à l’idée de, peut-être, ne plus jamais retrouver l’usage de ma main gauche, mais je me retrouvais aussi dans tout un tas de complications qui touchaient aussi mon activité d’auteure et, plus particulièrement, le livre sur lequel je travaillais. Subitement, j’avais l’impression que tout devenait un combat dans ma vie. C’était tellement oppressant que j’avais littéralement l’impression de vivre dans un immense film d’horreur. »
Alors qu’elle est en pleine rééducation de sa main, Sylvie Simmons commence pourtant à ressentir le besoin de composer de nouvelles chansons. « J’avais besoin de rejouer, d’abord sur une corde, puis sur deux, mais j’étais surtout décidée à me remettre à écrire, car je il m’était devenu impossible de jouer comme avant. Même les titres que nous avions enregistrés le premier jour étaient devenus trop compliqués pour moi. Par exemple, je n’étais pas très satisfaite de l’intro de Waiting for the Shadows to Fall ; je voulais la réenregistrer, mais je n’étais plus en mesure de jouer ce que j’avais en tête. » Pour cette brève intro, le problème sera finalement résolu par l’intervention salutaire de son vieil ami Jim White, auteur du mémorable Wrong-Eyed Jesus (Luaka Bop, 1997). « Jim avait pris les choses en main et s’était mis à enregistrer de nouvelles intros, toutes excellentes, depuis le porche de sa maison. Au final, il en aura quand même enregistré une quarantaine. En fait, c’est un tel perfectionniste qu’il n’était jamais satisfait et s’entêtait à enregistrer de nouvelles prises. » Mais cette difficulté de la chanteuse à retrouver toutes ses capacités manuelles aura aussi pour conséquence de l’obliger à composer des morceaux plus simples. « J’avais besoin de composer des titres que je puisse jouer sans difficulté. Sweet California est, par exemple, une chanson que j’ai écrite en m’efforçant de jouer avec seulement deux doigts ! »
Finalement, ce besoin de rejouer, de se réinventer et de se relever au plus vite du cauchemar de l’accident l’aura aussi conduite vers un impératif majeur : terminer son deuxième album. Et ce qui, jusque-là, n’avait été qu’une activité annexe et relativement légère deviendra, du même coup, l’objet d’une véritable lutte.
Retour en studio
Deux ans après la première journée d’enregistrement, Sylvie Simmons et Howe Gelb se retrouvent à nouveau en studio, cette fois pour terminer le disque. En l’évoquant, la chanteuse se souvient notamment de la réalisation du morceau Creation Day. « En terminant ce morceau, j’avais dit à Howe que je voulais qu’il soit un peu comme un titre de Pink Floyd, qu’il emmène l’auditeur dans une sorte voyage sonore qui, par exemple, puisse lui donner l’impression d’assister à quelque chose comme de la naissance de l’univers. Bien sûr, c’était une blague, mais je tenais à ce que ce titre puisse afficher cette extravagance. Et, par chance, le studio Wave Lab avait beaucoup de vieux synthétiseurs à disposition, donc nous nous étions beaucoup amusés à choisir le son qui était le plus approprié. » Dans le même ordre d’idée, la chanteuse se souvient aussi de l’enregistrement de The Man Who Painted the Sea Blue. « C’était le dernier jour des sessions. J’avais décidé d’inviter Brian Lopez à se joindre à nous. Brian est un guitariste génial et il avait le son que je recherchais pour The Man Who Painted the Sea Blue. C’était une chanson qui nécessitait une séquence de rêverie un peu naïve, mais aussi ample et généreuse. Bref, j’avais dit à Brian que je voulais qu’il joue un solo comme s’il s’était retrouvé sur la plage, au coucher du soleil, après que tout le monde soit parti. Et, en une prise, Brian avait réussi le solo parfait. »
Une œuvre scindée en deux
L’une des plus sérieuses réussites de Sylvie Simmons et Howe Gelb sur Blue on Blue est d’être parvenus à dégager une œuvre cohérente et parfaitement homogène d’un enregistrement tout à fait chaotique et basé sur deux sessions réalisées à deux ans d’intervalle. Curieusement, ce gouffre de deux années, qui aurait fait imploser n’importe quel autre projet d’album, ne semble pas avoir été un problème pour la chanteuse. « C’est très étrange, et sans doute lié au fait que tout cela était un peu nouveau pour moi, mais j’ai toujours eu l’impression que ce disque se fabriquait dans une sorte de bulle sur laquelle le temps n’avait pas de prise. Ainsi, tant qu’il n’était pas terminé, la bulle restait là, prête à accueillir de nouvelles chansons. Je savais que le processus global était ralenti à cause de mon accident, donc je me disais que tout ce que j’avais à faire c’était écrire de nouvelles chansons et voir si elles pouvaient trouver leur place dans cette bulle. En fait, comme pour les mémoires de Debbie Harry, j’étais obligée d’être patiente, car tous les délais étaient très longs. Or si je ne suis pas vraiment la personne la plus patiente du monde dans ma vie personnelle, je dois dire que j’ai appris à l’être dans mon métier. »
Evoquant la structure générale de Blue on Blue, Sylvie Simmons explique : « J’ai toujours pensé ce disque comme un album vinyle ; pour moi, la première face reprend ce que nous avions enregistré lors de notre première session, juste avant l’accident, et la deuxième rassemble ce que nous avons enregistré deux ans plus tard. » Puis elle se souvient : « Le premier jour, nous avions enregistré Keep Dancing, Nothing, Not in Love… Ces chansons sont restées telles qu’elles avaient été enregistrées, ce jour-là. Nothing avait même été réalisé en une seule prise, il me semble. Creation Day avait aussi été enregistré ce jour-là, mais les musiciens n’étaient pas tout à fait en place sur ce titre et j’ai donc dû le retravailler, plus tard, en studio, avec un ingénieur du son, mais aussi avec Howe Gelb, deux ans plus tard. »
Autre perle de cette première face, la chanson The Thing They Don’t Tell You About Girls intrigue par le contraste qui peut exister entre la légèreté amusée de la musique et la noirceur insistante de ses paroles. « Pour moi, c’est un peu la chanson-clé de ce disque. En fait, c’est un titre que j’ai écrit dans une période de profonde dépression, bien avant l’accident, et je l’avais abordé comme une façon de relever la tête, de désamorcer mes envies de suicide avec un peu de légèreté. » Pour bien mesurer cet étrange contraste, il faut, par exemple, entendre la légèreté piquante avec laquelle Sylvie Simmons chante : « Since you’re gone, I keep away from bridges, trains and razor blades » (« Depuis que tu es parti, je me tiens à distance des ponts, des trains et des lames de rasoirs. »). La chanteuse, elle, n’hésite pas à s’en amuser : « Ce vers me fait rire. Il est tellement exagéré ! Mais c’était aussi ce que je recherchais : je voulais faire en sorte de pousser ma dépression et mes angoisses dans une exagération telle qu’elles ne puissent plus que conduire à une forme de dédramatisation. »
Il reste que ces jeux de contrastes ne seraient sans doute pas les mêmes sans la légèreté naturelle de la voix de Sylvie Simmons. Pourtant, la chanteuse rejette toute idée d’un recours à une forme d’ironie, ou de distance amusée, dans sa musique. « Ma voix est ce qu’elle est. J’ai toujours chanté comme ça. Je crois que si j’avais voulu jouer avec ce qu’elle peut avoir de léger en explorant des sujets graves, j’aurais probablement creusé une voie proche de celle qu’emprunte Joanna Newsom, par exemple. Or j’ai tendance à trouver cela un brin artificiel. Pour moi, il était surtout essentiel de rester proche de ce que je suis et de mes émotions. Je voulais que ce disque vienne de mon âme. » Puis elle raconte : « Cette façon très innocente de chanter est aussi un leurre, car les gens finissent par moins faire attention aux mots que j’emploie. Par exemple, sur le premier album, personne n’a jamais relevé que, dans ma reprise de Rhythm of the Rain, le tube des Cascades, j’avais changé le texte pour, à un moment donné, chanter : “The motherfucker took my heart” (« Le fils de pute m’a pris mon cœur »). »
Les parrains

Sylvie Simmons avait toujours évolué dans un monde d’hommes. Grâce à son talent et à sa ténacité, elle était parvenue à se faire une place de choix dans le milieu très masculin de la presse musicale anglo-saxonne, mais pour la musique, c’était une autre histoire. La question du passage à l’acte était un obstacle majeur et la chanteuse raconte, elle-même, qu’elle a pu profiter de l’attention et des encouragements de quelques parrains illustres. « Je crois que je n’aurais probablement pas enregistré mon premier album sans l’influence, l’amitié et la bienveillance de Leonard Cohen et Howe Gelb. Il faudrait aussi citer Bob Johnston(producteur de Columbia, responsable de la réalisation d’albums légendaires de Bob Dylan, Leonard Cohen ou Simon & Garfunkel, notamment, ndA), avec qui j’étais devenue amie dans les dernières années et qui voulait absolument produire mon premier album (Johnston est mort en 2015, ndA). »
Pour elle, le déclic a eu lieu au cours de sa tournée de rencontres pour son livre sur Leonard Cohen. « Pendant la tournée de rencontres qui avait suivi la parution de I’m Your Man, je m’étais dit qu’il serait sans doute plus sympathique d’accompagner mes lectures d’une ou deux interprétations chansons de Leonard au ukulélé, plutôt que de ne proposer que de simples lectures et de répondre à des questions. Pour moi, c’était aussi une façon de vaincre ma timidité naturelle. Bizarrement, cela me semblait moins terrorisant d’interpréter des chansons de Leonard Cohen devant des inconnus que de lire à haute voix des passages de mon livre. J’ai donc fait ça pendant un peu plus d’un an et demi, parvenant peu à peu à vaincre mon angoisse de la scène. Dans le même temps, je continuais à écrire mes chansons dans mon coin. De son côté, Howe Gelb suivait mon travail depuis plusieurs années, me demandant toujours où j’en étais avec mes compositions. A cette époque, nous nous voyions assez régulièrement, lorsqu’il passait à San Francisco avec Giant Sand. Et puis, un jour, il m’avait invitée à les rejoindre, lui et son groupe, sur scène, lors d’un concert à Tucson. C’était ce qui m’avait permis de me décider à aller au bout de ma démarche et à enregistrer mon premier disque. » Cette collaboration avec Howe Gelb, qui dure depuis plusieurs années et a déjà débouché sur deux beaux albums, est très précieuse pour Sylvie Simmons. « Il y a beaucoup de confiance mutuelle entre nous. Dans un sens, cela m’étonne un peu, car Howe est quand même bien plus expérimenté que moi, mais c’est aussi très flatteur. Et puis, le fait est que cela simplifie grandement les prises de décisions ! » Puis elle précise : « Je crois que Howe a compris que, du fait de ma voix et du son très léger de mon ukulélé, mes chansons avaient souvent besoin d’un peu de solidité, d’éléments plus graves permettant de mieux les structurer. C’est, par exemple, ce qu’il a fait avec ce solo de cloche qu’il a imposé au milieu de The Thing They Don’t Tell You About Girls. C’était, à la fois, totalement saugrenu et parfaitement bien senti par rapport à la tonalité générale du morceau. » Au sujet de cette dernière chanson, Sylvie Simmons ajoute : « Lorsque nous l’avions enregistré, c’était presque une forme d’échauffement, mais le groupe avait tout de suite senti le truc et s’était transformé en une sorte d’orchestre de carnaval, avec Howe au piano, s’appliquant à retrouver l’esprit des accompagnements de vieux films muets. »
Au pays des chansons tristes
Depuis qu’elle s’est mise à composer ses propres chansons, Sylvie Simmons a changé de perspective et vraiment approfondi sa réflexion sur le songwriting. « Avant, lorsque des artistes m’expliquaient en interview que les chansons flottaient dans l’air et qu’ils se contentaient de les attraper, je me retenais toujours de rouler les yeux, mais, depuis que je me suis mise à en écrire moi-même, j’ai complètement changé d’avis. Et le fait est que je ne sais pas du tout d’où elles viennent. Par exemple, la chanson Nothing est très mystérieuse pour moi, puisqu’elle se focalise sur la réminiscence de souvenirs qui ne sont pas les miens. Honnêtement, même quand j’y réfléchis, je ne sais pas du tout d’où viennent les souvenirs et situations relatés dans cette chanson. « When I was a child I played hide and seek / I forgot that you were gone, etc » (« Quand j’étais enfant, je jouais à cache-cache / J’oublias que tu était parti, etc »)… Je ne sais pas du tout de qui parle cette chanson, ni à quoi elle fait référence ! Ce qui est étrange, c’est que les scènes et visions sont très précises, alors que je ne sais pas du tout d’où elles viennent ! » Puis, la chanteuse explique : « J’ai souvent l’impression que lorsque j’écris des chansons je deviens une personne entièrement différente de celle qui écrit sur la musique. Bien sûr, c’est absurde, car depuis le temps que j’écris sur la musique, que j’essaye de comprendre ce qui se joue dans les enregistrements, j’ai forcément développé des connaissances et une compréhension de la musique qui finissent par me servir lorsque j’écris. Mais, c’est comme ça, quand je suis dans mes chansons, je perds toute distance et toute réflexion critique et, souvent, je me retrouve à m’étonner de mes propres chansons, en me demandant d’où elles ont bien pu venir, etc. Bien sûr, si elles me semblent familière, c’est aussi parce qu’elles viennent de moi, mais je crois que le processus d’écriture demeure très mystérieux. En gros, mes doigts jouent des accords, ils se placent naturellement sur les cordes du ukulélé et, ensuite, une mélodie me vient en tête et, si j’ai de la chance, je sais très vite où doit aller la chanson. Parfois, la chanson est écrite en une seule journée, parfois il me faut plus de temps pour trouver les mots et comprendre ce qu’elle doit raconter, mais le processus reste très étrange. » Pour préciser son explication, Sylvie Simmons évoque la chanson Carey’s Song. « C’était un titre que j’avais composé pour mon premier album, mais, à l’époque, je ne parvenais pas à trouver les paroles. Tout ce que j’avais en tête, c’était de proposer à l’un de mes amis, qui se prénomme Carey et qui joue du ukulélé, de jouer dessus. Et puis, cette mélodie est restée inutilisée pendant plusieurs années, jusqu’à ce que je décide d’en faire une chanson. Au final, j’ai beaucoup brodé autour de cette relation, mais j’ai sans doute été plus inspirée par la chanson Carey de Joni Mitchell que par cet ami, Carey. Cela dit, cette chanson porte son nom et avait toujours été un peu associée à lui dans mon esprit, donc… »
Et si la mélancolie plus ou moins douce semble être une constante dans son écriture, Sylvie Simmons reconnaît qu’elle n’est pas vraiment nouvelle dans son rapport à la musique. « Je crois que j’ai toujours eu un faible pour les chansons tristes. Déjà, lorsque j’étais enfant, lorsque je m’achetais des 45 tours avec mon argent de poche, je me précipitais toujours sur la face B, car c’était généralement là que se trouvait la chanson triste. » Puis elle ajoute : « En règle générale, j’ai toujours eu un faible pour les chansons sombres et ténébreuses dans lesquelles se reflète l’âme des artistes. D’évidence, je suis bien plus touchée par une chanson de blues que par une autre qui va chercher à me faire danser. Et je crois que c’est aussi ce qui m’a fait aimer des artistes comme Hank Williams ou Patsy Cline, voire la country dans son ensemble. Je crois cela a toujours été dans ma personnalité et qu’ensuite cela s’est consolidé et affiné au fil des années et des expériences. Même lorsque j’écris de la poésie, je suis naturellement portée vers, disons, une forme de solennité et de tristesse. C’est d’autant plus étrange que, d’ordinaire, je suis plutôt quelqu’un qui aime rire, s’amuser et sourire. Mais c’est comme ça… »
Dans sa vie personnelle, Sylvie Simmons a aussi été mariée pendant dix ans à un songwriter. « Il passait ses journées à composer, donc je peux dire que j’ai aussi été familiarisée à l’écriture des chansons. » Mais, pour elle, la tentation de s’exprimer à travers l’écriture de chansons avait commencé longtemps auparavant. « Je crois que les chansons sont toujours une combinaison des rêves que l’on a faits, des expériences que l’on a pu vivre, des gens que l’on a rencontrés, etc. Récemment, j’ai repensé aux chansons que j’avais essayé d’écrire lorsque j’étais adolescente. A l’époque, je n’avais pas de sagesse, pas d’expérience, et toutes mes paroles étaient impersonnelles et inspirées par des lectures qu’on m’avait plus ou moins imposées comme les livres de Hermann Hesse. Le résultat était horrible. En fait, ce n’est que bien plus tard que je me suis mise à écrire des chansons plus personnelles, avant de trouver, peu à peu, ma propre voie. »
Heureusement, l’expérience et la pratique lui auront surtout appris à se focaliser sur l’authenticité des émotions qu’elle cherche invariablement à transmettre à travers l’écriture. « Je crois que pour qu’une chanson soit vraiment réussie, le plus important est de savoir transmettre, et préserver, l’authenticité de l’émotion qui se trouvent à sa source. Je me souviens, par exemple, que lorsque j’écoutais Radio Free Europe de R.E.M., au début des années quatre-vingt, je n’avais pas la moindre idée de ce dont parlait Michael Stipe, mais, en même temps, il y avait quelque chose dans cette chanson qui faisait que je savais qu’elle était authentique, qu’elle sonnait juste et, surtout, qu’elle était absolument sincère. »
Magie du ukulélé
Enfin, Sylvie Simmons est aussi l’une des artistes à avoir le mieux exploité les ressources musicales du ukulélé, ce modeste instrument qui, pourtant, a permis aux plus grands de faire leurs premiers pas de compositeurs. « Je crois que le fait de jouer du ukulélé, avec ses quatre cordes et son nombre très limité d’accords possibles, oblige à trouver des mélodies vraiment convaincantes. En fait, on ne peut pas tricher avec cet instrument. Normalement, dans le rock, vous pouvez toujours construire une chanson sur un son de guitare précis ou sur celui d’un synthétiseur, mais là, avec le ukulélé, c’est impossible : tout ce que vous avez c’est la chanson elle-même. En tout cas, c’est mon avis… Joni Mitchell, les Beatles et Jason Molina ont aussi commencé en jouant du ukulélé. Comme quoi, on peut écrire des chansons fabuleusement complexes tout en ayant commencé avec le plus simple des instruments ! »
Sorti il y a quelques semaines, après plusieurs années de lutte, Blue on Blue est aussi, pour Sylvie Simmons, le début d’une nouvelle aventure, puisque le label Compass s’est déjà engagé avec elle pour son troisième album. « J’ai déjà cinq chansons de prêtes pour le prochain disque. Je les avais écrites pour Blue on Blue, mais mes doigts n’étaient pas encore assez agiles pour que je puisse les jouer. Donc je les ai mises de côté en attendant que ça s’améliore. »


