
The dB’s est toujours apparu comme un groupe interstitiel, de ceux dont l’œuvre, considérablement sous-estimée pendant bien des décennies, se niche dans ces anfractuosités confidentielles qui échappent à bien des classifications réductrices : entre les genres – ni totalement punk ou new-wave, ni vraiment power-pop ; entre les époques ou les scènes. C’est sans doute ce qui a conféré au quartette fondé à New-York en 1978 par Chris Stamey et Peter Holsapple ce statut un peu particulier. Un groupe culte, sans doute. Mais surtout, un maillon essentiel dans la succession des générations qui structure l’histoire de la musique américaine. C’est en effet dans les premiers albums des dB’s – et particulièrement dans les premières démos du groupe, saisissantes de vitalité, rééditées cet automne sur I Thought You Wanted To Know 1978-1981 – que se trouvent à la fois les prolongements du garage-rock des années 1960 et de ces mélodies qui ont surgi sous les doigts d’adolescents encore sous le choc de la British Invasion et les prémisses de l’indie-rock des années 1980. Après avoir contribué à briser quelques barrières, Holsapple et ses camarades se sont fait déborder ensuite – avec une complaisance confraternelle souvent appréciable – par les jeunots qui se bousculaient sur leurs traces de R.E.M. à Yo La Tengo. Il ne leur en tient aucun grief, bien au contraire. Et c’est avec une bonhomie enjouée qu’il accepte de revenir sur un engagement musical qui s’étale désormais sur six décennies.
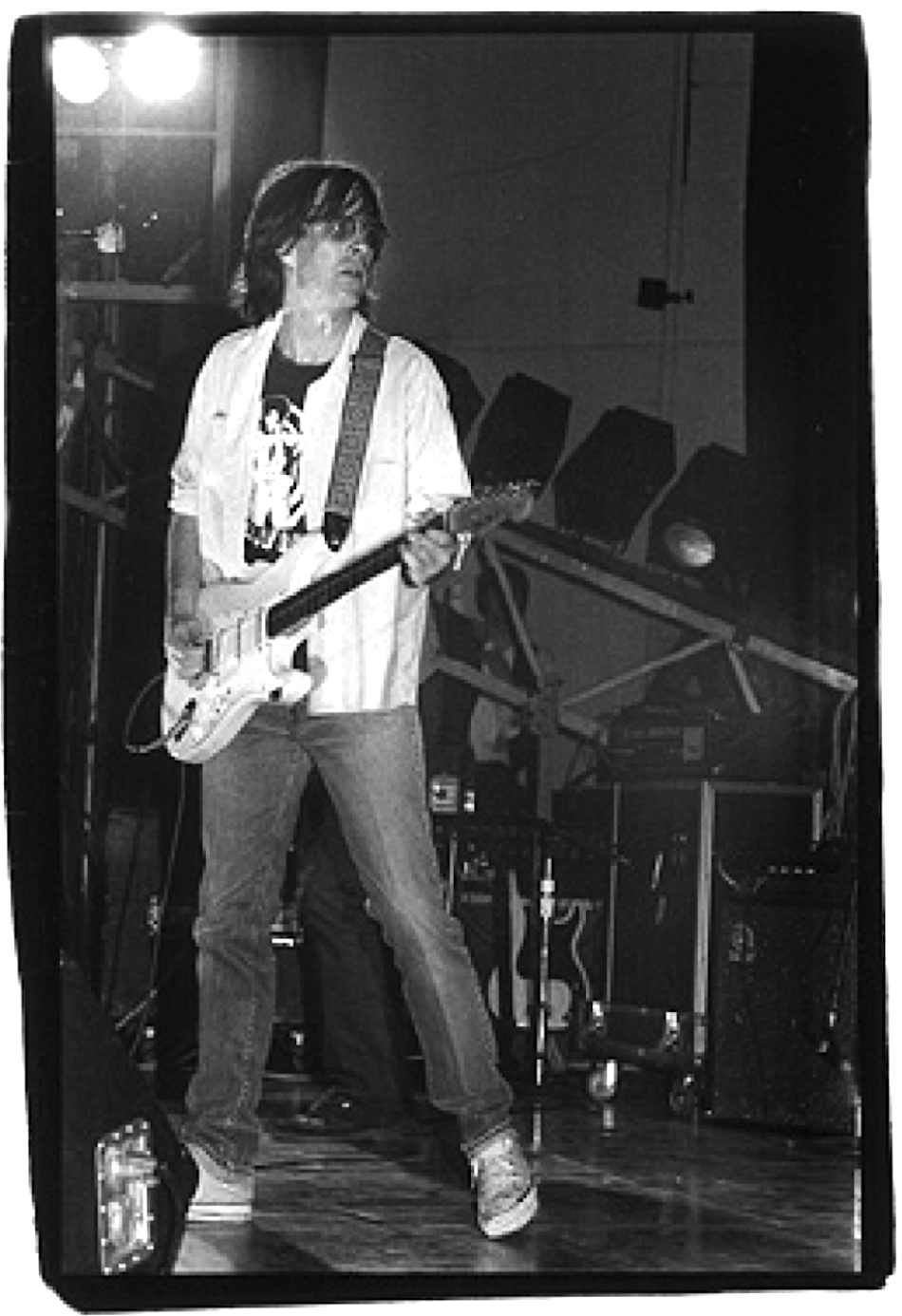
Tu as commencé à écrire des chansons très jeune, au milieu des années 1960 : quels sont les éléments qui sont à l’origine de ta vocation précoce ?
Personne ne s’intéressait particulièrement à la musique dans ma famille, jusqu’à ce que mon frère naisse, onze ans avant moi. Il a commencé à prendre des cours de piano et, quand nous vivions encore dans le Connecticut, il est devenu l’organiste de la chapelle du lycée. Je l’écoutais souvent répéter et j’étais fasciné par le son de l’orgue et par la façon dont cette musique remplissait toute une salle. C’est sans doute lui qui a été le premier à s’apercevoir que j’étais aussi doué pour la musique. Il a commencé à m’écrire des partitions simplifiées, avec des numéros collés sur les touches du piano, pour que je puisse jouer Twinkle, Twinkle Little Star. Mes parents voulaient que j’apprenne aussi le piano et mon frère aîné est intervenu pour leur dire : » Surtout ne l’inscrivez pas à des cours ! Il sait très bien se débrouiller tout seul. « Un mal pour un bien, sans doute. J’aurais bien aimé apprendre à lire la musique, mais ça ne m’a pas empêché de jouer.
Quand et comment as-tu découvert le rock ?
En 1962, quand j’avais six ans, nous avons déménagé à Winston-Salem, en Caroline du Nord. Mon père a trouvé du boulot dans une banque et c’est donc là-bas que j’ai grandi. Comme beaucoup d’enfants de mon âge, j’ai regardé le Ed Sullivan Show un soir de février 1964. C’est un peu comme pour la fameuse citation de Brian Eno à propos du Velvet Underground : je crois que tous les gamins qui ont vu pour la première fois les Beatles ce soir-là ont formé un groupe le lendemain ! Au minimum, ils ont eu envie de le faire. Je n’avais huit ans et j’ai créé mon premier groupe dans les jours qui ont suivi ce premier passage des Beatles à la télévision américaine : deux guitares acoustiques et un type avec une caisse claire. Au début, nous ne jouions que des reprises des Beatles, exclusivement. Et puis j’ai grandi, je me suis fait d’autres amis et j’ai rencontré d’autres musiciens. Nous avons découvert Cream, The Electric Flag, Mike Bloomfield, John Mayall. Ce genre de choses. A douze ans, je rêvais de devenir un guitariste de blues. Qui l’eut cru ? Personne ne m’avait dit qu’on ne pouvait pas être un guitariste de blues à douze ans, donc ça ne m’a pas arrêté. Mes goûts ont ensuite évolué vers des formes plus mélodiques. Je suis devenu fan des Kinks, de The Move. Mon grand frère m’a laissé trois albums des Beach Boys en héritage quand il est parti à la fac : Smiley Smile, 1967 Wild Honey, 1967 et Friends, 1968. Il m’a aussi offert, au même moment, Projections, 1966 de The Blues Project et le premier album de The Left Banke. Ce sont vraiment ces cinq disques qui m’ont marqué à vie, de manière indélébile.
Quelle était la place de la musique dans cette petite ville du Sud des États-Unis ?
Il y avait pas mal de gamins qui jouaient dans des groupes à Winston-Salem. Certains n’étaient pas très doués, c’est incontestable. En général, dans ces cas-là, on finit par arrêter après l’adolescence. C’est bizarre, mais beaucoup des gamins qui jouaient de la musique à Winston-Salem à la fin des années 1960 ou au débuts des années 1970 ont continué jusqu’à ce jour. Je crois que ce n’est pas tout à fait un hasard : nous avons développé une certaine forme d’esprit communautaire, parce que nous n’avions pas vraiment le choix. Nous avons été tous obligés de nous engager dans le même combat parce que nous étions relégués dans les marges et que nous avions envie d’en sortir. C’est peu dire que tous les groupes que nous aimions n’étais pas à la mode à cette époque. Ce n’est pas que nous détestions le rock sudiste à la Allman Brothers ou à la Marshall Tucker Band. Mais ce n’était pas cette musique que nous avions envie de jouer, tout simplement. Malheureusement pour nous, c’est ce que le public local avait envie d’entendre. Je crois que ça a toujours fonctionné ainsi : les gens du coin viennent écouter un groupe du voisinage uniquement pour entendre ce qui se trouve déjà dans leur propre collection de disques. C’est plus confortable, plus reposant. La plupart des groupes de Winston-Salem, et pas uniquement ceux dans lesquels j’ai joué, avaient envie d’innover davantage. Nous jouions des chansons du MC5, des Flamin’ Groovies ou de Mott The Hoople quelques semaines après leur sortie, alors qu’elles n’étaient jamais passées à la radio, ou presque. Le public était au mieux perplexe, au pire hostile. Mais ça ne nous a pas empêché de continuer à les jouer. Je me demande souvent si je serais devenu musicien si j’avais continué de grandir dans le Connecticut, dans un environnement moins conflictuel sur le plan culturel. Je ne suis pas sûr de la réponse.

Quand et comment as-tu rencontré les futurs membres de The dB’s ?
Will Rigby, le bassiste du groupe et moi étions dans la même classe en CE2. Nous avons découvert les Beatles ensemble, au même moment. Chris Stamey avait un an de plus. Je l’avais remarqué à l’école, quand ses parents le déposaient en voiture parce qu’il transportait un violoncelle dans son étui. J’avais entendu parler de lui avant de le connaître vraiment, tout comme j’avais entendu parler de Mitch Easter qui était aussi dans la même école que nous. Il jouait déjà dans plusieurs groupes et ils avaient même fait des concerts dans des hôtels ou des clubs de la région, ce qui me semblait être le sommet du professionnalisme. Ce soir, on va fêter le quarantième anniversaire de Let’s Active dans un club de Winston Salem. Mitch va jouer, Don Dixon sera aussi présent : ce sont des gens que je connais depuis l’enfance. J’ai donc entendu dire que Chris avait acheté une basse et je l’ai immédiatement appelé pour qu’il vienne jouer avec nous. Nous avons donc commencé à travailler ensemble et, un peu plus tard, en 1971, nous avons tous les deux intégré un groupe déjà constitué qui s’appelait Rittenhouse Square. Mitch Easter en était déjà le pivot.

La majeure partie de notre répertoire était constituée de compositions originales. Arrogance, le groupe dans lequel Don Dixon jouait de la basse, venait de publier un premier Ep, quelques mois plus tôt, et c’était devenu le modèle à suivre pour Chris et moi. Nous avons donc enregistré par nos propres moyens cinq chansons composées par Mitch et une autre par moi, Like Vow. C’était la toute première fois que nous sommes allés dans un studio, à Greensboro. Le batteur a commandé des pochettes en papier – et non en carton – pour que ce soit moins cher et que nous puissions faire fabriquer un peu plus de copies. Nous avons pu payer 500 copies, avec une photo de nous sur la pochette, avec nos chemises assorties. C’est un album au son très brut, sans doute le plus proche du heavy metal que j’ai jamais enregistré. Mais c’était une super expérience.
Comment as-tu découvert Big Star à l’époque alors que la réputation du groupe et la diffusion de ses albums étaient encore très limitées ?
Chris a entendu When My Baby’s Beside Me en 1972 sur une radio locale. Je crois que ce devait être la face B de In The Street, le premier single extrait de #1 Record, 1972. Il a été immédiatement captivé par ce son. Il a réussi à dénicher un exemplaire de l’album, après une longue quête de plusieurs semaines et il nous l’a fait découvrir. Nous avions des séances de travail collectif un peu particulières le samedi matin. Nous nous réunissions, souvent chez Chris, pour écouter des disques qui nous plaisaient et pour nous inspirer des accords que nous pouvions y trouver. Oui, nous étions des geeks avant même que le terme de geek soit inventé ! Nous avions déjà entendu quelques chansons des Raspberries à la radio. Et il y avait Badfinger, bien sûr. Nous avions donc déjà commencé à percevoir les prémisses d’une deuxième vague de cette pop mélodique, inspirée par les Beatles mais avec des guitares un peu plus tranchantes. Quand Radio City, 1974 est sorti, j’ai réussi à trouver un exemplaire dans un supermarché de la ville. Quand je l’ai déballé, j’ai vu que c’était un exemplaire promo qui avait été reconditionné. J’ai trouvé ça un peu curieux mais je n’ai compris que bien plus tard que c’était le symptôme d’un des très nombreux points de conflit qui avaient opposé le groupe et le label à leur distributeur calamiteux. En tous cas, j’étais super excité et, quand j’ai commencé à l’écouter, cet album m’a vraiment bouleversé. Il y avait quelque chose d’élastique dans les rythmes et le tempo. La manière dont Jody Stephens joue de la batterie est tellement inspirée. Il y a tous ces minuscules décalages qui sont vraiment fantastiques. Par exemple sur You Get What You Deserve : il y a ce break au milieu de la chanson et, juste après le petit passage à la guitare, Jody redémarre un tout petit peu en retard mais c’est ce qui donne toute sa dynamique à la chanson. Un peu après, quelqu’un m’a passé une cassette. Sur la première face, il y avait le concert de Big Star diffusé par WLIR en 1974 et sur la seconde, une des nombreuses versions du troisième album qui n’était pas encore officiellement publié à l’époque – il a été commercialisé pour la première fois sur PVC Records quand je suis arrivé à New-York, en 1978. Je sais qu’il y a encore des gens pour débattre aujourd’hui sur l’ordre des morceaux de ce troisième album : quel est le « vrai » tracklisting ? quelle est la meilleure version ou la plus authentique ? J’avoue que, même si je suis fan du groupe depuis 1972, ça me passe largement au-dessus de la tête.
C’est ce qui t’a poussé à te rendre à Memphis ?
Oui, en grande partie. La première fois que je suis allé à Memphis, en 1976, c’était vraiment une sorte de pèlerinage sur les traces de Big Star. Nous sommes partis en voiture avec Mitch Easter et Will Rigby. Nous avons été rencontrer Chris Bell dans le fast-food où il travaillait comme serveur. Nous avons discuté avec lui. Je me suis installé là-bas en 1978 et j’ai commencé à enregistrer avec Richard Rosebrough, un ingénieur du son qui avait souvent travaillé aux studios Ardent avec Big Star. J’ai rappelé Chris Bell pour lui proposer une collaboration mais je n’ai eu aucun retour. J’ai donc continué d’enregistrer avec Richard une série de morceaux qui sont sortis récemment sur The Death Of Rock, 2018. Alex Chilton est passé le dernier soir pour nous filer un coup de main. Nous avons enregistré quelques morceaux à moitié improvisés. Il travaillait sur certains titres de Like Flies On Sherbert, 1979 et il n’éprouvait plus grand intérêt, à ce moment-là, pour tout ce qui se rapprochait de près ou de loin de Big Star. Le surlendemain, j’étais en train de faire mes bagages pour rentrer à New-York où je devais passer une audition pour intégrer The dB’s et Chris Bell m’a rappelé en me disant qu’il acceptait ma proposition. J’ai choisi New-York, mais j’aurais évidemment été curieux de voir ce que ça aurait donné si j’étais resté à Memphis.
A Memphis, tu avais déjà enregistré certaines des chansons qui figurent sur les premiers albums de The dB’s. De quand datent-elles exactement ?
Pour la plupart, ce sont des chansons que j’ai composées avant de déménager à Memphis, quand j’habitais à Chapell Hill et que je jouais dans un autre groupe avec Mitch Easter, The H-Bombs. Il vivait avec Faye Hunter – future membre de Let’s Active – dans une maison où il avait installé du matériel d’enregistrement. C’est là que j’ai travaillé sur les premières ébauches de ces titres, notamment Bad Reputation. Quand j’ai débarqué à New-York, je n’arrivais donc pas tout à fait les mains vides. Le problème, c’est que je n’étais pas embauché au départ pour écrire des chansons : c’était le groupe de Chris et il m’avait fait venir pour jouer des claviers, rien d’autre. Un peu comme quand Gram Parsons a été embauché pour jouer du piano avec The Byrds. Quand il m’a demandé, un peu plus tard, si j’avais des chansons à lui proposer, j’étais évidemment ravi.
 Tu es arrivé à New-York en 1978 et pourtant le premier album de The dB’s n’est sorti qu’en 1981. Pourquoi ?
Tu es arrivé à New-York en 1978 et pourtant le premier album de The dB’s n’est sorti qu’en 1981. Pourquoi ?
Je dis souvent que je suis arrivé à New-York deux semaines après le dernier concert de Television au Bottom Line. Pour moi, ça symbolise vraiment une ligne de démarcation entre la première génération de groupes punk – The Ramones, Talking Heads, Dead Boys, Television – et la deuxième dont nous faisions partie. Nous avons joué notre premier concert à New-York le soir d’Halloween, en 1978, avec The Fleshtones et The Zantees qui sont ensuite devenus The A-Bones avant de créer Norton Records. Et nous n’étions pas très bons, nous n’avons pas très bien joué. Cela n’a sans doute pas aidé à attirer l’attention des maisons de disques. Nous avons donc décidé de répéter aussi souvent que possible, presque quotidiennement. Nous avions tous des boulots alimentaires. Chris et Will travaillaient dans un restaurant sur Spring Street à Soho. Je travaillais chez un disquaire de la troisième avenue. Nous avions du mal à trouver un lieu de répétition stable et bon marché. Les choses ont commencé à s’améliorer nettement quand nous avons pu nous installer dans les locaux du New-York Rocker Magazine, au deuxième étage d’un bâtiment au 166 de la cinquième avenue. Le rédacteur en chef, Alan Betrock, qui était le voisin de Chris quand il habitait sur Bleecker Street, nous a autorisé à entreposer tout notre matériel entre les piles de vieux numéros du journal. Il y avait énormément d’invendus et tant mieux ! Avec ces piles, nous avons construit quatre espèces de murs qui délimitaient notre espace de répétition. Quand l’un d’entre nous n’avait pas d’endroit où dormir, il pouvait toujours poser un matelas par terre et s’installer pour quelques nuits. C’est là que nous avons enregistré la plupart des chansons qui ont été publiées sur I Thought You Wanted To Know sur un magnéto quatre pistes que Chris avait acheté. Un peu comme Mitch Easter, il a commencé à s’intéresser d’un peu plus près aux questions de production et au processus d’enregistrement. Moi, j’étais plus intéressé par le boucan. J’étais venu pour jouer dans un groupe punk, simplement. Nous avons donc enregistré ces démos et nous les avons apportées aux maisons de disques : nous étions très motivés et nous pensions vraiment qu’ils allaient partager un peu de notre enthousiasme. Et qu’ils allaient nous signer. Chris avait déjà publié un premier 45 tours auto-financé sur son label, Car Records, I Thought You Wanted To Know, 1978. C’est une chanson que je trouve toujours aussi fantastique et que j’adore jouer sur scène, encore aujourd’hui.
Tu gardes tout de même de bons souvenirs de cette période ?
Oui, c’était aussi amusant. Le plus frustrant restait sans doute les concerts. Nous avions du mal à mettre en place sur scène ce que nous avions pourtant enregistré. Parce que notre matériel n’était pas très bon ou parce que nous n’étions pas très bons nous-mêmes ou parce que nous n’entendions pas la moitié de ce que nous jouions, tout simplement. Je me souviens que c’était particulièrement gênant pour les voix et les harmonies. Déjà que nous ne sommes pas d’excellents chanteurs mais, dans ces conditions, c’était souvent catastrophique. Personne n’est jamais ressorti d’un concert des Db’s en se disant : « Ouah ! Quels voix ! « . Au mieux, les gens venaient nous voir en nous disant : « Je n’ai jamais entendu personne chanter de cette manière. » En même temps, c’était une période formidablement créative. Nous composions régulièrement de nouvelles chansons, presque toutes celles des deux premiers albums.
Vous aviez peu de soutiens. Terry Ork faisait partie de ceux-ci ?
Oui, il nous a beaucoup aidé. Nous avons pu enregistrer plusieurs morceaux en studio grâce à l’avance qu’il nous avait versé quand il a signé un deal avec Warner en Grande-Bretagne. Avec cet argent, nous nous sommes payés quelques heures de studio à Soho, dans les studios Blue Rock. Nous avons travaillé sur cinq ou six chansons mais nous ne sommes pas parvenus à les terminer, à une ou deux exceptions près. En 1980, Alan Betrock a créé son propre label, Shake Records. Il avait déjà travaillé avec Blondie, un peu avant, sur une première version de Heart Of Glass qui s’appelait The Disco Song et qui, je crois, n’a jamais été publiée. C’est lui qui a produit notre deuxième single, Black And White, 1980. Alan était un passionné de musique. Il collectionnait énormément de vieux disques de girl-groups des années 1960. Il avait des correspondants en Grande-Bretagne qui ont créé un bureau d’édition musicale qui s’appelait Albion Music puis un label, Albion Records. C’est comme ça que nous avons réussi à publier notre premier album en Angleterre en 1981. Ces gars-là avaient des idées très originales et vraiment fantastiques. Le premier album de The dB’s est sorti dans une boîte de conserve !
 Pour le deuxième, Repercussion, 1981, ils ont eu l’idée de surfer sur toute cette vague d’hostilité contre les cassettes audio. C’était l’époque où l’industrie musicale britannique menait campagne contre les cassettes et le home-taping qu’ils percevaient comme une menace parce qu’ils croyaient que cela ferait chuter les ventes. Si seulement ils avaient su ce qui les attendait trente ans plus tard ! Albion Records a donc décidé d’attacher une cassette sur la pochette de chaque exemplaire de l’album avec Repercussion sur une face et en laissant la seconde vierge, pour que les gens puissent y copier ce qu’ils voulaient. Génial ! Ce n’est que bien plus tard, en 1984, qu’un label américain a fini par s’intéresser à nous.
Pour le deuxième, Repercussion, 1981, ils ont eu l’idée de surfer sur toute cette vague d’hostilité contre les cassettes audio. C’était l’époque où l’industrie musicale britannique menait campagne contre les cassettes et le home-taping qu’ils percevaient comme une menace parce qu’ils croyaient que cela ferait chuter les ventes. Si seulement ils avaient su ce qui les attendait trente ans plus tard ! Albion Records a donc décidé d’attacher une cassette sur la pochette de chaque exemplaire de l’album avec Repercussion sur une face et en laissant la seconde vierge, pour que les gens puissent y copier ce qu’ils voulaient. Génial ! Ce n’est que bien plus tard, en 1984, qu’un label américain a fini par s’intéresser à nous.
En réécoutant ces morceaux pour la réédition, as-tu été surpris, en bien ou en mal, par quelque chose que tu avais oublié ?
Pas tellement par les démos. Je les ai toujours appréciées et j’ai toujours pensé qu’elles témoignaient d’un moment important dans l’histoire du groupe. Il y a une spontanéité et une dynamique juvéniles très particulières dans ces enregistrements. On parle souvent de l’énergie nerveuse des dB’s. Je ne sais pas si l’expression est vraiment adéquate – j’ai toujours pensé qu’un groupe comme The Feelies avait une énergie beaucoup plus nerveuse que nous – mais, en tous cas, elle correspond sans doute assez bien à ces premières traces enregistrées. Il y a même certaines versions que je préfère à celles qui se sont retrouvées ensuite sur les albums. Pour Nothing Is Wrong, notamment, je préfère largement la démo à la version qui figure sur Repercussion et sur laquelle l’orgue Hammond est vraiment envahissant. On dirait un morceau de Procol Harum ! En revanche, j’ai été très agréablement surpris par les titres live. Chris a fait un travail de recherche et de nettoyage fantastique.
L’influence des dB’s a toujours été considérablement supérieure à votre succès commercial. Quel regard portes-tu aujourd’hui sur ce statut un peu particulier de groupe culte ?
J’ai toujours eu du mal à appréhender notre statut. Nous avons commencé avec beaucoup d’espoirs, nous avons essayé de nous mêler à la compétition puis nous avons à peu près complètement disparu des radars avant d’être cités par quelques artistes et d’être redécouverts. Disons que si je pense à tous les groupes qui m’ont influencé au cours de ma vie – je mets de côté les Beatles qui sont vraiment à part mais je parle de groupes comme Badfinger, Big Star, The Raspberries, The Move, The Flamin’ Groovies – ce sont des groupes qui n’ont jamais obtenu un niveau de notoriété ou de reconnaissance considérable auprès du très grand public. Je ne devrais donc pas faire semblant de m’étonner que la musique que j’ai composée appartienne également à cette catégorie. C’est assez logique, en fait. Tu vois le mur derrière moi ? J’ai accroché trois albums de platine auxquels j’ai participé : deux de R.E.M. et un de Hootie And The Blowfish. J’en suis assez fier, en fait, d’un certain point de vue. Et si nous avons exercé une petite influence, si minuscule soit-elle, sur un groupe comme R.E.M. et sur son succès, c’est vraiment un très grand motif de fierté. Je crois que quand R.E.M. a triomphé, nous avons tous triomphé.


