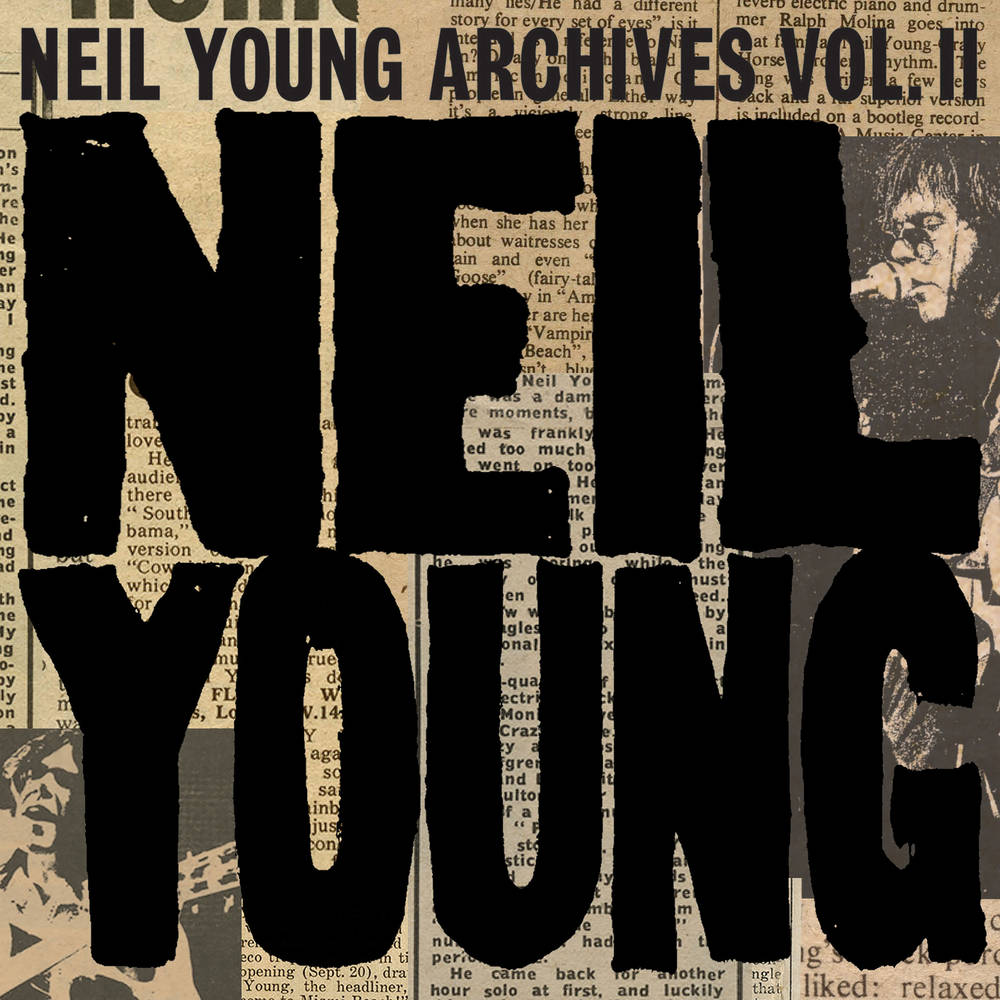 Avec ce travail de réédition d’albums, de publication de live et de compilation d’inédits entrepris depuis plusieurs dizaines d’années, Neil Young est devenu le gardien de son propre temple, une sorte de Moses Asch monomaniaque et autocentré qui, à 75 ans passés, trouve encore le temps d’enregistrer des disques, et parfois même des bons. Aussi généreux et enthousiasmant soit ce projet, il n’est pas sans poser des problèmes d’éthique. Lorsqu’on raconte ses propres aventures, peut-on aussi être un bon historien ? La question ne se posait pas vraiment pour le premier volume des Archives, paru en 2009. Le Loner y exhumait les premiers trésors d’une trajectoire, certes sinueuse, mais résolument ascendante : des enregistrements des Squires en 1963, jusqu’au succès planétaire de Harvest, consacré cathédrale du folk-rock dès sa sortie en 1972, en passant par la pop lumineuse de Buffalo Springfield, un premier solo sous-estimé, quelques titres avec Crosby, Stills et Nash, le premier Crazy Horse, intense et sale, puis au milieu de tout cela, After The Gold Rush, véritable pierre de touche de cette période Topanga Canyon.
Avec ce travail de réédition d’albums, de publication de live et de compilation d’inédits entrepris depuis plusieurs dizaines d’années, Neil Young est devenu le gardien de son propre temple, une sorte de Moses Asch monomaniaque et autocentré qui, à 75 ans passés, trouve encore le temps d’enregistrer des disques, et parfois même des bons. Aussi généreux et enthousiasmant soit ce projet, il n’est pas sans poser des problèmes d’éthique. Lorsqu’on raconte ses propres aventures, peut-on aussi être un bon historien ? La question ne se posait pas vraiment pour le premier volume des Archives, paru en 2009. Le Loner y exhumait les premiers trésors d’une trajectoire, certes sinueuse, mais résolument ascendante : des enregistrements des Squires en 1963, jusqu’au succès planétaire de Harvest, consacré cathédrale du folk-rock dès sa sortie en 1972, en passant par la pop lumineuse de Buffalo Springfield, un premier solo sous-estimé, quelques titres avec Crosby, Stills et Nash, le premier Crazy Horse, intense et sale, puis au milieu de tout cela, After The Gold Rush, véritable pierre de touche de cette période Topanga Canyon.
 À titre personnel, si j’ai mis des mois à en faire le tour, ce n’est pas uniquement du fait de l’opulente générosité de cette précieuse boîte mais aussi et surtout à cause de mes interrogations sur la façon d’écouter tout ça. Oui, tout ça : 10 CD et 125 morceaux, avec bonne une moitié d’inédits. Comment aborder ce genre d’objet discographique ? Cette question, je me la pose à chaque fois que je fais l’acquisition d’un coffret, d’une réédition un peu copieuse. Étonnamment, les plus simples d’accès sont toujours ceux qui ont l’air les plus rébarbatifs et redondants : les éditions qui documentent l’enregistrement d’un album avec prises alternatives, faux départs ou titres inédits mis au rebut. Elles exigent de l’attention et du temps mais procurent des plaisirs d’écoute particuliers, d’autant plus fort qu’on connaît bien le disque original. C’est le cas notamment avec The Pet Sounds Sessions ou The Smile Sessions des Beach Boys, de l’indispensable American Sound 1969 d’Elvis Presley (qui documente l’enregistrement de son chef d’œuvre From Elvis in Memphis), des Complete 1969 Recordings de King Crimson ou certains monuments du jazz qui ont initié la coutume en transformant l’auditeur en une sorte de voyeur avec des lunettes d’archéologue.
À titre personnel, si j’ai mis des mois à en faire le tour, ce n’est pas uniquement du fait de l’opulente générosité de cette précieuse boîte mais aussi et surtout à cause de mes interrogations sur la façon d’écouter tout ça. Oui, tout ça : 10 CD et 125 morceaux, avec bonne une moitié d’inédits. Comment aborder ce genre d’objet discographique ? Cette question, je me la pose à chaque fois que je fais l’acquisition d’un coffret, d’une réédition un peu copieuse. Étonnamment, les plus simples d’accès sont toujours ceux qui ont l’air les plus rébarbatifs et redondants : les éditions qui documentent l’enregistrement d’un album avec prises alternatives, faux départs ou titres inédits mis au rebut. Elles exigent de l’attention et du temps mais procurent des plaisirs d’écoute particuliers, d’autant plus fort qu’on connaît bien le disque original. C’est le cas notamment avec The Pet Sounds Sessions ou The Smile Sessions des Beach Boys, de l’indispensable American Sound 1969 d’Elvis Presley (qui documente l’enregistrement de son chef d’œuvre From Elvis in Memphis), des Complete 1969 Recordings de King Crimson ou certains monuments du jazz qui ont initié la coutume en transformant l’auditeur en une sorte de voyeur avec des lunettes d’archéologue.

Mais cette façon de soulever le rideau pour voir ce qui se trame en coulisses n’est pas une pratique qui plaît au vieux Canadien. Il préfère façonner un panorama, un récit encyclopédique documenté et très écrit sous la forme de longues playlist chronologiques. Ici, 131 morceaux : mélanges d’extraits d’albums, de versions alternatives, d’inédits de fond de placard (imaginez un beau placard quand même) et de concerts. Une anthologie qui s’inscrit dans la lignée de Decade (1977) sa toute première compilation ou, dans une moindre mesure, du coffret CSN paru chez Atlantic en 1991. C’est aussi une manière de garder le contrôle sur son histoire et la façon de la raconter. Au passage, ce n’est probablement pas un hasard si l’idée de publier son autobiographie (Waging Heavy Peace, 2012) ne se concrétise pas avant qu’il ait commencé à mettre de l’ordre dans ses nombreux enregistrements. En revanche, pour qui a eu l’occasion de consulter des sources moins officielles, la vision que porte Neil Young sur Neil Young est parfois discutable.
La période couverte par ce nouveau volume est sans doute la plus difficile pour le chanteur. Et à plus d’un titre. C’est l’ère dite de la Ditch Trilogy, pour nommer trois albums désespérés, sinistres et ardents mais d’une beauté envoûtante, dont seul Tonight’s The Night (1975) trouvait grâce aux yeux de son créateur pendant longtemps, qui ne voulait pas entendre parler de On The Beach (1974). Ce sommet du rock des 70s (et de la discographie du bonhomme) n’a été réédité en CD qu’en 2003. Depuis, il semble avoir reconquis l’estime du Canadien, puisqu’il a une place de choix sur cette compilation, avec 7 titres sur les 8 que compte l’album original. En revanche Time Fades Away (1973), est encore et toujours ignoré, voire méprisé. Bien que réédité en vinyle, et disponible sur les plateformes de streaming, la version CD fut disponible uniquement dans un coffret confidentiel et devenu très vite introuvable. Un seul titre, Yonder Stands The Sinner figure ici. Certes, on retrouve d’autres enregistrements publics de chansons qui figurent sur ce disque « interdit » (L.A, Time Fades Away, The Bridge, Don’t Be Denied) mais le live d’origine est comme effacé de la photo. Neil Young ne cache pas son aversion pour ce disque. Le plus mauvais qu’il aurait enregistré selon lui. Pourtant en 1973, il semblait très attaché à l’idée de sortir un album live de nouveaux morceaux inédits, pour témoigner de l’état du groupe et raconter la tournée qui suivit la mort tragique de Danny Whitten, le guitariste du Crazy Horse. Ces performances, loin d’être parfaites, sont marquées par le chagrin, la culpabilité et le deuil maladroit noyé dans beaucoup trop de tequila. La section rythmique est en équilibre, les guitares âpres et âcres, les voix amères et pathétiques. Les musiciens ne sont pas toujours en place, le groupe semble près de la rupture, à la limite de s’écrouler sur certaines chansons. Bref, c’est magnifique. La direction prise ici tranche radicalement avec la beauté douce de Harvest à qui il succède. D’aucuns parlent même de sacrifice artistique (et commercial) – qu’ils gardent un peu de souffle, ils n’ont pas fini de la sortir, celle-là.
En réalité, la face cachée de Harvest est plus certainement Homegrown (1975), mais inédit jusqu’en 2020 et présent ici dans son intégralité). Les tempos, les arrangements et les ambiances se ressemblent beaucoup mais ces nouvelles chansons paraissent « trop réelles » (sic). Quelques mois avant sa sortie prévue, Mr. Young organise une séance d’écoute avec quelques amis : les bandes défilent après celles de Tonight’s The Night enregistré plusieurs mois auparavant. La comparaison ne lui plaît pas du tout. Il décide sur le champ d’enterrer le premier et de sortir le second à la place. Aujourd’hui, avec plus de 45 ans de décalage, il est difficile de comprendre ce que la douceur et l’amertume de Homegrown pouvait avoir d’indigne. Pas assez radicale ? Trop proche d’Harvest ? Certainement pas plus que les deux autres suites qui ont a été écrites plus tard : Harvest Moon (1992) et Prairie Wind (2004). Enfin, en quoi un poème bucolique amer pouvait bien concurrencer « une lettre d’overdose », pour reprendre les mots exacts de l’auteur de Tonight The Night ? Peu importe, le sort de Homegrown est scellé. Aujourd’hui, le chanteur revient sur certaines de ses décisions, sans vraiment les justifier, tout juste en s’expliquant avec des chansons. Il y a celles qui ont tous les honneurs et celles qui n’ont pas le droit de cité ; avec le temps, ce ne sont pas toujours les mêmes. Tel est aussi le principe des Archives : un dialogue que Neil Young entretient avec le temps et surtout avec lui-même. Entre introspection et schizophrénie.
Autre jalon incontournable de la période, Zuma (1975) est un disque plus héroïque, romanesque et même romantique (cette année-là, il se sépare de sa compagne, l’actrice Carrie Snodgress). C’est aussi le premier enregistrement studio avec un Crazy Horse remanié qui intègre le guitariste Poncho Sampedro. On retrouve une grande partie de l’album original ainsi qu’une poignée d’inédits délicieux : Hawaii, Born To Run, une version studio inédite de Ride My Llama, de Powderfinger ainsi qu’une splendide interprétation électrique de Pocahontas (3 titres repris plus tard sur Rust Never Sleeps, 1979). Enfin le dernier chapitre est consacré à Long May You Run (1976). Initialement prévu pour être enregistré par CSNY, Graham Nash et David Crosby quittent le train en marche ; le LP est finalement signé du Stills-Young Band. La relation entre les deux partenaires n’est pas idyllique. Ces messieurs ont leur petit caractère et des soucis personnels (c’est au tour de Stephen Stills de se séparer, de qui on sait). En revanche, il est indéniable qu’ils aiment toujours autant jouer ensemble. Le disque déçoit un peu, forcément, mais rien de déshonorant. En entendant certaines chansons écartées, notamment les versions électriques de Traces et surtout Separate Ways, on ne peut s’empêcher de penser que le duo avait les moyens de produire une œuvre beaucoup plus aboutie.

Pour clore cette anthologie, un dixième CD compile des extraits des live mythiques de 1976 à Londres et Tokyo. Grâce aux enregistrement pirates qui circulent çà et là, nous savons que ces concerts étaient de très haute volée (les versions de Don’t Cry No Tears, Drive Back ou Cortez The Killer le prouvent ici) et les enfants gâtés que nous sommes n’apprécient pas bien de devoir se satisfaire d’échantillons, surtout quand le coffret contient deux autres concerts (Roxy et Tucaloosa) pour lesquels on est déjà passé à la caisse.
On a beau porter un regard parfois contrarié sur la sélection faite ici, fouiller dans ce coffre à trésor est un véritable régal. Pour le fan, c’est même un rêve éveillé. La suite ? Il paraît que le volume III ne devrait pas tarder. On parle même de 2022. Personne n’y croit vraiment, bien entendu. Cependant, le rythme s’accélère nettement ces temps-ci et le vieux Neil ne nous donne pas que des os à ronger. Le mois dernier sortait Way Down The Rust Bucket, un live de 1990 avec un Crazy Horse en grande forme et d’ici peu ça sera au tour de Young Shakespeare, la représentation solo du 22 janvier 1971 (3 jours après l’enregistrement du splendide Live At Massey Hall, publié en 2007). À en croire le site officiel, les prévisions sont alléchantes : concerts, films, répétitions, albums inédits. L’occasion de nous émerveiller, de râler aussi ou de changer d’avis, comme nous l’a si bien enseigné Neil Young.


