
Est-il possible de tomber amoureux deux fois de la même personne, à dix-sept années d’intervalle, sans même s’en apercevoir ? La chose est peu probable, à moins d’une déficience mémorielle dont l’absence de pathologie neurologique devrait pourtant me préserver. C’est pourtant bien ce qui s’est produit lorsque, il y a quelques mois à peine, j’ai recroisé la route du dénommé Marker Starling, musicien canadien de son état, et auteur de l’un des plus beaux albums qu’il m’ait été donné d’entendre depuis des lustres. Publié confidentiellement fin 2018 par le label britannique Tin Angel, Trust An Amateur est soudain apparu comme un océan de douceur dont les gouttes n’ont depuis cessé de se déposer en brume délicate à chaque trempette voluptueuse. Les compositions savamment conçues, porteuses d’inflexions à la fois pop et jazzy, y sont transfigurées par la grâce d’une voix au timbre très singulier, qui charrie à la fois l’émotion à fleur de peau de Robert Wyatt et la chaleur réconfortante d’Al Green. Quelques recherches virtuelles plus tard, il s’est donc avéré que derrière ce pseudonyme qui n’évoquait, au premier abord, que le personnage d’impresario cupide interprété par feu Sacha Briquet dans L’Île Aux Enfants – en réalité, il s’appelait Albert Travling, mais, décidément, les soucis de mémoire ne m’épargnaient guère – se dissimulait en réalité Chris Cummings, songwriter canadien de son état, et auteur au début du siècle d’une poignée d’albums publiés sous un autre alias, Mantler en l’occurrence, et notamment de Sadisfaction, 2002 remarquable ébauche de pop minimaliste et mélancolique. Un de ses petits disques familiers et attachants, dont on s’éprend sans rien connaître de leurs origines ou de leur pedigree et qui, bien qu’enfoui dans le maquis foisonnant d’une discothèque en expansion souvent incontrôlée, finit toujours par resurgir des interstices à intervalle de temps irréguliers. Deux ou trois clics supplémentaires et Cummings consent de fort bonne grâce à converser aux aurores – pour lui – depuis son domicile de Toronto, et à revenir sur les quelques jalons essentiels d’un parcours musical qui semble à nouveau s’accélérer depuis deux ou trois ans (quatre albums publiés depuis 2014).
En écoutant tes albums, j’ai eu beaucoup de mal à identifier des influences très précises. Quelles ont été les principales étapes de ton parcours musical et quelles sont tes principales références ?
J’ai commencé à écrire des chansons quand j’étais enfant, vers six ou sept ans environ. Je m’amusais à les enregistrer sur un petit magnétophone. C’est amusant : j’ai réécouté récemment une de ces vieilles cassettes qui trainait encore chez mes parents et j’ai eu l’impression d’y retrouver déjà beaucoup d’éléments de Mantler, mon premier projet. J’ai commencé à prendre des cours de piano un peu plus tard, vers huit ans environ. J’ai donc suivi une formation classique de pianiste, au conservatoire de Toronto, jusqu’à mes vingt ans. Dans le même temps, j’ai découvert aussi la pop, bien sûr. Je m’amusais de temps en temps à interpréter des mélodies que j’aimais bien au piano ou à m’inspirer des albums que j’adorais pour composer des esquisses de chansons. Mais je ne me suis remis sérieusement à l’écriture que lorsque j’ai approché de la trentaine. Pour ce qui est des influences, j’ai souvent fonctionné par phases exclusives. Je n’ai écouté presque du R’n’B et du jazz américains pendant six ou sept ans. Ensuite, j’ai découvert la pop des années 1960 : The Zombies, The Left Banke. Quand je me suis remis à composer des chansons, j’ai essayé de combiner ces deux styles, en quelque sorte. Mais je n’ai jamais totalement oublié mes premières influences classiques : Debussy, Ravel. J’ai toujours adoré les compositeurs français du début du XXème siècle.
 La pop est souvent associée à l’adolescence et au désir de monter un groupe. J’imagine que c’est un peu différent pour toi : quelles étaient tes ambitions quand tu as enregistré les premiers albums de Mantler ?
La pop est souvent associée à l’adolescence et au désir de monter un groupe. J’imagine que c’est un peu différent pour toi : quelles étaient tes ambitions quand tu as enregistré les premiers albums de Mantler ?
C’était à peu près au milieu des années 1990. J’ai constaté que des gens comme Beck commençaient à avoir du succès en bricolant tout seul, dans leur coin. Je me suis dit que je pourrai peut-être essayer de faire la même chose. Au départ, Mantler était vraiment un projet totalement solitaire : de la bedroom pop au sens le plus littéral du terme. De 1995 à 1999, je me suis uniquement consacré au travail d’enregistrement. Ensuite, j’ai commencé à avoir envie de jouer ces chansons sur scène et je me suis entouré d’autres musiciens. J’ai rencontré les gens avec lesquels je travaille encore aujourd’hui un peu plus tard, en 2008. En fait, j’ai deux groupes de collaborateurs distincts : l’un à Toronto, l’autre en Angleterre où se trouve mon label.
Tu entretiens également des liens avec le monde du théâtre me semble-t-il ?
Oui. De 1998 à 2002, j’ai été membre d’une troupe de théâtre à Toronto qui s’appelle Canadia Dell’Arte. Ils m’avaient embauché comme directeur musical et, à l’occasion, comme comédien. C’est dans ce cadre que j’ai pu disposer d’un studio qui appartenait à cette compagnie et c’est là que la plupart des albums de Mantler ont été enregistrés.
Quand et comment s’est opérée la transition entre tes deux projets, Mantler puis Marker Starling ?
J’ai été obligé de changer de nom parce que le trompettiste de jazz Michael Mantler menaçait de me poursuivre en justice. J’ai trouvé mon nouveau pseudonyme quelques mois plus tard mais je viens tout juste de découvrir qu’il existe une chanteuse pop américaine qui s’appelle Harper Starling. Pour le moment, elle me laisse tranquille, mais je n’exclus pas de devoir à nouveau me rebaptiser. (Rires) Je manque décidément d’originalité.
Ton rythme de travail semble s’être accéléré depuis ce changement : tu as publié autant d’albums en tant que Marker Starling depuis cinq ans que tu en avais enregistré avec Mantler en quinze ans. Pourquoi ?
C’est davantage une question d’opportunités que d’inspiration. Plus le temps passe, plus j’essaie de limiter au maximum le temps entre deux enregistrements. Mais c’est très compliqué puisqu’il faut que je tienne compte également de mes obligations familiales et professionnelles : je travaille à plein temps pour le TIFF, le Festival International du Film de Toronto. Dès que j’ai un peu de temps à consacrer à la musique, je m’efforce d’en profiter le plus possible. J’ai commencé à travailler sur Trust An Amateur, 2018 que j’avais prévu de partir enregistrer à Berlin en quatre ou cinq jours quand Emmanuel Mario (Astrobal, Holden), que j’avais rencontré par l’intermédiaire de Julien Gasc, m’a proposé de venir travailler avec lui à Paris pour un autre projet. J’ai accepté et c’est comme cela qu’est né I’m Willing, 2017, un album de reprises que nous avons entièrement réalisé en moins d’une semaine. En moins d’un an, j’ai donc réussi à enregistrer ces deux albums ainsi qu’un troisième, Anchors & Ampersands, 2017 que j’avais conçu, au départ, sur le modèle de Beach Boys’ Party !, 1965 : une sorte de faux album live, avec des applaudissements intercalés entre les chansons. Finalement, j’ai abandonné cette idée et je me suis contenté de réenregistrer d’anciens morceaux qui s’étaient beaucoup transformés à partir du moment où je les avais joués sur scène avec mon groupe actuel.
Pourquoi un album entier de reprises ?
Au départ, c’était une question de temps et d’urgence : je n’avais 10 ou 12 morceaux en stock au moment de partir à Paris. Plus sérieusement, c’est toujours un exercice intéressant que de se plonger dans les chansons écrites par d’autres et d’essayer d’imaginer une réinterprétation et des arrangements convaincants. D’ailleurs, j’avais une longue liste de titres que j’envisageais d’inclure sur cet album et à laquelle j’ai dû presque entièrement renoncé parce que je me suis aperçu que ça ne fonctionnait pas, tout simplement. J’ai fini par retenir beaucoup de morceaux très simples et épurés, avec peu d’accords : For Real, 1976 de Flowers n’a que deux accords ; Amsterdam, 1970 de John Cale deux accords ; Would You Believe In Me, 1973 également. C’est plus facile à travailler et ça ouvre davantage de possibilités pour imaginer d’autres arrangements. J’ai aussi décidé de retenir plusieurs chansons qui existaient déjà au moins dans deux versions différentes. Pour I’m Willing, 1973 il y a la version originale de The Moments mais il y a aussi une reprise de Harry Ray en 1982. Lost In The Paradise, 1969 de Caetanao Veloso a également été interprétée par Sergio Mendes. A chaque fois, j’ai essayé de conserver au moins un élément de chacune de ces versions pour m’en inspirer et les fusionner ensuite.
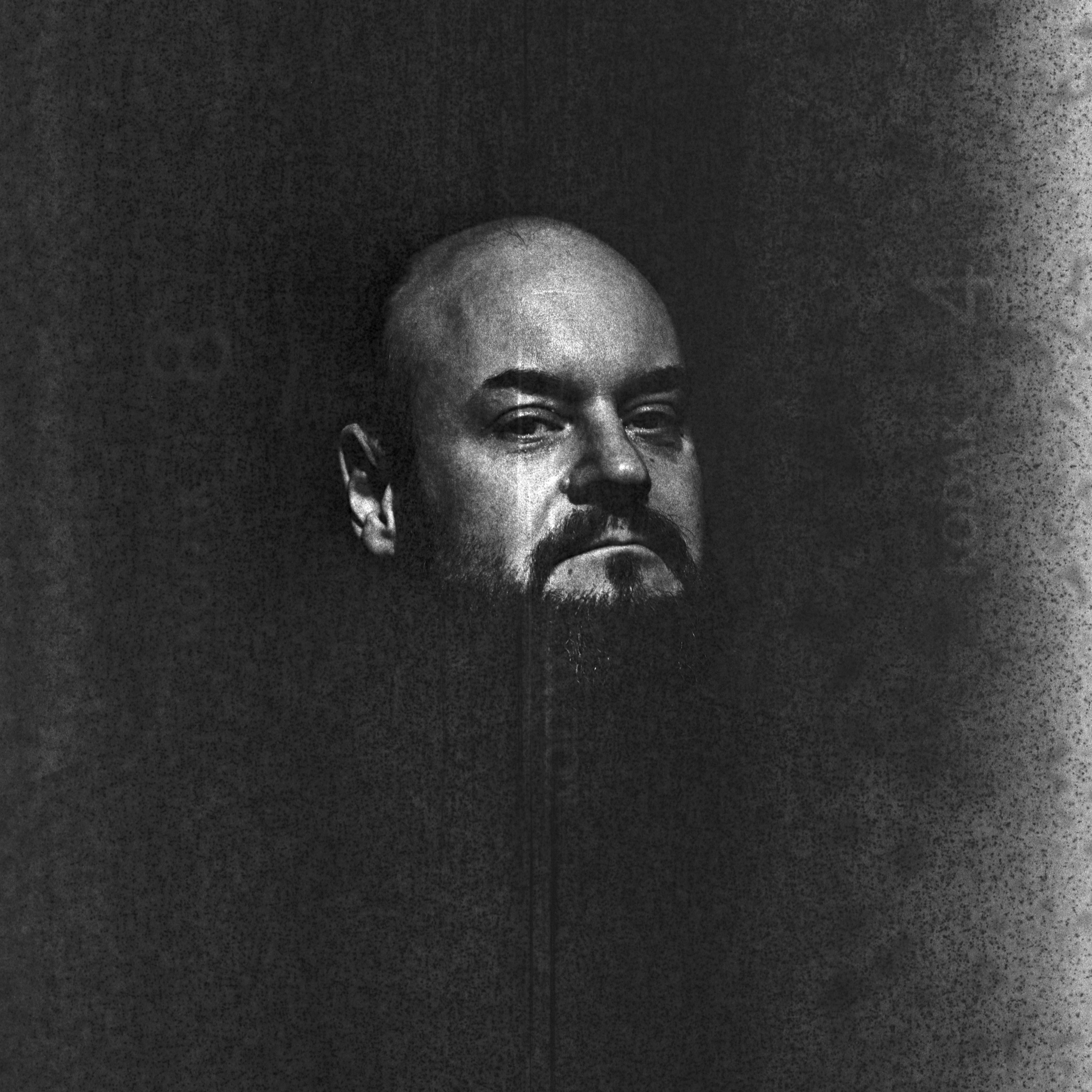
Au quotidien, comment arrives-tu à combiner tes activités professionnelles et musicales ?
Quand je suis en train de terminer une chanson ou qu’une deadline approche, je me lève généralement vers quatre ou cinq heures du matin pour consacrer une heure ou deux à la musique avant de réveiller ma fille et de commencer ma journée. Le reste du temps, je suis plutôt flemmard. Pour ce qui est des vacances, je consacre la plupart de mes jours de congé aux tournées. J’essaie de venir en Europe deux fois par an pour les concerts et pour travailler sur différents projets. Depuis deux ou trois ans, j’ai notamment commencé à travailler sur un futur album de Marker Starling avec Sean O’Hagan qui a accepté de le produire avec moi. Nous avons déjà réussi à caler quelques séances dans le studio d’Andy Ramsey, le batteur de Stereolab. Sinon, de temps en temps, j’arrive à travailler chez moi le soir mais c’est assez rare : ma femme travaille dans l’industrie cinématographique et elle est souvent en déplacement. C’est moi qui garde le plus souvent notre fille et je ne peux pas la laisser toute seule et m’enfermer des heures dans mon bureau.
Le son des claviers occupe une place très importante dans tes albums.
J’adore la chaleur qui se dégage de ces claviers vintage. J’ai conçu chacun de mes derniers albums exclusivement à partir d’un type de claviers : un Fender-Rhodes pou Anchors & Ampersands et un Wurlitzer pour Trust An Amateur. J’aime plonger intégralement dans un type de sonorités qui imprègne tout un album.
Tes textes sont souvent très ancrés dans l’observation du quotidien. En général, quels sont les thèmes ou les situations qui t’inspirent ?
C’est assez variable en réalité. Sur le dernier album, une chanson comme Crosstown Bulletin a effectivement été conçue comme une série de vignettes ou d’instantanés qu’aurait pu collecter un cycliste qui se serait promené dans Toronto. J’utilise beaucoup ce moyen de déplacement moi-même, surtout en été, et beaucoup d’idées de textes ou de mélodies surgissent quand je circule à vélo. Silver Morn évoque directement mon expérience de la paternité, c’est assez évident. Quand j’ai commencé à écrire des chansons, une bonne partie de mes textes est de nature plutôt introspective. J’évoquais souvent l’amour non partagé et je m’inspirai très largement de mes mauvais souvenirs d’adolescence. Et puis, quand Sadisfaction est paru, j’ai lu dans une chronique que le ton était très égocentrique. Ça m’a fait réagir : je n’avais du tout envie de passer pour un égocentrique ! (Rires) A partir de l’album suivant, j’ai essayé de combiner des éléments autobiographiques avec des observations du monde qui m’entoure. Pour Trust An Amateur, j’ai repris une partie des chansons que j’avais originellement composée, il y a plus de dix ans, pour un hommage à Kurt Vonnegut : Stony Flame et Mass Market Paperback en sont extraites.
Trust An amateur et Mass Market Paperback expriment également un point de vue assez critique sur les mondes de l’art et l’industrie du divertissement.
C’est vrai. Je suis plutôt fier de ce que j’ai réussi à accomplir en tant que musicien mais je n’ai jamais approché, même de très loin, le succès commercial. C’est un peu frustrant, mais ça ne m’empêche pas de continuer à composer ni d’espérer qu’un jour, peut-être, je gagnerai un peu d’argent. Cette phrase, « Trust an amateur/Don’t trust a professionnal » m’est venue à l’esprit un matin. L’avantage que je peux percevoir à conserver ce statut d’amateur, c’est que je peux continuer à enregistrer ce dont j’ai envie, sans aucune considération commerciale ou aucune pression économique. Je ne te cache pas que, d’un autre côté, j’aimerai bien jouer devant un public un peu plus nombreux. Je ne cherche pas du tout à critiquer les musiciens professionnels. Cette chanson, c’était simplement pour leur rappeler d’une manière amusante et un peu provocatrice que nous existons aussi, nous, les amateurs.


