
Plus d’un demi-siècle de carrière et plusieurs vies musicales. C’est tout le temps qu’il a fallu pour que le jeune apprenti footballeur, stagiaire pro au club de Bradford, se mue, décennie après décennie, en l’un des interprètes ET des auteurs les plus considérables et les plus mal estimés de l’histoire du folk-rock. Et du country-rock. Et aussi de multiples autres styles, effleurés ou explorés tout au long d’une discographie dont il est devenu quasiment impossible de recenser exhaustivement toutes les dérivations tant s’y entremêlent les projets et les références. Alors que Cherry Red Records continue de tenter de remettre un peu d’ordre dans les archives plus que pléthoriques de l’ancien chanteur de Fairport Convention – plusieurs box-sets ont déjà été publiées, d’autres vont bientôt suivre – Iain Matthews publie cet automne un nouvel album solo, How Much Is Enough qu’il présente lui-même comme un ultime tour de piste.
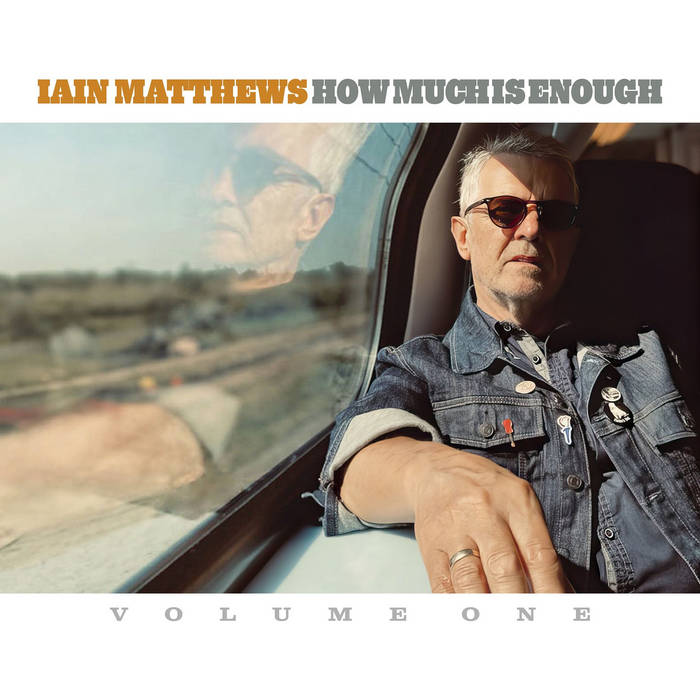 How Much Is Enough vient de sortir et son titre résonne presque de manière ironique. Depuis une dizaine d’années, tu as déjà évoqué à plusieurs reprises ton désir de clore définitivement ta discographie – plus que pléthorique, puisqu’il s’agit de ton cinquante-deuxième album. Qu’est-ce qui t’a décidé à en enregistrer un de plus ?
How Much Is Enough vient de sortir et son titre résonne presque de manière ironique. Depuis une dizaine d’années, tu as déjà évoqué à plusieurs reprises ton désir de clore définitivement ta discographie – plus que pléthorique, puisqu’il s’agit de ton cinquante-deuxième album. Qu’est-ce qui t’a décidé à en enregistrer un de plus ?
Iain Matthews : J’avais enregistré un album, Distant Chatters (2022) en duo avec BJ Baartmans – qui a également accepté de produire How Much Is Enough –il y a environ trois ans et il me restait quelques chansons de côté, que je n’avais pas pu terminer à ce moment-là. C’est ce qui m’a motivé à continuer d’écrire – ou de coécrire – encore quelques chansons de plus. Et puis, avant même que j’ai le temps d’y réfléchir, je me suis de nouveau retrouvé avec une vingtaine de nouveaux titres sur les bras. Et quand j’arrive à ce genre de nombre, je sais que le temps est venu d’en faire quelque chose même si je ne sais pas toujours très précisément quoi. Je me suis dit que ce serait une bonne idée d’enregistrer un dernier album solo.
Et pourtant le sous-titre – Volume 1 – laisse espérer une suite ?
Iain Matthews : Je ne crois pas… C’était davantage un petit clin d’œil humoristique qu’autre chose. En tous cas, je n’ai aucun projet d’avenir très précis.
Quel est aujourd’hui la place qu’occupe le songwriting dans ta vie de tous les jours ?
Iain Matthews : Je n’ai plus la motivation ou l’énergie nécessaires pour m’astreindre à écrire ou à composer tous les jours. J’ai souvent des idées de thèmes ou de titres qui me traversent l’esprit mais je ne les note pas de façon systématique. Ce n’est pas une routine ni une discipline. Mais il y a des jours où l’envie revient, plus forte. Quand on a écrit des chansons pendant trente ou quarante ans d’affilée, il n’y pas vraiment d’interrupteur ! C’est presque de l’ordre du réflexe : n’importe quelle situation, même la plus triviale, peut déclencher l’envie d’écrire.
La première chanson de l’album, Ripples In A Stream, m’a rappelé My Way : c’est le bilan d’une vie, dressé à l’approche de la mort. J’imagine qu’elle s’est imposée comme une évidence en ouverture ?
Iain Matthews : A vrai dire, c’est principalement pour des raisons d’ordre musical qu’elle occupe cette place particulière. J’aimais bien ce rythme un peu funky de basse et de batterie. Mais oui, les paroles constituent aussi un bon point d’entrée, c’est vrai. C’est une chanson qui jette assez bien les bases pour le reste de l’album.
Where Is The Love et New Dark Ages abordent des sujets plus politiques. Comment t’y prends-tu pour écrire sur l’état du monde sans pontifier ?
Iain Matthews : J’essaie de me concentrer sur mes propres émotions. En tant que songwriter – ou, tout simplement, en tant qu’être humain – je suis nécessairement conscient de ce qui se passe dans le monde. Je regarde le journal télévisé tous les soirs, religieusement. Celui de la BBC. C’est peu dire que ce que je vois ou que j’entends me contrarie. J’ai toujours eu du mal à supporter les brutes et les tyrans. J’ai toujours estimé que mes réactions personnelles ou mes sentiments de tristesse face à l’injustice faisaient partie de la gamme des émotions qu’il était pertinent de chercher à communiquer aux autres au travers d’une chanson. Au même titre que la passion ou le chagrin amoureux.
Le texte de Santa Fe Line s’inscrit très explicitement dans un décor et des paysages américain alors que la musique est très imprégnée de références celtiques. Qu’est-ce qui t’a donné l’idée de ce contraste très prononcé ?
Iain Matthews : C’était une décision constante de jouer de ce contraste de styles, en tous cas. L’idée m’est venue en discutant avec mon ami Steve Postell – un songwriter qui habite à Los Angeles – qui a coécrit la chanson avec moi. Je travaille souvent avec lui quand je retourne, de temps en temps, en Californie. Nous nous amusons souvent à essayer d’écrire une chanson à partir d’un thème imposé, d’un mot ou d’une expression. Ce jour-là, il avait envie que nous essayions d’écrire une chanson qui aurait pu être composée en 1967 pour un des premiers albums de Fairport Convention. L’histoire est totalement inventée. Nous avons commencé par trouver le nom du personnage – Smokestack Jack – et la trame narrative est apparue à partir de là.
La chanson Rhythm & Blues rend hommage à certains de tes héros d’adolescence…
Iain Matthews : Pour ce titre, je me suis inspiré du film des frères Coen O’Brother (2000) et plus précisément à la scène où les sirènes chantent au bord de la rivière : « Oh people, come on down… ». J’ai commencé à m’amuser à la guitare avec cette bribe de mélodie et, quelques minutes plus tard, j’avais mes propres paroles. « Down to the river and sing » s’est transformé en « down to the rythm and swing ». Ça m’a fait penser à la manière dont j’ai pu être influencé – même si ça n’est pas toujours évident – par les musiques noires américaines. J’ai grandi dans un environnement où la musique n’était pas toujours très présente mais, au début des années 1950, ma mère était très fan de ces groupes commerciaux de chanteurs noirs – des quartets pour la plupart. Notamment un groupe qui s’appelait Deep River Boys qu’elle adorait. C’est comme cela que j’ai commencé à découvrir la musique noire et ça m’a rendu suffisamment curieux pour que, à l’adolescence, j’ai envie d’explorer d’autres pistes et que je finisse par découvrir Curtis Mayfield puis Otis Redding et ensuite Aretha et toute la Motown. Et même, plus tard, pour que je m’intéresse aux pionniers du rap, même si je ne suis ni un fan ni un spécialiste de rap. Disons que, à plusieurs moments clefs dans ma vie, tous ces gens ont joué un rôle important et m’ont influencé, ne serait-ce que dans ma façon d’appréhender la musique. Comme souvent, une fois que le flux de l’inspiration s’enclenche, j’ai l’impression que les chansons s’écrivent quasiment elles-mêmes. En tous cas pour les paroles. Je les ai envoyées à Freddy Holm, un autre ami norvégien qui avait produit mon précédent album, Fake Tan (2020) parce que j’avais l’intuition qu’il trouverait la bonne musique pour les accompagner. Et, finalement, c’est ma chanson préférée de l’album, je crois.
Puisque tu évoques Fake Tan – cet album de reprises de quelques-uns de tes morceaux les plus anciens enregistré avec The Salmon Smokers – je me demandais ce qui t’avais poussé à y inclure une nouvelle version de Woodstock, une chanson que tu as dû jouer, j’imagine, des milliers de fois ?
Iain Matthews : A vrai dire, ce n’est pas vraiment moi qui ai pris la décision. Nous nous étions mis d’accord, avec Freddy, sur une première liste d’une quarantaine de titres et je l’ai laissé choisir ceux qui lui paraissaient le plus adaptés au style et aux points forts du groupe. Pour Woodstock, il avait envie de la transformer pour qu’elle ressemble à un extrait inédit de Pet Sounds (1966). Une fois l’enregistrement terminé, j’ai fini par comprendre ce qu’il voulait dire et par entendre ces petites touches qui rappellent, effectivement, Brian Wilson.
Tout au début de ta carrière, comment est née ta passion pour les songwriters américains ?
Iain Matthews : Tout a commencé un peu après que j’ai rejoint Fairport Convention. Notre manager et producteur – Joe Boyd – était américain. Avant de s’installer en Angleterre, il avait travaillé pendant plusieurs années, pour le festival de Newport. Il connaissait déjà très bien toute cette nouvelle génération de jeunes songwriters qui n’avaient pas tous enregistré d’albums, à ce moment-là. Il avait déjà rencontré Joni Mitchell et Leonard Cohen et Richard Farina et tous ces gens hyper-talentueux. Il avait accès directement à toute ces chansons et c’est lui qui a commencé à nous les faire écouter. Dans les deux premières années de Fairport, c’était l’essentiel de notre nourriture musicale. Nous ne composions pas énormément de chansons originales, en tous cas pas au début. L’essentiel de notre répertoire était constitué de reprises de morceaux de ces jeunes auteurs américains méconnus et que, souvent, ils n’avaient pas encore enregistrés eux-mêmes à ce stade. Même Dylan. Dylan était déjà très apprécié en 1967 mais pas forcément par le très grand public. Tout cela formait une sorte de réservoir inépuisable, un puits de musique sans fond auquel Joe avait accès. C’est ce qui a nourri ma passion pour les chansons américaines et qui m’a donné envie, peu de temps après, de m’installer aux USA pour vivre pleinement au milieu de cette effervescence créative et tenter d’y participer.

Ce désir de découverte n’a pas disparu ensuite, même quand tes liens avec Joe Boyd sont devenus plus distants. Comment arrive-t-on à tomber sur le premier album de Steve Young en 1969 pour y dénicher Seven Bridges Road ? Ou, plus tard, sur le répertoire de Jules Shear pour lui consacrer un album entier – Walking A Changing Line (1988) ? En flânant chez des disquaires ? Ou grâce à des éditeurs ?
Iain Matthews : J’ai toujours écouté énormément de disques. J’ai toujours été très intéressé et curieux de découvrir ce que les autres musiciens enregistraient. Même avant d’intégrer Fairport, je passais déjà beaucoup de temps à fouiller dans les bacs des disquaires et à solliciter les conseils et les avis des amateurs pour me tenir au courant des dernières nouveautés. C’est comme cela que je suis tombé sur Jesse Winchester. Ou, en partie, sur les premières chansons signées par Joni Mitchell. Souvent je commençais par regarder les pochettes en me disant : « si la pochette est bonne, la musique doit l’être aussi. » Cette curiosité n’a jamais complètement disparu. Je continue de demander à mes amis ce qu’ils ont aimé dans les derniers mois et ce qu’ils pourraient me conseiller, qui serait susceptible de me plaire. C’est de cette façon que j’étais tombé à l’époque sur le premier album de Steve Young, par le bouche à oreille amical.
Les albums de Matthews Southern Comfort et tes premiers albums solo ont joué un rôle important dans l’émergence du country-rock au début des années 1970. Avais-tu, à l’époque, l’impression d’apporter une contribution personnelle à un mouvement musical plus large ?
Iain Matthews : Un peu. Mais je n’ai jamais vraiment raisonné en termes de scènes ou de courants musicaux. Je me suis inspiré de ce que j’aimais chez d’autres à cette époque pour tracer mon propre chemin. Je suis bien convaincu qu’il y a beaucoup d’éléments dans mes chansons qui proviennent de ce que j’ai écouté. Mais je crois que c’est quelque chose d’assez naturel chez un songwriter : quand on entend une bonne chanson, on a envie non pas de la copier mais de voir si elle peut correspondre à ce qu’on cherche soi-même à créer. C’est comme cela qu’on grandit et qu’on progresse. Quelque soit le style, quelque soit le moment dans ma carrière, j’ai toujours cherché à prolonger des découvertes musicales qui me plaisaient et parce qu’elles me plaisaient. Pas parce qu’elles appartenaient à un courant musical prédéfini.
Le programme de rééditions mis en en place par Cherry Red a permis de regrouper ta discographie des années 1970 et 1980 en périodes très distinctes. I Can’t Fade Away, The Rockburgh Years 1978-1984 est sorti en 2022. Thro’ My Eyes, The Vertigo Years 1970-1974 vient d’être publié au mois de décembre. A quoi est-due l’extrême diversité de tes œuvres à cette époque ?
Iain Matthews : Pour ce qui est des albums de la période Rockburgh, je me suis sans doute un peu trop laissé influencer par les modes et par mon producteur, Sandy Robertson, qui était aussi le boss de Rockburgh Records. Il avait une conscience très juste et très profonde de ce qui était susceptible de se vendre ou pas. S’en était même, parfois, douloureux parce qu’il essayait de me diriger dans la direction qui lui semblait la plus pertinente sur le plan commercial. En ce qui concerne l’écriture, je ne crois pas que les chansons de cette période aient été si différentes. Mais le travail en studio n’était plus du tout comparable à ce qu’il pouvait être au début des années 1970. Il était sincèrement persuadé qu’en modifiant mon style musical, tout irait mieux pour moi et que j’en retirerais toute sorte de bénéfices – matériels ou symboliques. Au bout d’un moment, il est devenu évident que ce n’était pas le cas. J’avais perdu toutes mes illusions et une bonne partie de ma passion. Quand mon dernier album chez Rockburgh est sorti – Shook (1983) – je ne savais même plus très bien ce qu’étaient ces chansons. Je ne me souvenais même plus de les avoir composées ou enregistrées et je n’y reconnaissais plus rien qui m’appartienne. J’étais complètement perdu. C’est à ce moment-là que j’ai décidé d’arrêter complètement d’enregistrer de la musique et que je suis devenu directeur artistique pendant quelques années. Avec le recul, j’ai fini par me dire que c’était une bonne chose : cela m’a donné du temps pour réfléchir à qui j’étais vraiment en tant qu’auteur ou qu’interprète. Et de revenir ensuite à l’essentiel. J’ai vraiment l’impression que la seconde partie de ma carrière – celle qui a recommencé à partir de 1990 – est beaucoup plus cohérente que la première, même si elle n’est pas aussi connue. Tout a changé quand je suis parti de Los Angeles pour m’installer à Austin, d’abord, puis quand je suis revenu en Europe au début du siècle. La première partie est très fragmentée, dispersée. Depuis trente ans, la route que j’ai empruntée est beaucoup plus droite.
Cela ne t’a pas empêché d’emprunter quelques chemins de traverse, notamment dans tes albums avec Egbert Derix ou avec le Searing Quartet.
Iain Matthews : J’adore le jazz et j’en ai toujours beaucoup écouté. Je n’ai jamais prétendu que je pouvais être un chanteur de jazz mais c’est une autre influence qui a souvent été présente, directement ou non, dans mes chansons. Egbert, qui habite pas très loin de chez moi, dans la même ville, m’a donné l’occasion d’explorer un peu cet univers. J’ai adoré ces deux albums que nous avons enregistrés ensemble. Mais, au final, je suis que je suis.
Pendant les trois ou quatre années où tu travaillais comme directeur artistique pour Island, tu as signé des groupes qui faisaient partie du Paisley Undeground comme The Long Ryders ou Rain Parade. Qu’est-ce qui te plaisait chez eux ?
Iain Matthews : J’ai toujours été plus sensible aux qualités musicales qu’à l’originalité. J’étais très impressionné par la manière dont ces deux groupes en particulier parvenaient à se réapproprier très librement ce qui s’était déroulé vingt ans plus tôt, dans les années 1960, et que j’avais moi-même vécu en direct, tout en l’intégrant à leurs propres chansons. Il y avait des songwriters vraiment très doués dans chacun de ces groupes.


