
C’est un samedi après-midi, à Londres – le Londres d’avant l’Eurostar, où pour s’y rendre il faut un bus ou un train, un ferry, puis un train ou un bus qui nous dépose à Victoria Station au tout petit matin. C’est un samedi après-midi à Londres, et les éclaircies succèdent aux averses. Je ne sais plus si c’est l’automne ou le printemps mais je me souviens du pub. Un pub avec une terrasse dont nous ne profiterons pas. Un pub empli à craquer, à Notting Hill – je suis à peu près sûr que nous étions d’abord passés à Rough Trade, à l’adresse historique sur Talbot Road. Ils sont installés dans un coin, ils sont avec des amis – dont Will Pepper, qui est alors connu pour être l’ancien bassiste d’un groupe nommé Thee Hypnotics (et sincèrement, je ne sais pas pourquoi je me souviens si précisément de cette présence).
 Ils, ce sont trois des quatre membres d’East Village (c’est John qui est absent), un groupe qui n’existe alors déjà plus et qui est pourtant sur le point de sortir son premier album, Drop Out, sur un label qui colle si précisément à nos envies du moment que c’en est étourdissant.
Ils, ce sont trois des quatre membres d’East Village (c’est John qui est absent), un groupe qui n’existe alors déjà plus et qui est pourtant sur le point de sortir son premier album, Drop Out, sur un label qui colle si précisément à nos envies du moment que c’en est étourdissant.
Le label, fondé par un érudit passionné, Jeff Barrett, c’est Heavenly Recordings, celui qui publie aussi les disques de Saint Etienne, le projet de deux garçons de notre génération qui ont à peu près les même lubies – vous le croirez ou pas, mais à cette époque, on n’était pas si nombreux à chérir les disques de Codeine et de Pulp, de Felt et de Bitch Magnet, des Field Mice et de Dusty Springfield. C’est aussi le label qui publie les disques de Flowered Up, d’Espiritu, des Manic Street Preachers, le label qui publie Something Beginning With O, le manifeste pop de Kevin Pearce dont j’ai remarqué la plume quelques mois plus tôt dans le sobre livret accompagnant le coffret des rééditions de Felt (oui, vous avez raison, il n’y a pas de hasard), ou un roman de Paolo Hewitt, l’ex-Cappuccino Kid des pochettes du Style Council. Il y a du bruit et des pintes sur les tables, il y a beaucoup de sourires, pas mal d’humour pince-sans-rire et quelques déclarations qui auraient dû passer à la postérité.
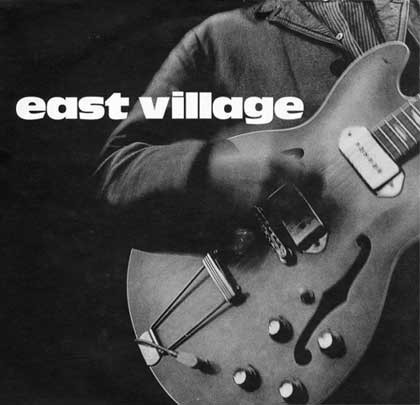 East Village, je les ai découverts quelques mois plus tôt, par l’intermédiaire de Daniel, avec qui je travaille à la boutique de disques qui s’appelle la Danceteria – un job que j’ai trouvé juste au sortir de mon service militaire, grâce à Jérôme, un des deux vendeurs alors en place qui partaient ouvrir Rough Trade Paris. Parce que oui, j’étais passé à côté des premiers singles parus sur Sub Aqua, le premier label créé par Barrett en 1988. J’étais passé à côté de ces pincements de cordes comme autant de pincements au cœur, à côté de ces mélodies qui érigeaient la mélancolie en art de vivre, à côté de ces chansons taillées pour l’éternité – d’ailleurs, je les réécoute ce matin, elles ont trente ans et quelques, vraiment pas une ride et les émotions qu’elles suscitent sont parfaitement intactes, comme la première fois (et c’est quand même assez rare). J’étais passé à côté de la genèse de ce groupe qui se targuait d’avoir dans ses rangs trois songwriters : les frères Kelly – Paul l’aîné et Martin le cadet – et leur ami John Wood. Par petite annonce, ils avaient recruté le batteur Spencer Smith et fondé Episode Four. Un maxi déjà parfait, Strike Up Matches – si vous en doutez, vous pouvez directement partir écouter Again And Again – sorti sur le label au nom improbable de Lenin & McCarthy Records (j’ai compris il n’y a que quelques semaines le clin d’œil potache à Lennon & McCartney…) et puis s’en vont. Enfin presque. Parce que ces gens-là ont, je crois, la musique dans la peau. Enfin pour la fratrie Kelly, j’en suis sûr. La faute aux deux sœurs aînées qui les ont embringués dans les concerts de la scène punk de 1976, la faute à leur curiosité. Car les deux garçons ne s’arrêtent pas là, remontent le temps, finissent par vouer un amour déraisonné pour les formes suggestives des guitares demi-caisses, pour la pureté de ces accords imaginés par les Byrds ou les Beatles, Bob Dylan ou Buffalo Springfield. Il n’empêche. Nous sommes en 1986 et Episode Four suscite une indifférence quasi-générale, alors les garçons pensent à arrêter. Ce qui serait sans doute arrivé s’ils n’avaient pas croisé Barrett, qui à l’époque travaille comme attaché de presse indépendant pour Creation Records (puis, un peu plus tard Factory – vous mesurez le CV ?) et organise aussi des concerts dans l’un de ces pubs londoniens.
East Village, je les ai découverts quelques mois plus tôt, par l’intermédiaire de Daniel, avec qui je travaille à la boutique de disques qui s’appelle la Danceteria – un job que j’ai trouvé juste au sortir de mon service militaire, grâce à Jérôme, un des deux vendeurs alors en place qui partaient ouvrir Rough Trade Paris. Parce que oui, j’étais passé à côté des premiers singles parus sur Sub Aqua, le premier label créé par Barrett en 1988. J’étais passé à côté de ces pincements de cordes comme autant de pincements au cœur, à côté de ces mélodies qui érigeaient la mélancolie en art de vivre, à côté de ces chansons taillées pour l’éternité – d’ailleurs, je les réécoute ce matin, elles ont trente ans et quelques, vraiment pas une ride et les émotions qu’elles suscitent sont parfaitement intactes, comme la première fois (et c’est quand même assez rare). J’étais passé à côté de la genèse de ce groupe qui se targuait d’avoir dans ses rangs trois songwriters : les frères Kelly – Paul l’aîné et Martin le cadet – et leur ami John Wood. Par petite annonce, ils avaient recruté le batteur Spencer Smith et fondé Episode Four. Un maxi déjà parfait, Strike Up Matches – si vous en doutez, vous pouvez directement partir écouter Again And Again – sorti sur le label au nom improbable de Lenin & McCarthy Records (j’ai compris il n’y a que quelques semaines le clin d’œil potache à Lennon & McCartney…) et puis s’en vont. Enfin presque. Parce que ces gens-là ont, je crois, la musique dans la peau. Enfin pour la fratrie Kelly, j’en suis sûr. La faute aux deux sœurs aînées qui les ont embringués dans les concerts de la scène punk de 1976, la faute à leur curiosité. Car les deux garçons ne s’arrêtent pas là, remontent le temps, finissent par vouer un amour déraisonné pour les formes suggestives des guitares demi-caisses, pour la pureté de ces accords imaginés par les Byrds ou les Beatles, Bob Dylan ou Buffalo Springfield. Il n’empêche. Nous sommes en 1986 et Episode Four suscite une indifférence quasi-générale, alors les garçons pensent à arrêter. Ce qui serait sans doute arrivé s’ils n’avaient pas croisé Barrett, qui à l’époque travaille comme attaché de presse indépendant pour Creation Records (puis, un peu plus tard Factory – vous mesurez le CV ?) et organise aussi des concerts dans l’un de ces pubs londoniens.
En s’inspirant du nom d’un gang de la fin des sixties basé à Manhattan, les East Village Motherfuckers, réponse new-yorkaise aux White Panthers chers au MC5, le quatuor pense peut-être brouiller les pistes car ses chansons n’ont que peu à voir avec de bruyants manifestes politiques. Ces jeunes gens-là portent les Rickenbacker en étendard, imaginent des morceaux soulevés par des arpèges lumineux. Leurs voix se mêlent sur des refrains dévastateurs – parce que vraiment, à chaque fois, c’est comme un souffle au cœur (oui, encore ce mot). Parce que vous savez, on ne sort pas indemne d’une rencontre avec les chansons d’East Village. Elles sont de celles qui suggèrent toute la beauté du sentiment amoureux, offrent leur fragilité avec un sacré aplomb. Alors, tout aurait pu aller dans le meilleur des mondes puisqu’en 1988, les groupes à guitares sont promis au plus bel avenir. Deux ans plus tôt, le NME s’est ingénié à faire éclore une scène qu’il a baptisée C86, d’où s’échappe un nombre incalculable de formations, de McCarthy aux June Brides, des Bodines aux Wolfhounds, de The Jasmine Minks aux Pastels. De nouveaux labels indie voient le jour, inspirés entre autres par la structure écossaise Postcard, disparue pour être arrivée trop tôt. Et puis, tout le monde cherche un successeur aux Smiths, victimes d’un hara-kiri égotiste en plein été 1987. Dans de telles conditions, East Village aurait donc dû triompher. Car ces quatre garçons avaient tout pour eux, de leur allure impeccable tout droit sortie d’un film de la Nouvelle Vague à leurs paroles drapées de candeur – “There are no painters or poets anymore”, regrettent-ils ainsi sur Cubans In The Bluefields, le titre phare de leur single inaugural.
Ce morceau, on le retrouve bien sûr sur Hotrod Hotel, compilation déjà posthume lorsqu’elle paraît à l’origine en 1994 sur le label australien Summershine (puis rééditée en 2006 par la structure japonaise Excellent dans un format double-CD, accompagnée alors de l’album Drop Out). Ce morceau, c’est sans doute l’une des plus belles mélodies des années 1980 – et bien plus si affinités. Oui mais voilà : c’est oublier que c’est une époque qui a préféré The House Of Love à Felt. The La’s à East Village. Dommage, parfois, qu’on ne puisse réécrire l’histoire. Mais au moins a-t-on la possibilité de la revivre. Si le recul s’avère parfois d’une rare cruauté pour certains, il devient ici le plus sûr allié d’une formation dotée d’un sens mélodique hors du commun. Mais torpillée par sa paresse. Et jamais épargnée par la malchance. Peu de temps après la sortie de son second EP, Back Between Places – la limpidité étourdissante de la chanson éponyme et cette intro dont on ne se lasse jamais –, Sub Aqua doit fermer ses portes. Un instant, on pense que les quatre amis vont trouver refuge chez Creation, mais Alan McGee doit se dépêtrer de ses problèmes avec la major Warner. C’est donc Bob Stanley, un mélomane fan de la première heure déjà journaliste et pas encore “musicien”, qui casse sa tirelire en 1989 pour les envoyer en studio afin qu’ils enregistrent tant bien que mal des chansons destinées à un hypothétique premier album. Mais les médias et le public manifestent déjà d’autres appétences. À Manchester, on porte les jeans pattes d’eph’ et l’on invente une pop psychédélique destinée aux pistes de danse. Un peu partout, les nouvelles sonorités débarquées d’outre-Atlantique, accompagnées de substances multicolores, sortent de l’underground pour s’imposer à la lumière.
 East Village, pourtant, ne baisse pas les bras. Pas encore. De ces sessions chaotiques, finira par sortir un maxi sur Heavenly, Circles, mélopée hypnotique noyée dans un tourbillon de guitares, dont la face B, Here It Comes, est un classique absolu, imprégné de ce sentiment diffus de spleen idéal qui revient comme un leitmotiv dans ce répertoire si parfait. Mais il est trop tard. Car Paul, Martin, John et Spencer savent que le vent a tourné. “Nous nous sommes séparés parce que nous avons fini par comprendre que nous n’irions nulle part”, a confié un jour à la RPM l’aîné des Kelly. “En 1990, nous étions déjà potes avec Pete Wiggs et Bob Stanley, surtout, qui était journaliste au Melody Maker. Lorsque ce dernier m’a annoncé qu’ils allaient sortir un single, je trouvais l’idée idiote : ‘Pourquoi enregistrer des chansons alors que vous n’avez même pas de groupe ?!’ Mais en entendant Only Love Can Break Your Heart, je me suis rendu à l’évidence : en quinze jours, ils avaient réalisé un disque cent fois meilleur que ceux que nous nous évertuions à faire depuis dix ans. (Rires) Ce fut le coup de grâce…” Paradoxalement, « grâce » est l’un des termes qui viennent à l’esprit dès qu’il s’agit d’évoquer les compositions d’East Village. Si jamais vous ne les avez jamais entendues, le label américain Slumberland offre une (ultime ?) séance de rattrapage en réalisant en vinyle (enfin) la compilation Hotrod Hotel – la plupart des chansons réalisées en single et deux inédits. C’est un beau disque vous savez, un disque à chérir, un disque que vous allez user jusqu’à la corde, un disque gorgé de hits qui n’en ont jamais été et qui bien sûr n’en seront jamais (Her Fathers Son, Kathleen), un disque grâce auquel on comprend vraiment ce que l’on entend par “ligne claire”, un disque parfait à offrir à tous les gens qui comptent pour vous. Un disque parfait pour se dire que malgré tout, il y a encore de la place pour le rêve.
East Village, pourtant, ne baisse pas les bras. Pas encore. De ces sessions chaotiques, finira par sortir un maxi sur Heavenly, Circles, mélopée hypnotique noyée dans un tourbillon de guitares, dont la face B, Here It Comes, est un classique absolu, imprégné de ce sentiment diffus de spleen idéal qui revient comme un leitmotiv dans ce répertoire si parfait. Mais il est trop tard. Car Paul, Martin, John et Spencer savent que le vent a tourné. “Nous nous sommes séparés parce que nous avons fini par comprendre que nous n’irions nulle part”, a confié un jour à la RPM l’aîné des Kelly. “En 1990, nous étions déjà potes avec Pete Wiggs et Bob Stanley, surtout, qui était journaliste au Melody Maker. Lorsque ce dernier m’a annoncé qu’ils allaient sortir un single, je trouvais l’idée idiote : ‘Pourquoi enregistrer des chansons alors que vous n’avez même pas de groupe ?!’ Mais en entendant Only Love Can Break Your Heart, je me suis rendu à l’évidence : en quinze jours, ils avaient réalisé un disque cent fois meilleur que ceux que nous nous évertuions à faire depuis dix ans. (Rires) Ce fut le coup de grâce…” Paradoxalement, « grâce » est l’un des termes qui viennent à l’esprit dès qu’il s’agit d’évoquer les compositions d’East Village. Si jamais vous ne les avez jamais entendues, le label américain Slumberland offre une (ultime ?) séance de rattrapage en réalisant en vinyle (enfin) la compilation Hotrod Hotel – la plupart des chansons réalisées en single et deux inédits. C’est un beau disque vous savez, un disque à chérir, un disque que vous allez user jusqu’à la corde, un disque gorgé de hits qui n’en ont jamais été et qui bien sûr n’en seront jamais (Her Fathers Son, Kathleen), un disque grâce auquel on comprend vraiment ce que l’on entend par “ligne claire”, un disque parfait à offrir à tous les gens qui comptent pour vous. Un disque parfait pour se dire que malgré tout, il y a encore de la place pour le rêve.



Merci pour ce tres bel article, j’ignorai l’existence de cette compilation…….je passe commande !
je me souviens d’avoir vu a londres en janvier 2015 à l’union chappel les The Papas & The Mamas (Featuring Sarah Cracknell, Debsy Wykes, Paul Kelly, Martin Kelly) je garde un super souvenir de concert ( a l’epoque je fut pour un trimestre employé par le label cherry red)