
Quand j’ai entrepris, il y a déjà deux ans, Les années Lithium, un numéro spécial de mon fanzine Langue Pendue, Diabologum était évidemment l’une de mes obsessions les plus vivaces. D’abord parce que je n’avais cessé d’écouter et de réécouter le #3 depuis sa sortie, mais aussi parce que leurs deux premiers albums, et surtout quelques faces B, Tannis Root, ici, De tels actes de renoncement, là, laissées à l’abandon sur le bas de quelques maxi CD, continuaient de me hanter, par leur nature même, indomptable, chaotique, approximative, comme un miroir d’une post adolescence en pleine ébullition, inconsciente de ses propres limites. Ces disques étaient finalement autant une invitation à vivre différemment que de simples modes d’emplois musicaux, et c’est en ça qu’ils ont eu une importance primordiale. Oui, ici, on pouvait faire quelque chose qui dépassait le stade de l’imitation, oui, on pouvait dire des choses, et les dire bien, avec des mots à eux, à nous. Tout pouvait changer, à un niveau intime, peut-être, mais pour nous en ces années 90, c’était déjà beaucoup. Si notre jeunesse était un art, seul Diabologum en avait trouvé la formule, une formule qui les conduirait doucement, en perdant des plumes en chemin, vers le #3, chef-d’œuvre générationnel. Clair.
Le premier album de Diabologum donne l’impression d’un véritable travail collectif dans lequel vous explorez toutes sortes d’expression (reprises, collaboration, citations…). Quelles étaient vos méthodes de travail à l’époque ?
 Anne Tournerie : Je ne sais pas si on peut vraiment parler de « méthodes de travail » ! C’était très collectif, on passait beaucoup de temps ensemble. Difficile de dire d’où venaient les idées, elles surgissaient toutes seules. On mettait un disque, on pensait à quelque chose, qui en entraînait une autre… Michel (Cloup, NDLR) et Arnaud (Michniak, NDLR) apportaient l’essentiel, ils étaient géniaux, très inventifs, mais je crois que la complicité entre nous jouait aussi ; on pensait à plusieurs. On fonctionnait par collages, par détournements, on se laissait surprendre par le hasard un peu à la manière surréaliste, ou à la Burroughs. Je n’ai aucun souvenir des idées que j’ai amenées sur ce premier disque, de toutes façons, je disais à l’époque que mon rôle principal était de refaire du café. Je me souviens du jour où Michel est arrivé et a dit : « Tu as deux minutes ? On va avoir besoin d’une voix de fille ».
Anne Tournerie : Je ne sais pas si on peut vraiment parler de « méthodes de travail » ! C’était très collectif, on passait beaucoup de temps ensemble. Difficile de dire d’où venaient les idées, elles surgissaient toutes seules. On mettait un disque, on pensait à quelque chose, qui en entraînait une autre… Michel (Cloup, NDLR) et Arnaud (Michniak, NDLR) apportaient l’essentiel, ils étaient géniaux, très inventifs, mais je crois que la complicité entre nous jouait aussi ; on pensait à plusieurs. On fonctionnait par collages, par détournements, on se laissait surprendre par le hasard un peu à la manière surréaliste, ou à la Burroughs. Je n’ai aucun souvenir des idées que j’ai amenées sur ce premier disque, de toutes façons, je disais à l’époque que mon rôle principal était de refaire du café. Je me souviens du jour où Michel est arrivé et a dit : « Tu as deux minutes ? On va avoir besoin d’une voix de fille ».
Au départ, on a l’image d’un groupe amateur, un groupe de copains, plus qu’un groupe de musique jusqu’au disque Le Goût du jour. 
Pierre Capot : C’est exactement ça. On s’est rencontrés par l’intermédiaire de la radio. Personne n’a passé de petite annonce pour chercher des musiciens. On traînait ensemble, et seul Michel avait une vraie expérience de musicien. Arnaud trafiquait bien dans son coin mais de façon assez confidentielle. Anne et moi jouions un peu pour nous avec un autre guitariste (qui fait une courte apparition sur le premier album à travers un solo improvisé). Rien de tout ça n’était préparé.
Te souviens-tu de la façon dont vous commencez à enregistrer de la musique et quelles sont vos premières expériences de concert ?
Pierre : On s’est mis à bricoler avec le 4-pistes d’Arnaud en faisant feu de tout bois. On récupérait des sons à la télé, sur des disques improbables ; on demandait aux gens qui passaient de faire une petite contribution. C’était une période d’effervescence permanente. Michel et Arnaud avaient en permanence de nouvelles idées. On avait même commencé à fabriquer une jaquette de pochette (qui a servi de base au futur CD, là encore en détournant une image de Glen Baxter). Et puis Michel, qui avait signé chez Lithium avec Lucie Vacarme, nous a dit de ne pas nous précipiter. Il avait envoyé la démo à Vincent Chauvier (du label Lithium, NDLR) et, très vite, on a eu un retour positif et enthousiaste. Ça a été un élément déterminant car à partir de là, on a aussi travaillé avec les remarques et les critiques de Vincent. On est devenu un peu plus exigeants avec nous-mêmes, enfin dans la mesure du raisonnable.
Michel : On enregistrait beaucoup, on partait dans tous les sens. Pour le premier album, il y a trois fois plus de matière qu’on a mis à la poubelle. Vincent recadrait les choses, ça, les gars, non ! (rires). C’était assez cash, j’aimais ça chez lui, c’était parfois douloureux. Ce morceau est super, mais il faut retravailler tel moment… Celui est là n’est pas bien…
 Quel est votre quotidien à l’époque ?
Quel est votre quotidien à l’époque ?
Pierre : Anne et moi sommes un peu plus âgés que les autres. Je venais de finir mes études de lettres et je commençais à être prof. L’année de stage, je n’avais qu’une classe. Je me souviens avoir séché un conseil car le mixage à Nantes s’était un peu prolongé (au dernier moment, on avait enregistré un morceau avec Dominique A). Quand ma conseillère pédagogique est passée me voir, elle avait été étonnée du monde qui passait dans l’appartement, du bordel des instruments et se demandait quand je trouvais le temps de préparer mes cours. On passait notre temps dans les concerts, dans les magasins de disques, à la radio. On parlait musique, plus encore qu’on en jouait. Tout tournait autour de ça, tout le temps. On ne répétait jamais à cette époque. Tout se faisait en direct avec l’enregistrement, dans un moment presque unique où le morceau prenait forme progressivement.
Sylvia Tournerie s’occupe sur les deux premiers albums de l’identité visuelle du groupe, en fait-elle en quelque sorte partie? Est-ce que Diabologum est en quelque sorte l’émanation musical d’un collectif plus large?
Anne Tournerie : Sylvia est ma soeur. Elle faisait des études d’arts à Paris. Nous étions très proches, et quand il a été question de la pochette, j’ai proposé de faire appel à elle, et tout le monde était d’accord. Sylvia a accepté, on lui a envoyé nos idées, elle a composé la pochette à partir de ça, et elle a inventé Zelda & Flesh (deux personnages de bande-dessinée, NDLR). Sylvia a travaillé sur les deux premiers albums mais aussi sur des maxis , des flyers… Sur le deuxième album, elle a travaillé avec une amie avec qui elle était associée à l’époque. Elles avaient carte blanche et nous ont proposé des tas d’idées géniales, je me souviens qu’on a eu du mal à choisir, on a discuté des jours et des jours. Sylvia a eu un lien important avec le groupe, selon moi elle a réussi à exprimer visuellement ce que Diabologum cherchait à faire sur le plan musical à l’époque. On voyait fondamentalement les choses de la même façon, je crois, et on avait beaucoup de références communes.
Comment se passe la transition entre le premier disque et Le goût du jour ?
Anne Tournerie : Ce fut d’abord une année de séparation puisque je suis partie à Paris terminer mes études, et Pierre à Dreux pour le boulot. On se voyait tous ensemble chaque fois qu’on pouvait, c’est-à-dire pas si souvent que ça. On se téléphonait, on s’envoyait des cassettes par la poste. Il a très vite été question d’un deuxième album, on ne voulait pas s’en tenir là ! Il a fallu commencer à se poser des questions sérieuses, qu’on ne s’était jamais posées, en tous cas, pas moi. La question des droits d’auteur par exemple. Ça s’est décidé sans qu’il y ait besoin d’en discuter : Michel et Arnaud signaient les morceaux, c’était une évidence sur le plan créatif, et puis matériellement parlant, ils avaient besoin du statut d’auteurs. Ça correspondait aussi à l’évolution du groupe qui était liée en partie aux circonstances : ils composaient beaucoup plus tous les deux en amont, nous faisant découvrir les morceaux ensuite, quand on se retrouvait, ou en nous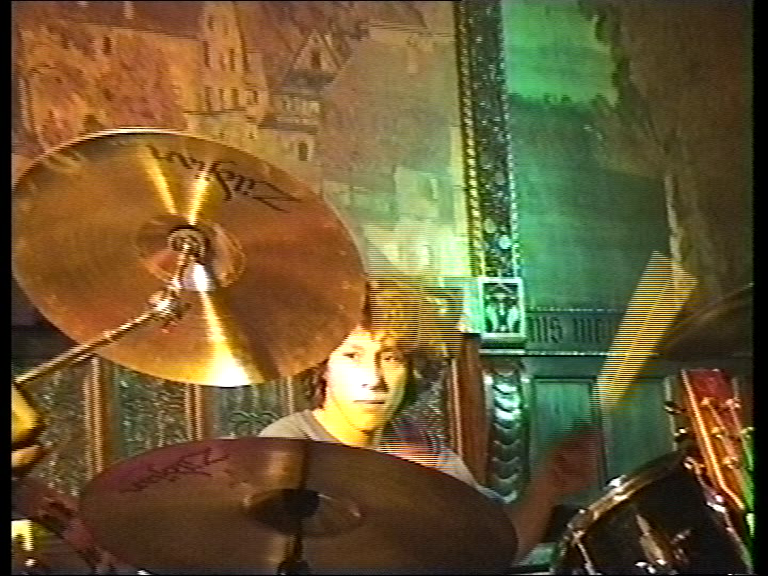 envoyant les maquettes. Après Denis (Degioanni, NDLR) nous a rejoint à la batterie, il a fallu monter le volume ! Et trouver un local, ce qu’on n’avait jamais eu. Et puis l’été est arrivé et on s’est mis à répéter quotidiennement, pour préparer l’enregistrement en studio.
envoyant les maquettes. Après Denis (Degioanni, NDLR) nous a rejoint à la batterie, il a fallu monter le volume ! Et trouver un local, ce qu’on n’avait jamais eu. Et puis l’été est arrivé et on s’est mis à répéter quotidiennement, pour préparer l’enregistrement en studio.
A propos d’une face B, De tels actes de renoncement, dans mon fantasme, c’est le morceau de l’accomplissement, entre ton écriture et celle d’Arnaud Michniak, est-ce qu’il y a de cela ?
Michel : C’est un des rares textes vraiment écrit à deux. J’ai un souvenir précis de cet après-midi où on jouait à une sorte de ping-pong / cadavre exquis un stylo à la main, en se marrant bien quand même. Diabologum a toujours été vu comme un groupe de croque-morts prétentieux, alors qu’on passait notre temps à se marrer et à faire les cons sans trop se prendre au sérieux.
Il est aussi annonciateur de #3, je trouve, avec cette fin de morceau toute en montée et qui va énoncer ce qui fera la substance de votre dernier disque.
Michel : Tout à fait, ce texte a été un déclic vers l’écriture du #3 même si le ton reste encore dans le côté slacker du Goût du jour. Les trois titres rajoutés du EP de L’art est dans la rue ont été écrit bien après l’album, nous étions déjà en transition vers autre chose, même si nous étions encore loin du #3.
 Je vous ai vus en concert à Colmar à cette époque, vous tourniez sur les instruments, mais on sentait quelque chose de carré, y avait-il une volonté d’être plus professionnel et d’envisager la suite de façon plus sérieuse pour toi, ou sentais-tu déjà que continuer cette vie (enregistrement, tournée) ne serait pas pour toi ?
Je vous ai vus en concert à Colmar à cette époque, vous tourniez sur les instruments, mais on sentait quelque chose de carré, y avait-il une volonté d’être plus professionnel et d’envisager la suite de façon plus sérieuse pour toi, ou sentais-tu déjà que continuer cette vie (enregistrement, tournée) ne serait pas pour toi ?
Anne Tournerie : Tant mieux si tu as trouvé ça carré ! On a beaucoup bossé pour les tournées, autant qu’on pouvait en tous cas, étant donné qu’on vivait loin les uns des autres. C’était important cette idée de tourner sur les instruments, et ça demandait un peu de synchronisation pour enchaîner les morceaux sans trop de temps morts. Avec les tournées, les choses devenaient plus sérieuses, quand les gens se déplacent pour venir te voir, tu veux forcément faire les choses le mieux possible, être à la hauteur. Avant de penser à l’avenir, on pensait déjà au présent, à la prochaine date. Personnellement, je n’avais aucune expérience de la scène, ni de ce qu’est une tournée. J’avais du mal à croire à ce qui m’arrivait, être là, c’était une aventure extraordinaire, incroyable, avec une possibilité d’avenir que je n’avais jamais envisagée réellement et en même temps j’avais un métier pour lequel j’avais étudié des années, qui me concernait, que je n’aurais pas lâché sans regrets. Alors c’était comme une double vie, un peu contradictoire et insoluble.
Y-a-t-il des débats à l’intérieur du groupe, et avec le label, sur le fait de ne se consacrer qu’à la musique ?
Pierre : Oui. Cela est devenu une source de tensions. Nos mutations nous avaient éloigné de Toulouse. Michel et Arnaud avaient abandonné la fac et se consacraient exclusivement à la musique. Ils voyaient bien que nous constituions un frein à la progression du groupe. Plusieurs discussions ont porté là-dessus. J’ai fait mon possible pour continuer mais à un moment, ils ont pris la décision pour nous. J’étais prof et je savais que ma chance de musicien était de jouer avec eux. Bien sûr que c’était tentant de se dire qu’on allait tout laisser tomber pour faire de la musique mais au fond de moi je savais bien que ce n’était pas vraiment envisageable (…). J’ai conscience d’avoir participé à une aventure géniale et c’était très frustrant de ne plus en faire partie, mais je me console en me disant que c’était une évolution nécessaire et que si le groupe a franchi un cap sur #3, c’est aussi parce qu’il s’est consacré à temps plein à ce projet, ce que je ne pouvais pas faire.

 La jeunesse est un art (
La jeunesse est un art ( Les entretiens complets seront à retrouver dans Les années Lithium, Langue Pendue n°11 – sortie en septembre 2020. Visuels : captures d’écran d’une vidéo de Fabrice Voné à Colmar, le 23/10/1994.
Les entretiens complets seront à retrouver dans Les années Lithium, Langue Pendue n°11 – sortie en septembre 2020. Visuels : captures d’écran d’une vidéo de Fabrice Voné à Colmar, le 23/10/1994.
