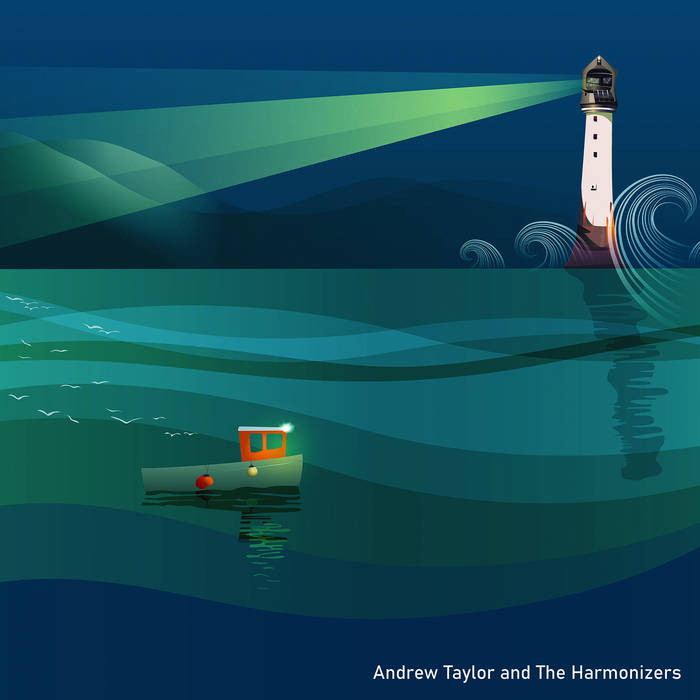 Écouter les mêmes notes ; ressasser les mêmes mots : depuis vingt ans, Andrew Taylor compose des chansons magnifiques et trop peu de gens s’en soucient. Le résumé des épisodes précédents tient donc en une seule sentence lapidaire et ce n’est sans doute la publication de ce nouvel album, vendredi prochain, qui infléchira radicalement la suite du récit. Rien ici n’est fait pour déjouer l’implacable réalisme des prévisions ni même les attentes des rares impatients, déjà séduits par l’œuvre considérable du petit maître écossais et de tous ses alias – Dropkick, The Boy With The Perpetual Nervousness. Mélodieux, harmonieux, imprégnés de ces lueurs sereines qui semble en permanence irradier des guitares, ces quatorze morceaux apparaissent comme autant d’ajouts subtils, de nuances soigneusement élaborées autour des multiples déclinaisons d’un modèle déjà familier. Ce d’autant plus qu’il s’agit ici – à une exception près, It’s Misery Again – d’une sélection du meilleur des quarante titres enregistrés en solitaire, pendant les mois de confinement, publiés une première fois dans les quatre volumes de The Lockdown Sessions, et remis en forme avec l’aide bienvenue de quelques proches collaborateurs – deux ex-membres de Dropkick, Alastair Taylor et Iain Sloan, et le claviériste actuel du groupe Ian Grier. On pourrait paresseusement se contenter de leur accoler l’étiquette adéquate – country-pop, pour ce qui est du genre ; Tom Petty ou The Jayhawks pour les références les plus commodes ou les plus évidentes – et les ranger dans les casiers correspondants en attendant la prochaine sortie – pas longtemps sans doute, compte-tenu de la productivité impressionnante du bonhomme.
Écouter les mêmes notes ; ressasser les mêmes mots : depuis vingt ans, Andrew Taylor compose des chansons magnifiques et trop peu de gens s’en soucient. Le résumé des épisodes précédents tient donc en une seule sentence lapidaire et ce n’est sans doute la publication de ce nouvel album, vendredi prochain, qui infléchira radicalement la suite du récit. Rien ici n’est fait pour déjouer l’implacable réalisme des prévisions ni même les attentes des rares impatients, déjà séduits par l’œuvre considérable du petit maître écossais et de tous ses alias – Dropkick, The Boy With The Perpetual Nervousness. Mélodieux, harmonieux, imprégnés de ces lueurs sereines qui semble en permanence irradier des guitares, ces quatorze morceaux apparaissent comme autant d’ajouts subtils, de nuances soigneusement élaborées autour des multiples déclinaisons d’un modèle déjà familier. Ce d’autant plus qu’il s’agit ici – à une exception près, It’s Misery Again – d’une sélection du meilleur des quarante titres enregistrés en solitaire, pendant les mois de confinement, publiés une première fois dans les quatre volumes de The Lockdown Sessions, et remis en forme avec l’aide bienvenue de quelques proches collaborateurs – deux ex-membres de Dropkick, Alastair Taylor et Iain Sloan, et le claviériste actuel du groupe Ian Grier. On pourrait paresseusement se contenter de leur accoler l’étiquette adéquate – country-pop, pour ce qui est du genre ; Tom Petty ou The Jayhawks pour les références les plus commodes ou les plus évidentes – et les ranger dans les casiers correspondants en attendant la prochaine sortie – pas longtemps sans doute, compte-tenu de la productivité impressionnante du bonhomme.

Pourtant, il y a dans cet album un je-ne-sais-quoi qui incite à prolonger l’écoute, bien sûr, et surtout l’effort pour tenter de transposer dans l’écriture un peu de cette belle ténacité dont Taylor a su faire preuve tout au long de ses décennies de confidentialité. Un rédacteur de la RPM proposait autrefois, non sans malice, d’amputer la note attribuée par lui à la chronique du énième album d’un groupe estimable mais adepte du statu quo – Stereolab, pour ne pas le nommer – d’autant de points que le lecteur possédait déjà de disques antérieurs. Ici, c’est exactement l’inverse. Tout est balisé et reconnaissable, aisément, mais tout est un peu mieux maîtrisé : les riffs un peu plus percutants – Not Running Out – les harmonies vocales qui accrochent le cœur un peu plus fort – Roundabout – les ornements de pedal steel ou les touches de claviers antiques à la Grandaddy – I’ll Never Win – encore mieux disposées qu’auparavant. C’est ainsi que Taylor s’impose un peu plus à chaque visite comme le peintre le plus pertinent de l’amour monogame de longue durée. Non pas qu’il restitue avec des mots particulièrement complexes ou rares les relations au long cours. Sa poésie simple et directe se contente de suggérer plutôt que de creuser ces émotions justes : la sérénité de la résignation qui alterne avec l’euphorie éphémère des instants de grâce. Ce qui bouleverse bien davantage se niche dans cette obstination musicale qu’il manifeste, à chercher à s’épanouir dans le même sillon, à prolonger, par petites touches incrémentales, les plaisirs de l’intimité familière qui se révèlent dans l’approfondissement des routines partagées plutôt que dans les tentatives illusoires pour s’en émanciper. C’est ce qui fait de ces chansons l’équivalent musical d’un clin d’œil ou d’un sourire complice adressé, en fin d’une journée épuisante, à l’être aimé et qui relèguent hors-champ toute préoccupation innovante. Ce n’est parce que l’on s’aime depuis vingt ans qu’il faut cesser de se le dire.
![]()


