
Rebecca Boulton est aux côtés d’Andy Robinson la manageuse de New Order et Joy Division depuis 1999. Celle qui a commencé en tant qu’assistante de Rob Gretton a accompli un travail monumental pour que les deux groupes figurent aujourd’hui au sommet de leur popularité. La tâche n’a pas été facile : rongé par des querelles internes, New Order est resté inactif pendant une décennie. Rebecca a malgré tout réussi à maintenir la popularité du groupe et à relancer leur carrière en 2011 avec le succès que l’on connaît. La qualité de son travail lui a valu d’être récompensée ce 14 novembre du saint graal convoité par toute équipe de management, le Manager’s Manager Award. Dans un rare entretien, elle nous parle de sa carrière qui a commencé derrière le bar de l’Hacienda, de sa relation avec New Order et de l’envers du décors d’une des réussite artistique et commerciale les plus fabuleuses de l’histoire de la musique.

Quels ont été tes premiers pas dans le monde du management ? Qu’est ce qui t’a poussé à t’orienter vers ce métier ?
Je suis originaire de la ville de Loughborough dans le Leicestershire. C’est une ville ennuyeuse connue pour son excellente université spécialisée dans le sport. Heureusement, comme dans toute ville étudiante, des groupes s’y produisaient régulièrement en concert. J’en suis partie pour étudier à l’université de Manchester. J’ai trouvé un job d’étudiant à l’Hacienda. Je travaillais au bar. C’est là que j’ai rencontré Rob Gretton, un des gérants de l’Hacienda, de Factory Records et manager de Joy Division et New Order. Au milieu des années 1980, il a eu besoin de quelqu’un pour l’assister. Il m’a proposé le job. Depuis ce jour, j’ai oublié de chercher un véritable travail (rire).
Comment décrirais-tu le travail de Rob Gretton, et qu’as-tu appris à ses côtés ?
Il avait un style de management très particulier. J’ai énormément appris en travaillant avec lui. En l’observant j’ai appris comment ne pas renouveler ses erreurs. Je ne dis pas ça de façon négative, sa façon de manager Joy Division au début et d’avoir réussi à développer leur carrière jusqu’au succès de New Order force le respect. Il avait beau être différent d’un manager classique, il avait raison sur toute la ligne. Quand j’ai commencé à travailler pour New Order, le groupe était déjà au top de sa carrière. J’avais pour mission de maintenir ce succès et de trouver les moyens de le développer au-delà.
New Order a continué à remporter de plus en plus de succès, ta fonction a dû rapidement évoluer.
Oui, en 1989 Rob a fondé son propre label, Rob’s Records. En parallèle, New Order avait plusieurs projets en cours. Nous avons déménagé dans des bureaux plus grands. Il y avait beaucoup de travail. Rob nous a malheureusement quittés en 1999. Andy Robinson, le tour manager de New Order, et moi-même avons proposé au groupe de prendre la suite de Rob. Étonnamment, ils ont accepté.

Est-ce lié au fait que vous faisiez déjà partie de “la famille” ?
Gillian Gilbert, Bernard Sumner et Stephen Morris sont des gens loyaux. Ils aiment l’idée d’évoluer en communauté. Nous faisions déjà partie de la leur. Ils auraient pu en profiter pour changer radicalement leur management, mais ce n’est pas leur style. Ils n’ont jamais quitté Manchester, c’est un signe…
Ta prise de poste correspond à une période où l’industrie musicale commençait à changer radicalement.
Avant sa mort, Rob m’avait déjà confié la lourde tâche d’anticiper ce changement en étudiant de nouvelles possibilités de rentrées financières. C’était une lourde tâche. Le fonctionnement que Rob avait connu à ses débuts avec Joy Division était complètement différent. Il y avait trois sources de revenus. Les tournées, les ventes de disques et le publishing si tu écrivais toi-même tes chansons. En 1999, les sources de revenus étaient bien plus diversifiées. Par exemple, la montée du merchandising avec les t-shirts ou des objets divers ou le développement du licensing pour utiliser ta musique dans les films ou des publicités. Tout s’était modernisé. On récupérait des droits sur la musique du groupe dans le monde entier. Rob n’a jamais connu tout ça. Par la force des choses, mon savoir en termes de management est devenu plus important que le sien. Juste avant sa mort, nous étions complémentaires. Il avait la vision, j’avais tout le reste.

Comment as-tu géré les baisses de ventes du groupe au moment où les téléchargements illégaux sont devenus considérables ?
C’était une période intéressante. Le premier album que j’ai dû gérer seule était Get Ready (2001). Je me souviens particulièrement d’une réunion chez Warner pour travailler sur la sortie du disque. Je voulais m’assurer que le catalogue du groupe soit disponible partout. Le staff de Warner n’en avait rien à faire des anciens albums. La priorité allait à la nouveauté. C’était un changement radical. Avant pour chaque sortie d’album, on s’assurait que les disques précédents soient disponibles en magasin à des tarifs attractifs. Des boutiques comme HMV jouaient le jeu. Aujourd’hui, c’est encore différent. Les labels savent qu’ils ne tireront pas grand-chose des nouveautés. Une des priorités est de promouvoir leur vieux catalogue pour en tirer le plus possible financièrement. Dès le début de la crise, je savais qu’ils allaient devoir capitaliser là-dessus, d’où mon étonnement pour la sortie de Get Ready. Les maisons de disques ont sous-estimé l’arrivée d’internet. Au lieu de s’y adapter immédiatement et de s’emparer du marché, elles sont restées trop longtemps à en subir les conséquences. Leur manque de réactivité en a fait des fournisseurs de contenu pour de grosses sociétés évoluant dans la technologie. Avant c’était l’inverse, les maisons de disques avaient le pouvoir.
As-tu travaillé avec d’autres groupes que New Order à la disparition de Rob ?
Non. C’est un collègue de bureau qui en a pris la responsabilité. Nous avions tous une forte connexion. Je ne suis pas partie en disant au revoir à tout le monde, car nous nous voyons encore régulièrement. J’ai juste repris la gestion du catalogue de Joy Division et New Order et leur management. C’est un job à plein temps. Je suis très occupée, même quand le groupe ne tourne ou n’enregistre pas.
Tu as fondé ta compagnie de management. Y avait-il une volonté de faire les choses en DIY ou de vouloir garder le contrôle de ta part ?
Étrangement, aucune société de management ne nous a démarchés. J’aurais pu en contacter, mais je voulais mon propre business model. Pour Rob, un bon manager devait être un membre à part entière du groupe. À cause de cela, il était rattaché aux sociétés que New Order possédait. Pour beaucoup de raisons, cela aurait été compliqué à mettre en place à mon niveau. Il était préférable de créer ma propre société. Je la dirige de manière indépendante avec un mode de fonctionnement traditionnel. Quand l’argent rentre, je reçois des commissions.
Lorsque tu es devenue manageuse de New Order en 1999, le groupe traversait une période compliquée après le décès de Rob. Les relations avec Peter Hook qui venait d’acheter le nom de l’Hacienda sans en parler au reste du groupe ont commencé à se tendre. Comment as-tu géré cela ?
Quand j’ai repris le management, New Order s’entendait bien. C’est peu de temps après que ce problème a progressivement fait surface. C’était une période très confuse. Rob et Peter étaient vraiment impliqués dans l’Hacienda avant que le club ne soit liquidé. Tout ça s’est fait entre eux, en parallèle. C’est plus tard que la situation est devenue tendue.

Quel rôle as-tu joué dans la signature sur le mythique label Mute Records, contemporain de Factory à la fin des années 70. Y avait-il une volonté de revenir à l’indépendance ?
Cette signature est une combinaison de plusieurs idées. Nous rencontrions de multiples problèmes à cette époque. Warner, particulièrement l’équipe de Londres, était d’un grand soutien. Ils étaient rigoureux, patients, intéressés. Avant tout, ils comprenaient ce que l’on voulait. Un ami nous a présentés officiellement à Daniel Miller, le fondateur de Mute Records. Nous nous connaissions déjà socialement, mais il a demandé à nous rencontrer formellement pour une réunion. Quand tu arrives avec un groupe au succès public et critique, il est compliqué de leur proposer un contrat. Va expliquer à Bernard, Gillian ou Stephen qu’ils ont fait de mauvais choix dans le passé et leur proposer ta vision. Ça risque de mal se passer… (rire) Dans ce cas, il est important de connaître la personne qui te propose un contrat. Il faut lui faire confiance, croire en sa vision, mais surtout avoir de bons rapports avec elle. Tous les artistes, même les plus gros, ont besoin d’un peu d’aide. Que ce soit pour trouver des idées, rencontrer des producteurs ou autre.
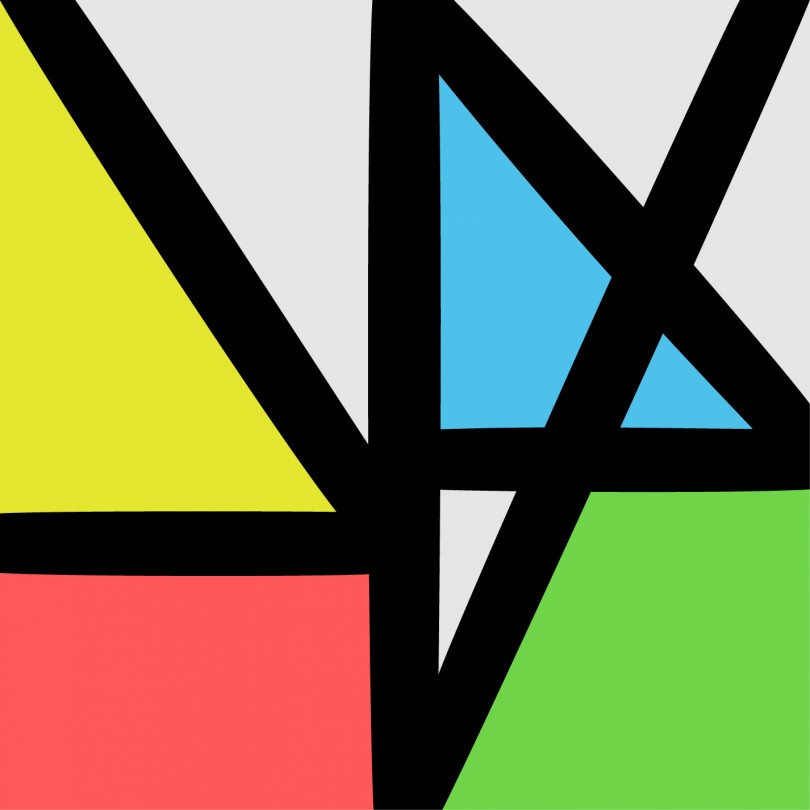 Daniel est ce type de personne, c’est quelqu’un de confiance. Non seulement il a créé un des meilleurs labels au monde avec une intégrité artistique qui n’est plus à prouver, mais c’est surtout un producteur exécutif d’exception. Ce qu’il a fait avec Depeche Mode est remarquable. Même si le groupe a quitté Mute, Daniel est toujours le producteur exécutif de leurs albums. Le deuxième élément vient du fait que c’était le premier album sans Peter Hook et avec un nouveau line-up. Psychologiquement, ce projet allait être différent. Grâce à Mute, on a pu se l’approprier, ça a fonctionné. Music Complete (2015) est un album génial. Daniel Miller et son équipe ont travaillé dur. Ce sont des passionnés. Au niveau mondial, leur réseau pour distribuer l’album a été efficace.
Daniel est ce type de personne, c’est quelqu’un de confiance. Non seulement il a créé un des meilleurs labels au monde avec une intégrité artistique qui n’est plus à prouver, mais c’est surtout un producteur exécutif d’exception. Ce qu’il a fait avec Depeche Mode est remarquable. Même si le groupe a quitté Mute, Daniel est toujours le producteur exécutif de leurs albums. Le deuxième élément vient du fait que c’était le premier album sans Peter Hook et avec un nouveau line-up. Psychologiquement, ce projet allait être différent. Grâce à Mute, on a pu se l’approprier, ça a fonctionné. Music Complete (2015) est un album génial. Daniel Miller et son équipe ont travaillé dur. Ce sont des passionnés. Au niveau mondial, leur réseau pour distribuer l’album a été efficace.
Que reste ton plus beau souvenir ou ta plus grande fierté en tant que manager ?
Je vais en choisir plusieurs. Il y a eu de grands succès commerciaux comme des contrats ou des deals d’édition, mais c’est quelque chose d’ennuyeux à raconter. Je suis fière que depuis 2011, nous arrivions à travailler efficacement tous ensemble. On communique, nous sommes heureux lors des tournées mondiales. En 2011, le groupe a donné ses premiers concerts avec le nouveau line-up. Nous voulions collecter des fonds pour notre ami Michael Shamberg. Personne ne savait comment le groupe allait être accueilli par le public. Ça a été un énorme succès qui a donné suite à tout ce qui s’est passé depuis. A un niveau créatif, je suis fière des concerts donnés au Manchester International Festival en 2017. J’ai une réelle connexion avec ce festival, car il est brillant et à lieu à Manchester. J’y vais depuis des années. Le directeur artistique a changé en 2017. Il a ouvert le festival à des artistes de Manchester connus à l’international. New Order étant le plus gros de la région, il nous a demandé de nous investir. Ce concert avec des musiciens jouant du synthé dans des boîtes et une mise en scène de Liam Gillick nous a fait perdre de l’argent. Artistiquement, c’était un énorme succès. C’est grâce à ce genre d’événement que New Order façonne son histoire. On ne se souvient pas de Bowie parce qu’il a été tête d’affiche à Glastonbury, mais parce qu’il a su réfléchir au-delà des structures classiques des artistes pop.

La popularité de Joy Division ne cesse de croître. Quelle quantité de travail cela représente par rapport à New Order ?
Si l’on retire l’aspect tournée, en temps normal c’est du 50/50. Cela démontre à quel point Joy Divison est connu aujourd’hui. Cette année est particulière car elle marque l’anniversaire de Unknown Pleasures (1979). La popularité de Joy Division est due au fait que Bernard, Stephen et Peter ont accepté leur passé. Les membres ont vieilli. Ils ont écrit des livres sur leurs vies. Tous donnent beaucoup plus d’interviews qu’avant. Ils ont commencé il n’y a pas si longtemps que ça à parler de Ian Curtis. Il leur a fallu tout ce temps pour y arriver. Même avec moi. Internet a aussi permis l’accès à des visuels. Même si tu ne connais pas Joy Division, il y a des photos iconiques de Ian qui sont ancrées dans l’esprit des gens. Je pense également à la pochette de Unknown Pleasures. Tout cela fait que Joy Division est devenu important dans la conscience du public. S’ils ont toujours beaucoup vendu de disques, ils sont longtemps restés dans l’underground. Si seulement tous les gens qui portent des t-shirts Unknown Pleasures pouvaient acheter l’album… (rire)

Comment arrives-tu à limiter la contrefaçon ?
C’est impossible, sauf si c’est un business flagrant. Nous avons déposé les marques et les copyrights pour agir au besoin. Les trois dernières années, nous avons travaillé dur avec les sociétés de merchandising pour que des produits soient à disposition des détaillants pour contrer le marché illégal. Les grosses marques ne revendent pas de la marchandise pirate. Ils nous ont contactés car en observant le marché noir, ils se sont tous aperçu que les gens voulaient du Joy Division ou du New Order. C’est la raison pour laquelle on trouve des t-shirts chez Zara, H&M ou bien plus chic chez Raf Simons ou Sandro.
Tu vas recevoir le Manager’s Manager Award le 14 novembre prochain, une récompense très convoitée. Comment l’envisages-tu ?
Comme beaucoup de personnes dans cette situation, je n’arrive pas à comprendre pourquoi j’ai été choisie ! (rire) Par contre, je vis ça comme une réussite car il y a peu de femmes dans ce milieu. J’y évolue depuis de longues années et je vois rarement des femmes dans les réunions ou en tant que dirigeantes. Les attitudes ont changé mais les femmes ne sont toujours pas perçues de la même manière. Il est temps que ça évolue.



