
Cinq jalons – un par décennie – pour évoquer cinquante ans de carrière. C’est évidemment bien trop peu pour rendre compte de l’extraordinaire foisonnement de la discographie des Nits. Il a donc fallu choisir, avec toute la part d’arbitraire que comporte une sélection subjective, retrancher, restreindre, regretter. Mais surtout réécouter tous ces albums très différents, souvent, les uns des autres mais jamais inintéressants ni dépourvus de qualités ou d’exigences. Ceux que l’on a toujours conservé au plus près du cœur, depuis l’acquisition impulsive d’un triple album live – le ratio quantité/prix était encore un facteur non négligeable des arbitrages d’achat, à l’époque – à la FNAC de Metz, juste après le Bac en 1989. Et aussi tous ceux qu’on n’avait pas toujours pris le temps d’apprécier à leur valeur juste parce qu’ils étaient mal tombés, un peu à côté des périodes où la négligence l’avait emporté sur la fidélité attentive. Ils sont nombreux, bien assez en tous cas pour battre en brèche certains versions tendancieuses d’un récit de sens commun selon lequel les Hollandais n’auraient plus rien publié de majeur ou d’important après avoir atteint le point culminant de leur œuvre au début des années 1990. Comme le prouve encore, de manière assez magistrale, le récent Tree, House, Fire (2024), Henk Hofstede et ses camarades ont encore de bien belles choses à jouer. Et à raconter aussi, en prévision d’un concert parisien qui coïncide – le hasard fait bien les choses – avec l’arrivée d’un nouveau printemps.
 Omsk (1983)
Omsk (1983)
L’enregistrement de cet album a constitué un tournant important dans l’histoire du groupe. Robert Jan Stips, notre claviériste, venait juste de nous rejoindre. Il avait joué avec nous sur scène, lors de la tournée précédente, mais c’est la toute première fois que nous travaillions avec lui en studio. Sa présence a modifié beaucoup de choses : les guitares sont devenues moins présentes et les claviers, c’est logique, sont devenus plus importants que sur les précédents albums. Pour nous, cela représentait une opportunité importante d’explorer de nouvelles facettes de nos chansons. La première fois que j’en ai pris clairement conscience, c’est quand nous avons enregistré Nescio, une chanson pour laquelle Robert Jan a composé un arrangement pour piano à queue. J’ai immédiatement été convaincu que nous étions en train d’ouvrir de nouvelles portes.
Vous avez dû patienter plusieurs années avant de publier vos premiers disques. Rétrospectivement, quel regard portes-tu sur cette longue période de préparation ?
Le groupe s’est formé en 1974 mais, en effet, nous avons mis beaucoup de temps avant d’enregistrer nos premiers albums à la fin des années 1970. Cela a été un processus très long, mais cela n’avait pas vraiment d’importance parce que je n’envisageais pas vraiment de devenir un musicien professionnel. C’est peut-être ce qui nous a sauvé, jusqu’à aujourd’hui. Ces années préparatoires ont donc été importantes pour nous permettre de progresser et d’affiner notre projet. Dès le début, nous avons commencé à enregistrer des démos pour conserver une trace, même très imparfaite, des chansons que nous composions, mais cela n’avait pas grand-chose à voir avec de véritables albums. Quand nous sommes rentrés dans l’univers commercial de l’industrie musicale, c’est devenu quelque chose de très différent. A l’époque, pour sortir un disque, il fallait trouver un studio et collaborer avec une maison de disques. C’était lent et compliqué. Il n’y avait pas d’ordinateur ou d’internet ou de téléphones portables. C’était quasiment le Moyen-Âge : c’est tout juste si nous n’utilisions pas des pigeons voyageurs pour envoyer les maquettes à la maison de disques.
Omsk est également un des premiers albums qui contient des références explicites à d’autres formes d’art – la sculpture pour A Touch Of Henry Moore, ou la littérature pour Nescio – le surnom de l’écrivain Jan Hendrik Frederik Grönloh.
Oui mais cela n’a jamais été le produit d’une volonté consciente d’étaler de la culture. Sur New Flat (1980) j’avais déjà fait allusion à Edward Hopper en reprenant le titre d’un de mes tableaux préféré – Office At Night. J’adore Hopper et le regard qu’il porte sur l’Amérique. Je ne suis jamais parvenu à aimer une autre Amérique que celle que j’ai découverte dans ses tableaux ou dans les films de Wim Wenders qui en sont très largement inspirés. Mais oui, j’ai toujours baigné dans un univers où la musique était une forme d’art parmi d’autres. J’ai étudié les Beaux-Arts à l’université et j’ai continué à m’y intéresser ensuite. Une partie de ma vie d’adulte, peut-être la plus importante, a donc toujours consisté à m’imprégner des créations des autres, à les apprécier, à en parler et à m’en inspirer. Et, de façon très naturelle, cela transparaît parfois dans l’écriture. A Touch Of Henry Moore n’est d’ailleurs pas vraiment une chanson sur la sculpture ou sur une œuvre en particulier : elle parle de la crainte du contact avec le corps des autres.
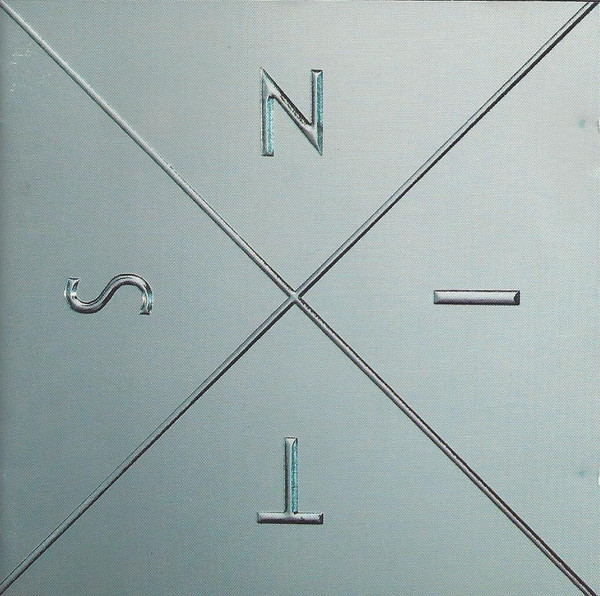 Ting (1992)
Ting (1992)
Giant Normal Dwarf (1990) et Ting (1992) sont étroitement liés l’un à l’autre. Ce sont deux albums avec lesquels nous avons commencé à cheminer sur une voie très différente de celle que nous avions empruntée dans la seconde moitié des années 1980 et qui nous avait conduit jusqu’au succès commercial de In The Dutch Mountains (1987). Les années qui ont suivi – toute la fin des années 1980 – ont été particulièrement denses. Sans doute un peu trop à notre goût. Nous avons tourné plus longtemps que d’habitude, souvent dans de très grandes salles. C’était presque interminable. À la fin de cette très longue tournée, notre bassiste est tombé malade et nous nous sommes dit que c’était peut-être le signe que nous en avions fait un peu trop par rapport à nos capacités et à nos envies. Logiquement, compte-tenu de ce succès, tout le monde autour de nous s’attendait à ce que nous prolongions la formule gagnante et que nous reproduisions à peu près le même style de chansons. Mais nous n’en avions pas du tout envie. Et nous avions l’impression que nous n’étions pas en train de vivre la vie qui nous correspondait. Pour ce qui me concerne, c’est à cette époque que ma première fille est née et je voulais absolument lui consacrer du temps. Nous sommes donc retournés dans notre studio, à Amsterdam et nous avons travaillé plus lentement et plus calmement que d’habitude, notamment pour Giant Normal Dwarf. Nous avons réinventé complètement notre monde. Ting est arrivé peu de temps après, comme un contrepoint évident. Giant Normal Dwarf était tellement explosif et haut en couleurs que nous avons immédiatement eu envie de basculer vers un équivalent musical du monochrome ou du néant. Quelque chose de très dépouillé, où le silence occuperait toute sa place. Juste quelques accords de piano, une voix et du vide tout autour.
Votre discographie a souvent semblé fonctionner ainsi par séquence de deux ou trois albums, liés entre eux et consacrés à l’exploration d’un même thème ou d’une même forme. Est-ce que vous les concevez de la même manière qu’un peintre travaille sur un triptyque ou une série de toiles ?
C’est vrai, mais c’est rarement le produit d’une décision préalable ou d’un projet consciemment élaboré en amont. Récemment, nous avons enregistré presque coup sur coup Angst (2017), Knot (2019) et Neon (2022) qui forment un ensemble assez cohérent mais, quand nous avons commencé, nous n’en avions aucune idée. Il nous est souvent arrivé d’avoir des périodes plus créatives et plus productives que d’autres pendant lesquelles nous enregistrons beaucoup de titres. Encore aujourd’hui, j’enregistre énormément de brouillons sur mon téléphone ou sur ma tablette. En général, un ou deux par jour. Beaucoup trop en tous cas pour les rassembler sur un seul album. C’est à la fois une question de quantité et d’homogénéité : il ne faut pas qu’un album parte dans tous les sens. Mais nous n’avons pas non plus la force d’abandonner toutes ces chansons qui ne cadrent pas avec l’album sur lequel nous sommes en train de travailler à ce moment-là. Nous conservons donc ces fragments pour le suivant, pour les retravailler ou les développer différemment. C’est ce qui explique qu’on puisse, a posteriori, déceler une certaine continuité d’un disque à l’autre.
Nightfall, River, Tree Is Falling : ce sont des chansons où, comme souvent, tu sembles projeter des états de conscience sur des éléments naturels.
Oui, je m’en suis souvent aperçu. C’est comme si j’avais à disposition une sorte de palette d’images ou de rêves qui reviennent de temps à autre, au fil des années, sous des formes différentes. Comme pour les arbres : il y a Boy In A Tree (1990) et Tree Is Falling (1992) et The Tree (2024). Peut-être parce que j’habite juste au-dessus d’un parc à Amsterdam.
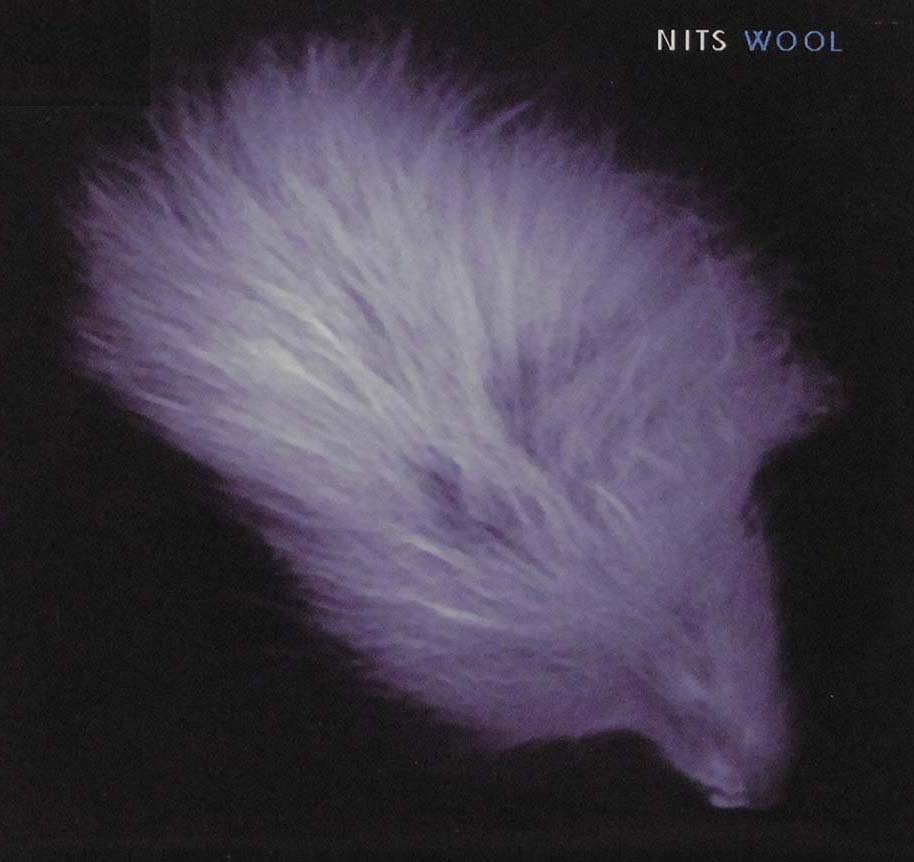 Wool (1999)
Wool (1999)
C’est vraiment l’œuvre très différente d’un groupe très différent. Robert Jan Stips avait décidé de partir à ce moment-là, en 1997. Nous avions envie de travailler avec des musiciennes depuis longtemps, pour explorer de nouveaux horizons musicaux. Nous avons donc recruté Arwen Linnemann à la basse et Laetitia Van Krieken, une pianiste de jazz. Elles ont commencé à nous accompagner sur scène, Rob Kloet et moi, pendant la tournée d’Alankomaat (1998). Quand nous sommes retournés en studio pour préparer Wool, l’atmosphère au sein du groupe était donc totalement inédite. C’est un album plus ouvert, où l’influence du jazz est beaucoup plus présente. C’est sans doute notre disque le moins pop et je l’apprécie énormément pour cette raison. Nous avons aussi travaillé avec un quatuor à cordes qui a participé à l’écriture des arrangements. Cela reste un de mes albums préférés. J’ai pris beaucoup de plaisir à l’écrire. J’ai réussi à aborder des thèmes plus personnels, à écrire sur ma mère par exemple et sur les promenades que nous faisions ensemble au bord de la rivière – encore une histoire de rivière, tiens ! Mais aussi Ivory Boy, qui parle d’un jeune homme avec lequel nous avions travaillé sur cet album et qui est mort peu de temps avant la fin de l’enregistrement. En tant que songwriter, c’est vraiment un moment charnière pour moi.
Est-ce que ces atmosphères musicales plus proches du jazz vous ont également conduit à changer votre manière de travailler ? A improviser davantage ?
Non, c’était davantage une question de groove. Mais il n’y a pas vraiment eu d’improvisation pour cet album. C’est venu plus tardivement, à partir des années 2000. Quand les musiciennes sont reparties et que Robert Jan Stips est revenu. C’est à ce moment-là que nous sommes devenus vraiment plus ouverts à l’improvisation. Il faut énormément de confiance en soi pour se lancer dans ce type d’aventure et lâcher-prise. C’est un sentiment que nous n’avons acquis que très récemment. Pour Wool, il s’agissait davantage de recréer une atmosphère, un climat qui ressemble à certains albums de jazz. J’ai toujours adoré Elvis Costello mais je trouve que ce qu’il a réussi à faire sur North (2003) est particulièrement remarquable.
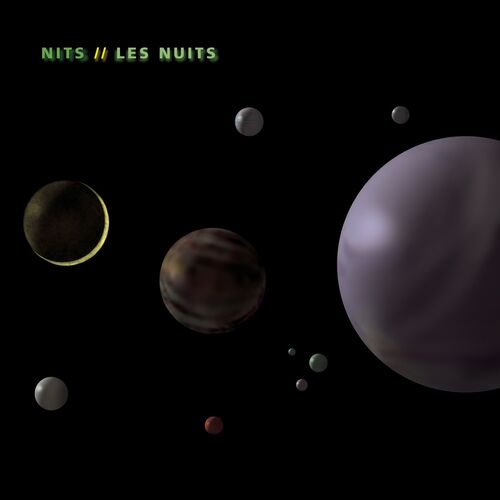 Les Nuits (2005)
Les Nuits (2005)
L’album tout entier tourne autour de ce triptyque – The Launderette, The Pizzeria et The Key-Shop – que j’ai composé en hommage au réalisateur Theo Van Gogh, quelques semaines après son assassinat. Ce n’est pas facile d’écrire des chansons directement connectées à une actualité sociale ou politique. C’est un exercice qui peut assez vite tourner au mauvais pamphlet si le propos est trop général ou trop explicite. Il faut que cela puisse d’abord fonctionner comme une chanson, sinon cela ne fonctionne pas du tout. J’avais déjà composé Sketches Of Spain en 1983 mais ce n’est pas vraiment la même chose : c’est une chanson plus historique qui parle de la guerre civile avec cinquante ans de recul. Ce coup-ci, l’Histoire débarquait plus ou moins sur mon palier. C’était la première fois qu’il y avait un meurtre politique à Amsterdam, et c’était juste au coin de ma rue. Et c’était un réalisateur, un artiste en plus. Je l’avais déjà croisé dans mon quartier, même si je ne le connaissais pas très personnellement. Le jour de la Fête de la Reine à Amsterdam, tout le monde traîne dans la rue et les enfants ont l’habitude de faire des dessins. Ma fille avait peint le portrait de Theo Van Gogh quand nous l’avions rencontré par hasard ce jour-là. Il avait accepté de s’asseoir et de poser quelques minutes pendant qu’elle dessinait maladroitement : elle avait commencé par tracer un grand cercle parce qu’il portait un chapeau et nous avions rigolé quelques minutes avec lui en regardant le résultat. Il lui avait même donné cinq florins en récompense et elle était ravie. Quand quelqu’un comme cela meurt au coin de la rue, juste à côté, ce n’est pas seulement un événement politique : le retentissement est aussi plus personnel. Je me suis demandé comment j’allais pouvoir lui rendre hommage et je me suis inspiré d’un de mes auteurs favoris de tous les temps, Paul McCartney, et de la manière dont il décrivait le quartier de son enfance dans Penny Lane. Les endroits familiers qu’il aimait : le coiffeur, le manège… C’est comme cela que je me suis dit que je devais me concentrer sur le décor, les lieux, les boutiques dans cette rue où Van Gogh était tombé. Je connaissais les commerçants qui tenaient ces boutiques et les voisins qui habitaient eu premier étage, juste au-dessus de la scène du crime. L’atmosphère dans le quartier a vraiment changé après cet événement. La Hollande toute entière a changé. Il y a des moments particuliers où l’on prend conscience qu’il n’est pas possible de s’échapper hors du monde. On ne peut pas toujours écrire des chansons sur les arbres.
 Tree, House, Fire (2024)
Tree, House, Fire (2024)
Le 16 mai 2022, le bâtiment dans lequel se trouvait notre studio a entièrement brûlé. Tout a été détruit. Nous étions présents sur les lieux au moment de l’incendie. Nous l’avons vu s’écrouler, puis se réduire à un tas de cendres. Immédiatement, nous nous sommes dit qu’il fallait que nous réagissions et que nous fassions quelque chose de cette tragédie. Construire des chansons plutôt que de laisser derrière nous un tas de ruines. De la musique, des mots. Assez rapidement, dans les jours qui ont suivi, j’ai commencé à rédiger quelques-uns de mes souvenirs de ce lieu. Des choses très simples, très concrètes : la première fois que je suis rentré dans le bâtiment il y a quarante ans, quand j’étais encore un jeune homme plein de projets et de volonté pour les réaliser. J’ai encore de la volonté mais je suis nettement plus vieux et ce n’est pas très grave. Aussi ce que j’y ai fait, notre travail. Un peu comme un journal. J’ai aussi dessiné pas mal de croquis en noir et blanc : les meubles, les instruments, tous les objets qui s’y trouvaient et qui m’occupaient l’esprit. Des guitares, mon Wurlitzer, des étuis à instruments. Je n’avais jamais dessiné d’étuis auparavant et c’est sacrément difficile. Je parle un peu de tout ça dans les chansons. Le grenier aussi, où se trouvait une collection de banjos que mon oncle m’avait donnée. J’ai écrit ces chansons pour remplacer un bâtiment détruit en quelque sorte.
Ces chansons renouent aussi avec le format du mini-album qui occupe une place importante dans votre discographie : Kilo (1983) ou Hat (1988)
Oui, c’est vrai. Cela faisait 35 ans que nous n’en avions pas publié mais très souvent, tout au long des décennies, nous nous disions qu’il fallait que nous revenions à ce format. Mais, à chaque fois que nous commencions, nous finissions par enregistrer un album normal parce que nous avions trop de chansons. Là, le sujet s’y prêtait tout particulièrement. Je n’avais pas envie de consacrer tout un album à un incendie mais six chansons, oui. Et puis j’ai toujours adoré les disques 10 inches. Je suis tombé amoureux de ce format quand j’étais adolescent et c’est avec lui que j’ai découvert une grande partie de la musique que j’aime.


