
Ni état des lieux de ce premier quart de XXIe siècle, ni texte à valeur historique. En quelques pages, faits et une poignée d’anecdotes, juste l’envie de rappeler que l’indépendance, en musique et parfois ailleurs, c’est peut-être avant tout un état d’esprit.
Des contrats qui n’en sont pas, signés avec du sang, signés sur une nappe de papier, signés au dos d’une enveloppe. Des contrats qui n’en sont tellement pas qu’il n’y en a pas, que la parole ou une poignée de mains suffisent. Des partages équitables quand il y a quelque chose à partager. Des salaires égaux quand il y a la possibilité de sortir des salaires. Des pochettes qui coûtent tellement cher à fabriquer que les ventes sont à perte. Des pochettes qui sont tellement belles qu’elles en deviennent des œuvres d’art — œuvres d’art dont elles s’inspirent parfois. Des pochettes qui sont de simples photocopies pliées en deux avant d’être glissées dans une pochette plastique que, le plus souvent, on n’arrive plus à remettre une fois enlevée. Des catalogues dont certaines références ne sont même pas des disques, mais un concert, un clin d’œil à James Bond, une affiche, un jeu de société, un livre, un fanzine, « un magazine oral », un projet avorté, un hommage à Jean Cocteau, un night-club. Des catalogues dont certaines références n’existent pas. « Des types qui avaient beaucoup trop d’idées et beaucoup trop peu d’argent, entourés d’artistes plus talentueux les uns que les autres », comme a déclaré un jour le patron de Heavenly Recordings, Jeff Barrett, à propos de Factory Records — mais entre nous, ces mots collent parfaitement à l’histoire de pas mal d’autres structures.

Alors autant préciser les choses d’emblée : on n’est pas là pour faire un historique détaillé de l’épopée des labels indépendants. Ce serait bien sûr passionnant — ce serait même essentiel, il faudrait que quelqu’un se décide un jour —, mais ce serait l’ouvrage de presque toute une vie qui donnerait naissance à un recueil gigantesque, à côté duquel l’Odyssée ressemblerait sans doute à un livre pour enfant de moins de trois ans. On n’est pas là non plus pour écrire un panégyrique, encore moins un parti-pris idéologique : les gentils contre les méchants, David contre Goliath, ceux qui savent, tentent, dénichent, défrichent contre ceux qui ne s’intéressent qu’au pognon, aux paillettes, aux récompenses. Parce que, bien sûr, ce n’est pas aussi simple que ça — et il y a même des gentils et des méchants dans les deux camps. Parce que, tout au long de l’histoire, des labels indépendants ont rejoint le giron de majors, parce que cette indépendance n’était pas pour certains une fin en soi, parce que la fin peut parfois justifier les moyens — faire connaître un groupe, un artiste qu’on chérit au plus grand nombre. On n’est encore moins là par souci d’exhaustivité — la mission est bien sûr impossible, car derrière les noms qui ont marqué l’histoire, combien d’aventures haïku qui ont pu avoir leur importance à un niveau local, voire national. Il est à ce titre intéressant de se rappeler du début des années 1980 sur le Vieux Continent et de comparer le quasi-désert français en termes de labels indépendants (V.I.S.A., Bondage ou Boucherie, terres d’accueil de ce rock dit alternatif) avec sa voisine espagnole, qui revenait de l’enfer mais voyait chaque jour la naissance d’une nouvelle structure pour publier productions locales et distribuer références internationales — il fut d’ailleurs une époque, celle d’avant Internet et Discogs, où il était plus facile de trouver chez les disquaires ibériques que chez nous des singles et albums de groupes parus chez Rough Trade, Cherry Red ou SST.
 Alors, bien sûr, il convient à ce moment du propos de rappeler que les labels indépendants ont apparu dès les années 1940, 1950, qu’ils existent aux côtés des majors — ces mégastructures qui doivent leur nom au fait que leur activité n’est pas liée au seul disque et à sa distribution, mais qu’elle peut également couvrir les… différents supports permettant entre autres d’écouter de la musique (tiens, tiens), ou le cinéma. Un peu dans le désordre, il faut alors se souvenir que Barclay, Tamla Motown, Stax, Immediate, Island sont à leur naissance des structures indépendantes, même si leur succès, leur rachat et parfois leur disparition ont depuis longtemps fait oublier cette origine. Pourtant, c’est vrai : la représentation qu’on a d’un label indépendant est irrémédiablement liée à la période punk, aux années 1976 et 1977, à la volonté d’une poignée d’idéalistes — mais pas que — de donner un bon coup de pied dans un monde musical qui n’a plus l’amour du risque, cherchant déjà à répéter une formule à l’envi pour s’assurer le succès et plaire au plus grand nombre. Je crois que nous sommes aujourd’hui à peu près tous d’accord. L’intérêt de ce mouvement n’est certainement pas artistique — sauf bien sûr si l’on s’en tient au graphisme des pochettes, aux emprunts aux surréalistes et à l’Internationale Situationniste, et aux idées et détournements assez géniaux de Jamie Reid et consort. Mais, musicalement, que reste-t-il de ces deux années ?
Alors, bien sûr, il convient à ce moment du propos de rappeler que les labels indépendants ont apparu dès les années 1940, 1950, qu’ils existent aux côtés des majors — ces mégastructures qui doivent leur nom au fait que leur activité n’est pas liée au seul disque et à sa distribution, mais qu’elle peut également couvrir les… différents supports permettant entre autres d’écouter de la musique (tiens, tiens), ou le cinéma. Un peu dans le désordre, il faut alors se souvenir que Barclay, Tamla Motown, Stax, Immediate, Island sont à leur naissance des structures indépendantes, même si leur succès, leur rachat et parfois leur disparition ont depuis longtemps fait oublier cette origine. Pourtant, c’est vrai : la représentation qu’on a d’un label indépendant est irrémédiablement liée à la période punk, aux années 1976 et 1977, à la volonté d’une poignée d’idéalistes — mais pas que — de donner un bon coup de pied dans un monde musical qui n’a plus l’amour du risque, cherchant déjà à répéter une formule à l’envi pour s’assurer le succès et plaire au plus grand nombre. Je crois que nous sommes aujourd’hui à peu près tous d’accord. L’intérêt de ce mouvement n’est certainement pas artistique — sauf bien sûr si l’on s’en tient au graphisme des pochettes, aux emprunts aux surréalistes et à l’Internationale Situationniste, et aux idées et détournements assez géniaux de Jamie Reid et consort. Mais, musicalement, que reste-t-il de ces deux années ?
 Quelques chansons extraordinaires signées The Jam, The Damned, Sex Pistols et surtout Buzzcocks ; le premier album des Ramones, un hymne de Richard Hell & The Voidoids, Blank Generation — et c’est ici qu’il faut rappeler que Marquee Moon de Television, aussi génial soit-il, est éloigné des canons supposés du punk — ; les balbutiements de certains des groupes qui vont vraiment compter dans les années suivantes. Et donc, au-delà des épingles à nourrice, de la provocation, des pantalons vinyles et des bas résilles — et c’est aussi ici qu’il faut rappeler que la coupe iroquoise vient après, et qu’après, c’est déjà trop tard —, l’intérêt du mouvement punk, son héritage le plus important, c’est bien sûr l’apologie du do it yourself (initiales DIY), ce mot d’ordre qui claque et ouvre les yeux et les horizons de nombre de mélomanes, qui comprennent alors qu’ils peuvent eux- mêmes devenir des acteurs de premier plan, se transformer en passeurs, véhiculer des idéaux, susciter des émotions et des vocations. Sans pourtant être musiciens.
Quelques chansons extraordinaires signées The Jam, The Damned, Sex Pistols et surtout Buzzcocks ; le premier album des Ramones, un hymne de Richard Hell & The Voidoids, Blank Generation — et c’est ici qu’il faut rappeler que Marquee Moon de Television, aussi génial soit-il, est éloigné des canons supposés du punk — ; les balbutiements de certains des groupes qui vont vraiment compter dans les années suivantes. Et donc, au-delà des épingles à nourrice, de la provocation, des pantalons vinyles et des bas résilles — et c’est aussi ici qu’il faut rappeler que la coupe iroquoise vient après, et qu’après, c’est déjà trop tard —, l’intérêt du mouvement punk, son héritage le plus important, c’est bien sûr l’apologie du do it yourself (initiales DIY), ce mot d’ordre qui claque et ouvre les yeux et les horizons de nombre de mélomanes, qui comprennent alors qu’ils peuvent eux- mêmes devenir des acteurs de premier plan, se transformer en passeurs, véhiculer des idéaux, susciter des émotions et des vocations. Sans pourtant être musiciens.
 Le passage des années 1970 à la décennie 1980 n’est pas tout à fait une époque comme les autres. En Grande-Bretagne en particulier, sur fond de misère économique, de doutes politiques et de grèves à répétition, il s’agit sans doute de l’une des périodes les plus passionnantes de l’histoire de la musique moderne. Car tout semble possible puisque personne ne sait vraiment de quoi l’avenir sera fait. L’effervescence punk, avant de sombrer dans l’autoparodie et dépérir d’une overdose de médiocrité, a surtout eu le mérite de faire trembler les fondements d’une industrie paresseuse. De ces secousses sont ainsi nés des groupes, des labels indépendants, des fanzines, des journalistes. Il s’est propagé une excitation nouvelle, d’un genre qui n’a pas été ressenti, sans doute, depuis les premiers déhanchements télévisuels d’Elvis ou les premiers accords d’Heroin. Sans pour autant renier le passé, ni même faire mine de le désavouer, au contraire, ces acteurs sont animés par le même désir de proposer quelque chose de différent — dans le sens warholien du terme. Et c’est bien pour cela que cette ère charnière reste encore aujourd’hui l’une des plus éclectiques et fourmillantes qui n’aient jamais été, comme en a parfaitement témoigné l’ouvrage Rip It Up And Start Again du journaliste Simon Reynolds — même si l’on peut lui reprocher une approche un peu trop factuelle et l’absence totale du nom de Felt (ce serait pour une sombre histoire de drague de sa copine par Lawrence, mais ce n’est peut-être qu’une légende). De l’éclosion de l’electropop aux scansions du punk-funk, des bruissements initiaux de la scène gothique aux premiers carillonnements de la mouvance ligne claire, il souffle un vent d’inventivité qu’il semble impossible de canaliser. Bien sûr, le génial va côtoyer le médiocre et le pire, la beauté va buter contre la laideur. Mais qu’importe.
Le passage des années 1970 à la décennie 1980 n’est pas tout à fait une époque comme les autres. En Grande-Bretagne en particulier, sur fond de misère économique, de doutes politiques et de grèves à répétition, il s’agit sans doute de l’une des périodes les plus passionnantes de l’histoire de la musique moderne. Car tout semble possible puisque personne ne sait vraiment de quoi l’avenir sera fait. L’effervescence punk, avant de sombrer dans l’autoparodie et dépérir d’une overdose de médiocrité, a surtout eu le mérite de faire trembler les fondements d’une industrie paresseuse. De ces secousses sont ainsi nés des groupes, des labels indépendants, des fanzines, des journalistes. Il s’est propagé une excitation nouvelle, d’un genre qui n’a pas été ressenti, sans doute, depuis les premiers déhanchements télévisuels d’Elvis ou les premiers accords d’Heroin. Sans pour autant renier le passé, ni même faire mine de le désavouer, au contraire, ces acteurs sont animés par le même désir de proposer quelque chose de différent — dans le sens warholien du terme. Et c’est bien pour cela que cette ère charnière reste encore aujourd’hui l’une des plus éclectiques et fourmillantes qui n’aient jamais été, comme en a parfaitement témoigné l’ouvrage Rip It Up And Start Again du journaliste Simon Reynolds — même si l’on peut lui reprocher une approche un peu trop factuelle et l’absence totale du nom de Felt (ce serait pour une sombre histoire de drague de sa copine par Lawrence, mais ce n’est peut-être qu’une légende). De l’éclosion de l’electropop aux scansions du punk-funk, des bruissements initiaux de la scène gothique aux premiers carillonnements de la mouvance ligne claire, il souffle un vent d’inventivité qu’il semble impossible de canaliser. Bien sûr, le génial va côtoyer le médiocre et le pire, la beauté va buter contre la laideur. Mais qu’importe.
 Si les fers de lance du mouvement punk « originel » ont trouvé refuge sur les majors — l’argent n’a pas d’odeur, dit-on —, des jeunes gens ont placé leur énergie, leur appétit, leurs idées dans des entreprises émancipées. Parce qu’ils pensent qu’on n’est jamais mieux servi que par soi-même, comme les inquiétants Throbbing Gristle qui fondent dès 1976 Industrial Records (dont le nom finira par devenir le qualificatif d’un genre musical) afin de publier leurs exactions soniques sans avoir de compte à rendre à qui que ce soit. Dans tout le royaume, les structures apparaissent. En Irlande, Good Vibrations mise sur les mal-aimés The Undertones ; à Edinbourg, Bob Last fonde Fast Product pour accueillir dans la foulée The Mekons et The Human League, puis Gang Of Four. Dans la cité presque voisine de Glasgow, le jeune Alan Horne rêve du New York des années 1960 et 1970, du Velvet Underground et des films de Morrissey — l’autre —, lance Postcard Records, pique son mot d’ordre à Motown (« The Sound of Young Scotland » au lieu de « The Sound Of Young America ») et trouve en Orange Juice et son leader angélique Edwyn Collins le groupe capable de cristalliser ses appétences.
Si les fers de lance du mouvement punk « originel » ont trouvé refuge sur les majors — l’argent n’a pas d’odeur, dit-on —, des jeunes gens ont placé leur énergie, leur appétit, leurs idées dans des entreprises émancipées. Parce qu’ils pensent qu’on n’est jamais mieux servi que par soi-même, comme les inquiétants Throbbing Gristle qui fondent dès 1976 Industrial Records (dont le nom finira par devenir le qualificatif d’un genre musical) afin de publier leurs exactions soniques sans avoir de compte à rendre à qui que ce soit. Dans tout le royaume, les structures apparaissent. En Irlande, Good Vibrations mise sur les mal-aimés The Undertones ; à Edinbourg, Bob Last fonde Fast Product pour accueillir dans la foulée The Mekons et The Human League, puis Gang Of Four. Dans la cité presque voisine de Glasgow, le jeune Alan Horne rêve du New York des années 1960 et 1970, du Velvet Underground et des films de Morrissey — l’autre —, lance Postcard Records, pique son mot d’ordre à Motown (« The Sound of Young Scotland » au lieu de « The Sound Of Young America ») et trouve en Orange Juice et son leader angélique Edwyn Collins le groupe capable de cristalliser ses appétences.
 Le temps d’une existence météorique (deux années, onze références), il publie un catalogue parfait (Josef K, The Go-Betweens ou Aztec Camera complètent la liste) et frappe l’imaginaire pour plusieurs décennies — Domino Records et Franz Ferdinand ne sauraient dire le contraire. Et les exemples de se suivre sans forcément se ressembler, même si l’Ambition (dans le sens Vic Godard du terme) reste identique. A Manchester, New Hormones sort le premier 45 tours des Buzzcocks, avant d’abriter les inclassables Ludus de Linder Sterling — jeune femme au charisme inquiétant et aux multiples talents, future égérie d’un temps de Morrissey. Toujours dans cette ville du Nord meurtrie, dont le centre est complètement éventré pour mieux le faire renaître de ses débris, un journaliste de télévision, qui invite sur son plateau tous les groupes qui comptent ou vont compter, a des idées plus farfelues les unes que les autres : parmi elles, organiser des concerts et fonder un label.
Le temps d’une existence météorique (deux années, onze références), il publie un catalogue parfait (Josef K, The Go-Betweens ou Aztec Camera complètent la liste) et frappe l’imaginaire pour plusieurs décennies — Domino Records et Franz Ferdinand ne sauraient dire le contraire. Et les exemples de se suivre sans forcément se ressembler, même si l’Ambition (dans le sens Vic Godard du terme) reste identique. A Manchester, New Hormones sort le premier 45 tours des Buzzcocks, avant d’abriter les inclassables Ludus de Linder Sterling — jeune femme au charisme inquiétant et aux multiples talents, future égérie d’un temps de Morrissey. Toujours dans cette ville du Nord meurtrie, dont le centre est complètement éventré pour mieux le faire renaître de ses débris, un journaliste de télévision, qui invite sur son plateau tous les groupes qui comptent ou vont compter, a des idées plus farfelues les unes que les autres : parmi elles, organiser des concerts et fonder un label.
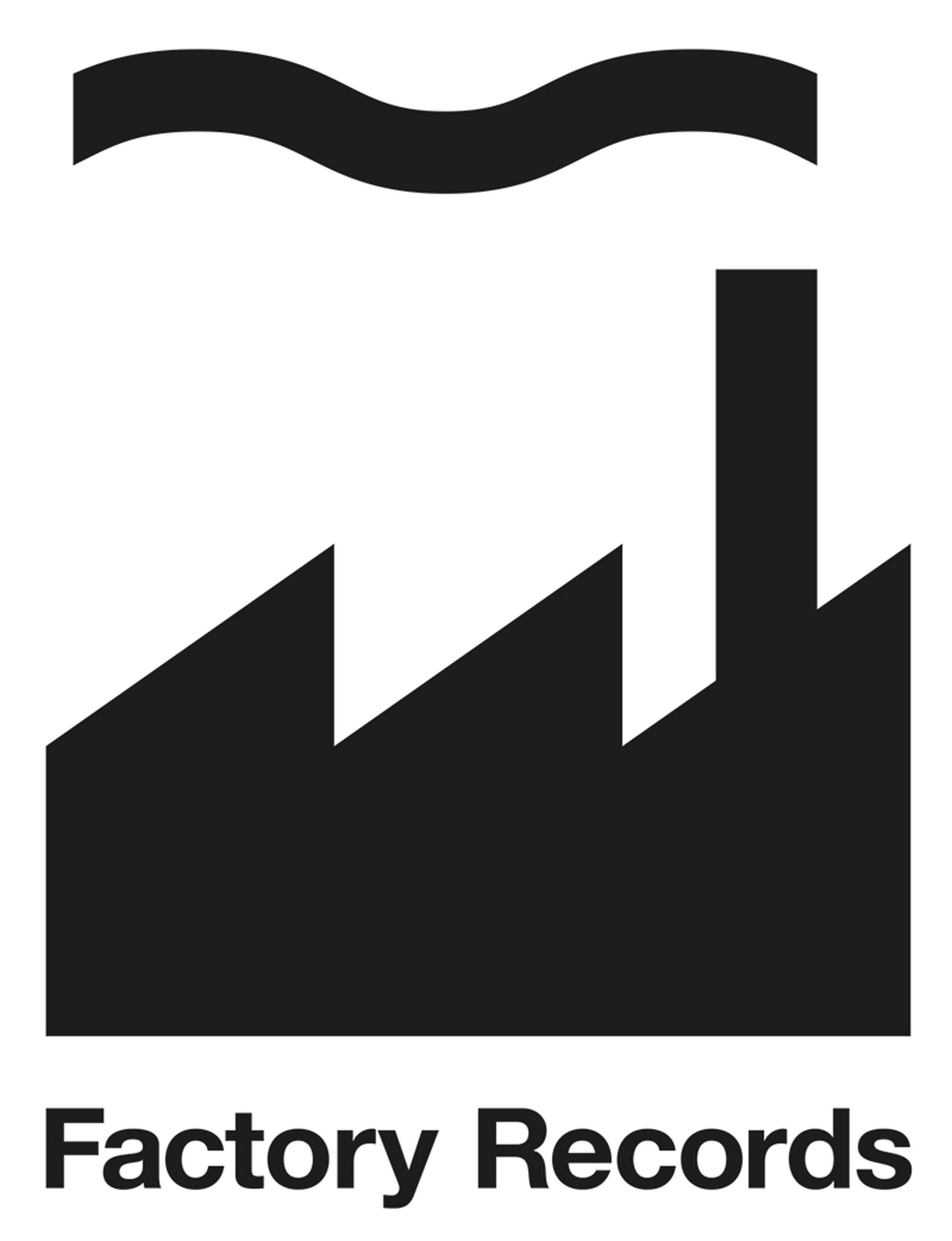 Anthony H.Wilson s’acoquine entre autres avec le graphiste Peter Saville et fonde Factory Records, s’amuse avec les théories situationnistes et déniche parmi ses concitoyens Joy Division et The Durutti Column. A quelques kilomètres de là, dans une ville qui a vu naître quatre garçons dans le vent, la structure Zoo Records ouvre ses portes à ses copains, des post-adolescents qui traînent dans les escaliers d’un club baptisé le Eric’s et rêvent de faire se rencontrer les brumes de Liverpool et le soleil californien sous des noms à rallonge, comme The Teardrop Explodes, Echo & The Bunnymen ou The Wild Swans. Mais tous comprennent qu’ils doivent assembler leurs (maigres) forces. Ça tombe bien : à Londres, le dénommé Geoff Travis, qui a commencé par ouvrir une boutique de disques, a l’idée d’un label — dont la toute première référence en 1978 sera le prodigieux 45 tours d’un groupe français, Paris Maquis de Métal Urbain — et d’un réseau de distribution qui va permettre aux productions indépendantes d’être plus présentes au niveau national et international. Dans la capitale, toujours, Cherry Red va jouer la carte de l’éclectisme alors que 4AD préférera celle de l’esthétisme.
Anthony H.Wilson s’acoquine entre autres avec le graphiste Peter Saville et fonde Factory Records, s’amuse avec les théories situationnistes et déniche parmi ses concitoyens Joy Division et The Durutti Column. A quelques kilomètres de là, dans une ville qui a vu naître quatre garçons dans le vent, la structure Zoo Records ouvre ses portes à ses copains, des post-adolescents qui traînent dans les escaliers d’un club baptisé le Eric’s et rêvent de faire se rencontrer les brumes de Liverpool et le soleil californien sous des noms à rallonge, comme The Teardrop Explodes, Echo & The Bunnymen ou The Wild Swans. Mais tous comprennent qu’ils doivent assembler leurs (maigres) forces. Ça tombe bien : à Londres, le dénommé Geoff Travis, qui a commencé par ouvrir une boutique de disques, a l’idée d’un label — dont la toute première référence en 1978 sera le prodigieux 45 tours d’un groupe français, Paris Maquis de Métal Urbain — et d’un réseau de distribution qui va permettre aux productions indépendantes d’être plus présentes au niveau national et international. Dans la capitale, toujours, Cherry Red va jouer la carte de l’éclectisme alors que 4AD préférera celle de l’esthétisme.
 Daniel Miller, lui, pense que le meilleur moyen de sortir son 45 tours Warm Leatherette, ritournelle électronique obsédante en hommage au Crash! (Crash en VO) de J.G. Ballard enregistré sous le nom de The Normal, est de créer sa propre structure, Mute, qui accueille bientôt l’un des groupes les plus populaires de la fin du XXe siècle : Depeche Mode. En 1983, un Ecossais expatrié quitte son boulot aux chemins de fer, organise des soirées à l’étage d’un pub riquiqui et édite son fanzine avant de créer son label Creation, d’après le nom du groupe mod des années 1960. Comme d’autres avant lui, le garçon porte plusieurs casquettes avec une certaine réussite puisqu’il est aussi musicien — Biff Bang Pow! — et manager — The Jesus And Mary Chain d’abord, puis The House Of Love. En à peine quelques années, Creation Records va symboliser la quintessence de ce qu’on a appelé l’indie pop — cousine très proche de la terminologie rock indé. Ce qui est assez amusant, faut-il préciser, puisque ce sont les deux seuls genres musicaux auxquels on a accolé l’adjectif « indépendant », comme si la techno, la house, le reggae ou le metal ne pouvaient pas l’être. La passion fait tache d’huile, les vocations s’internationalisent et, dès le milieu de la décennie — mais avec un pic d’une ampleur à nulle autre pareille au début des années 1990 —, cette scène parallèle va connaître un essor d’une ampleur insoupçonnée. Des Etats-Unis (dans le sillage de l’historique K Records, né en 1982, on peut citer TeenBeat, Bus Stop, Slumberland, Sunday, Parasol) ou d’Australie (Summershine), bientôt d’Allemagne (Marsh-Marigold, Mind The Gap), d’Espagne (Elefant Records, Siesta), de France (enfin, avec Cornflakes Zoo, Aliénor, Lo-Fi, Lithium, Anorak) et toujours de Grande-Bretagne (liste sur demande), une ribambelle de structures, de groupes parlent un même langage, que le fanzine ancêtre de la RPM réunit sous la bannière Internationale Pop.
Daniel Miller, lui, pense que le meilleur moyen de sortir son 45 tours Warm Leatherette, ritournelle électronique obsédante en hommage au Crash! (Crash en VO) de J.G. Ballard enregistré sous le nom de The Normal, est de créer sa propre structure, Mute, qui accueille bientôt l’un des groupes les plus populaires de la fin du XXe siècle : Depeche Mode. En 1983, un Ecossais expatrié quitte son boulot aux chemins de fer, organise des soirées à l’étage d’un pub riquiqui et édite son fanzine avant de créer son label Creation, d’après le nom du groupe mod des années 1960. Comme d’autres avant lui, le garçon porte plusieurs casquettes avec une certaine réussite puisqu’il est aussi musicien — Biff Bang Pow! — et manager — The Jesus And Mary Chain d’abord, puis The House Of Love. En à peine quelques années, Creation Records va symboliser la quintessence de ce qu’on a appelé l’indie pop — cousine très proche de la terminologie rock indé. Ce qui est assez amusant, faut-il préciser, puisque ce sont les deux seuls genres musicaux auxquels on a accolé l’adjectif « indépendant », comme si la techno, la house, le reggae ou le metal ne pouvaient pas l’être. La passion fait tache d’huile, les vocations s’internationalisent et, dès le milieu de la décennie — mais avec un pic d’une ampleur à nulle autre pareille au début des années 1990 —, cette scène parallèle va connaître un essor d’une ampleur insoupçonnée. Des Etats-Unis (dans le sillage de l’historique K Records, né en 1982, on peut citer TeenBeat, Bus Stop, Slumberland, Sunday, Parasol) ou d’Australie (Summershine), bientôt d’Allemagne (Marsh-Marigold, Mind The Gap), d’Espagne (Elefant Records, Siesta), de France (enfin, avec Cornflakes Zoo, Aliénor, Lo-Fi, Lithium, Anorak) et toujours de Grande-Bretagne (liste sur demande), une ribambelle de structures, de groupes parlent un même langage, que le fanzine ancêtre de la RPM réunit sous la bannière Internationale Pop.
 Parmi elles, il en existe même une qui semble regrouper tous les ingrédients pour faire chavirer les cœurs. Pourtant, en 1987, quand Matt Haynes (auteur du fanzine génial Are You Scared To Get Happy?) et Clare Wadd s’accouplent pour donner naissance à Sarah Records, personne ne peut se douter de son futur pouvoir de séduction. Avec son graphisme à la naïveté confondante, ses pochettes plastiques, ses manifestes photocopiés, cette structure intimement liée à sa ville d’origine (Bristol) finit par déclencher chez beaucoup les premiers émois, et par faire naître chez d’autres des vocations. Irréprochable jusque dans son suicide de l’été 1995, Sarah va devenir l’épicentre d’un mouvement underground dont les ramifications multiples et la dimension internationale estomaquent encore aujourd’hui. D’autant que son influence, par l’entremise de ses signatures phares (The Field Mice, The Orchids, The Wake), se fait encore sentir au XXIe siècle.
Parmi elles, il en existe même une qui semble regrouper tous les ingrédients pour faire chavirer les cœurs. Pourtant, en 1987, quand Matt Haynes (auteur du fanzine génial Are You Scared To Get Happy?) et Clare Wadd s’accouplent pour donner naissance à Sarah Records, personne ne peut se douter de son futur pouvoir de séduction. Avec son graphisme à la naïveté confondante, ses pochettes plastiques, ses manifestes photocopiés, cette structure intimement liée à sa ville d’origine (Bristol) finit par déclencher chez beaucoup les premiers émois, et par faire naître chez d’autres des vocations. Irréprochable jusque dans son suicide de l’été 1995, Sarah va devenir l’épicentre d’un mouvement underground dont les ramifications multiples et la dimension internationale estomaquent encore aujourd’hui. D’autant que son influence, par l’entremise de ses signatures phares (The Field Mice, The Orchids, The Wake), se fait encore sentir au XXIe siècle.
Pour beaucoup, les années 1980 vont marquer l’âge d’or des labels indépendants. Et ce n’est sans doute pas un leurre. Car c’est lors de cette décennie que ces labels vont découvrir le succès populaire — Blue Monday de New Order devient le maxi 45 tours le plus vendu de l’histoire ; Depeche Mode enfile les hits comme des perles ; les Hüsker Dü, Sonic Youth et autres Pixies préparent le terrain pour le grunge ; les Smiths chamboulent le quotidien des adolescents anglais ; aidés par leurs concitoyens des Stone Roses, les frappadingues des Happy Mondays hissent Manchester sur le toit du monde pop…
 C’est également la période qui va montrer que les frontières entre indépendants et majors, ces supposés frères ennemis, sont bien plus ténues qu’elles n’en ont l’air. Après tout, s’il y a bien la place pour que ces deux mondes cohabitent, ils ont aussi besoin l’un de l’autre. En 1983, l’éminence grise de Rough Trade Geoff Travis et le facétieux directeur artistique de Cherry Red Mike Alway — épaulés par le Belge Michel Duval, à qui l’on doit l’extraordinaire label Les Disques du Crépuscule (et Factory Benelux) — imaginent Blanco Y Negro, qui sous ses airs d’indépendant est en fait une filiale de la major WEA. Est-ce important ? Non. Les deux hommes s’en donnent à cœur joie, accueillent avec succès d’anciennes connaissances (Everything But The Girl) alors qu’Alan McGee montre qu’il porte son costume de manager sur mesure : après un premier 45 tours publié sur son propre label, il y fait signer ses protégés The Jesus And Mary Chain, dont le premier album, Psychocandy, est un succès critique et public — et permet de poser la question suivante : ce disque est-il moins crédible pour avoir été financé par une major ? (Et puis, tant qu’on y est : Smells Like Teen Spirit de Nirvana est-il un moins bon morceau pour avoir vu le jour sur Geffen et non sur Sub Pop ?) Alan McGee, encore lui, et WEA seront nettement moins heureux en 1986 en lançant sur le même principe Elevation — on a même cru qu’Edwyn Collins ou Primal Scream ne s’en remettraient jamais.
C’est également la période qui va montrer que les frontières entre indépendants et majors, ces supposés frères ennemis, sont bien plus ténues qu’elles n’en ont l’air. Après tout, s’il y a bien la place pour que ces deux mondes cohabitent, ils ont aussi besoin l’un de l’autre. En 1983, l’éminence grise de Rough Trade Geoff Travis et le facétieux directeur artistique de Cherry Red Mike Alway — épaulés par le Belge Michel Duval, à qui l’on doit l’extraordinaire label Les Disques du Crépuscule (et Factory Benelux) — imaginent Blanco Y Negro, qui sous ses airs d’indépendant est en fait une filiale de la major WEA. Est-ce important ? Non. Les deux hommes s’en donnent à cœur joie, accueillent avec succès d’anciennes connaissances (Everything But The Girl) alors qu’Alan McGee montre qu’il porte son costume de manager sur mesure : après un premier 45 tours publié sur son propre label, il y fait signer ses protégés The Jesus And Mary Chain, dont le premier album, Psychocandy, est un succès critique et public — et permet de poser la question suivante : ce disque est-il moins crédible pour avoir été financé par une major ? (Et puis, tant qu’on y est : Smells Like Teen Spirit de Nirvana est-il un moins bon morceau pour avoir vu le jour sur Geffen et non sur Sub Pop ?) Alan McGee, encore lui, et WEA seront nettement moins heureux en 1986 en lançant sur le même principe Elevation — on a même cru qu’Edwyn Collins ou Primal Scream ne s’en remettraient jamais.
 Quelques années plus tard, alors que les structures indépendantes des années 1990 flirtent souvent avec les musiques électroniques, à l’instar de Warp à Sheffield, de Soma à Glasgow ou de Solid et F Communications en France, Creation se retrouve encore au cœur de la légende. Car depuis toujours, il existe cette rumeur : malgré les moult détails donnés dans le récent documentaire sur Oasis, Supersonic, McGee n’aurait jamais découvert le groupe des frères Gallagher sur une minuscule scène écossaise. Ce serait un directeur artistique de Sony qui aurait eu l’idée de « sous-traiter » le quintette mancunien à Creation par souci de crédibilité. C’est cette même crédibilité qui a valu aux Strokes de se retrouver sur le label Rough Trade récemment ressuscité au début des années 2000. Aux Etats-Unis, le groupe est déjà sur une major avant qu’il ne débarque dans la prude Albion — mais personne n’est au courant et rien ne peut entacher la réputation des derniers sauveurs du rock en date. Alors, voilà…
Quelques années plus tard, alors que les structures indépendantes des années 1990 flirtent souvent avec les musiques électroniques, à l’instar de Warp à Sheffield, de Soma à Glasgow ou de Solid et F Communications en France, Creation se retrouve encore au cœur de la légende. Car depuis toujours, il existe cette rumeur : malgré les moult détails donnés dans le récent documentaire sur Oasis, Supersonic, McGee n’aurait jamais découvert le groupe des frères Gallagher sur une minuscule scène écossaise. Ce serait un directeur artistique de Sony qui aurait eu l’idée de « sous-traiter » le quintette mancunien à Creation par souci de crédibilité. C’est cette même crédibilité qui a valu aux Strokes de se retrouver sur le label Rough Trade récemment ressuscité au début des années 2000. Aux Etats-Unis, le groupe est déjà sur une major avant qu’il ne débarque dans la prude Albion — mais personne n’est au courant et rien ne peut entacher la réputation des derniers sauveurs du rock en date. Alors, voilà…
Ce tableau rapidement brossé est avant tout l’occasion de rappeler qu’ici, et peut-être encore un peu plus qu’ailleurs, c’est l’état d’esprit qui prévaut, et que c’est cela que ce mot, indépendance, englobe et résume : l’état d’esprit de ceux qui veulent croire qu’il existe une vie en dehors des poncifs et des canons des « musiques actuelles », une place et une légitimité pour un art pop — comme populaire —, à la fois subversif et doté d’un vrai pouvoir de séduction, indissociable — ou presque — de la littérature, du cinéma, de la peinture ou de la bande dessinée. C’est l’état d’esprit de ceux qui, fauchés ou nantis, ont simplement l’envie de partager une passion, de partager une émotion. C’est l’état d’esprit de ceux qui se disent : « On fonce et on verra après ».



Chouette leçon d’histoire.