
Assurément, Dialectique de la pop est un livre important. Tant par son caractère inédit et novateur que par l’ampleur de son propos : élaborer une théorie de la pop, qu’il faut ici comprendre non pas de manière étroite comme un genre particulier, mais dans son acception générale de « musique populaire enregistrée ». Car il s’agit pour Agnès Gayraud ‒ que nous connaissons aussi par son projet musical La Féline ‒ de penser l’objet « pop » en tant que philosophe. C’est-à-dire d’en définir le statut et la portée esthétiques, de tenter de cerner sa « singularité en tant qu’art », de cerner ses formes et ses conditions de production-diffusion. Autrement dit, s’attacher à prendre toute la mesure de ce qui s’est imposé comme l’une des formes culturelles majeures de ces soixante dernières années, de ses expressions les plus mainstream au plus pointues. Une entreprise importante, répétons-le, qui mérite donc bien de revenir avec l’auteure sur certaines de ses grandes thématiques. Entretien.
Le propos de ton livre nous semble impressionnant au sens où il s’attache à appréhender l’objet « pop » d’une manière véritablement inédite : définir ce que pourrait-être la « forme-pop », que tu entends comme « un art musical distinct », comme « une manière distincte de produire des formes – artefacts musicaux – à partir des sons ». Il s’agirait en quelque sorte de définir la pop par-delà toute approche trop sociologisante (qui l’appréhende par le seul prisme de la culture de masse standardisée), ou encore par-delà toute circonscription à un genre particulier, pour en faire la modalité paradigmatique de la « musique populaire enregistrée ». Pourrais-tu revenir sur ce point ?
En effet, à l’origine de ce livre, il y a vraiment ce geste : écouter la musique populaire enregistrée et cerner à quoi s’ancrent nos jugements esthétiques la concernant. Comme tout amateur.rice. de pop, j’aime lire des biographies sur mes musicien.ne.s préféré.e.s, glaner des anecdotes sur l’éducation musicale des frères Wilson ou sur la vie rock’n’roll de Pete Townshend ; j’aime aussi me renseigner sur la signification passée et contemporaine de la « pop culture », suivre les débats sur les stratégies commerciales des uns et des autres, me demander pourquoi tel artiste semble combler les attentes d’innombrables consommateurs de musique, etc. Mais ces approches, dont l’une navigue entre historiographie et collecte de témoignages, l’autre entre études info-com et journalisme, ne me satisfont pas complètement. Elles ont beaucoup de succès, et certainement pour des raisons profondes, mais tout se passent comme si elles éludaient la question esthétique, et à travers elle, la question de savoir à quelle forme musicale étrange nous avons affaire avec la musique populaire enregistrée qui nous est si familière depuis un siècle. Soit parce que le fan qui lit une biographie de Brian Wilson sait d’avance que c’est un génie, soit parce que le sociologue de notre temps qui lit des ouvrages sur la pop culture n’en a au fond que faire de l’émotion que peut susciter l’écoute d’un album de Lisa Germano, de Talk Talk ou de Paco Ibañez.
De façon caricaturale, on pourrait aussi dire que les réflexions-témoignages sur la pop nous amènent toujours à une sorte de regret cuisant de la contre-culture ou à une certaine nostalgie d’âges d’or révolus de la musique (les années 60, le punk, l’underground des années 80, les premières rave parties), tandis que les analyses pop culturelles nous ramènent au fait que la globalisation renforce les effets de masse d’une diffusion industrielle puissante depuis longtemps, et l’on finit noyé dans la perplexité en tentant de trouver un sens esthétique aux statistiques de vues YouTube ou de followers Instagram des artistes les plus en vue. Dans les deux cas, je me sens en fin de compte un peu arrachée à ce que c’est que d’aimer et de pratiquer cette forme musicale ici et maintenant, d’en ouvrir le champ au-delà des récits sédimentés, d’en conserver les possibles. Bien sûr que la pop est faite de tout un tas d’autres dimensions que de pure musique (à commencer par du bruit, sous diverses formes, pour lequel elle a une aménité particulière), d’images, de concerts, de formes de vie, de groupes de fans, d’anecdotes. Et on ne peut pas ne pas prendre tout cela en compte. Mais si toutes ces dimensions jouent un rôle dans notre évaluation, elles ne sont pas aussi indispensables que l’écoute des œuvres pop, qui ne sont pas tant les pochettes de disque, les interviews des musiciens ou leurs costumes de scène, encore moins leurs scores de vente, mais les enregistrements qu’ils ont publiés, donnés à entendre, fût-ce à un public très restreint.
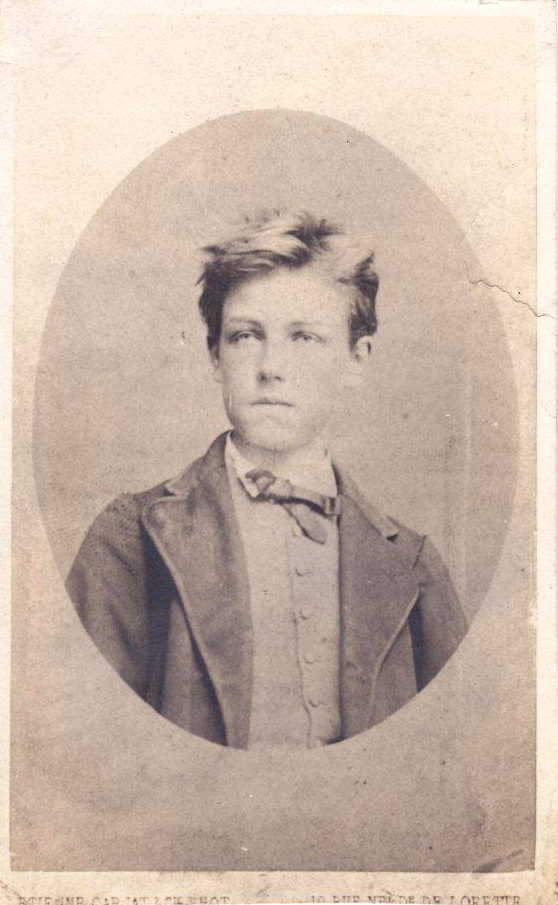 Il y a une photographie de Rimbaud à 17 ans, par Etienne Carjat, qui est extrêmement célèbre. Elle a probablement contribué à son aura si particulière, accrochée encore aujourd’hui au dessus des lits d’adolescent.e.s. Mais qui aurait l’idée de dire que la poésie de Rimbaud est avant tout concentrée dans cette photo? Non, son œuvre reste dans les textes, dans la forme poétique telle qu’en elle même. Il en est à peu près de même à mes yeux entre un poster de Bowie et ses albums. Ce qui ne veut pas dire que Bowie ne s’incarne pas dans sa musique : dans ses interprétations, le traitement de sa voix, ses travestissements vocaux mêmes, il a fixé l’expressivité particulière de son incarnation réflexive et transformiste, tout comme la jeunesse et la forme de vie rimbaldienne sont saisies dans le langage poétique de Rimbaud. Voilà pourquoi, il m’a semblé utile, quand j’ai commencé à concevoir ce livre, de revenir à la forme artistique, là où l’œuvre se donne plutôt que d’accorder une attention démesurée aux moyens satellitaires censés accompagner les œuvres mais qui finissent par les occulter complètement.
Il y a une photographie de Rimbaud à 17 ans, par Etienne Carjat, qui est extrêmement célèbre. Elle a probablement contribué à son aura si particulière, accrochée encore aujourd’hui au dessus des lits d’adolescent.e.s. Mais qui aurait l’idée de dire que la poésie de Rimbaud est avant tout concentrée dans cette photo? Non, son œuvre reste dans les textes, dans la forme poétique telle qu’en elle même. Il en est à peu près de même à mes yeux entre un poster de Bowie et ses albums. Ce qui ne veut pas dire que Bowie ne s’incarne pas dans sa musique : dans ses interprétations, le traitement de sa voix, ses travestissements vocaux mêmes, il a fixé l’expressivité particulière de son incarnation réflexive et transformiste, tout comme la jeunesse et la forme de vie rimbaldienne sont saisies dans le langage poétique de Rimbaud. Voilà pourquoi, il m’a semblé utile, quand j’ai commencé à concevoir ce livre, de revenir à la forme artistique, là où l’œuvre se donne plutôt que d’accorder une attention démesurée aux moyens satellitaires censés accompagner les œuvres mais qui finissent par les occulter complètement.
Tu parles au début de Dialectique de la pop d’une tendance que la pop aurait à aimer « se penser contre elle-même », c’est-à dire à se confronter à ce que ses détracteurs lui ont toujours reproché : être le lieu par excellence de l’inauthenticité, de la standardisation et de la soumission aux logiques commerciales. Dans ses formes les plus réflexives (on pense à Bowie, Kraftwerk , etc.), il nous semble même que c’est cette tension entre la reconnaissance de sa configuration par l’industrie culturelle et la nécessité d’en déborder les termes qui peut en constituer l’une des grandes singularités esthétiques. Pourrais-tu préciser les coordonnées de cette dialectique entre la pop et ce que tu nommes l’ « anti-pop » ?
C’est un phénomène que j’ai en effet observé chez beaucoup d’amateurs de cette musique, dans la critique rock, dans la posture des artistes eux-mêmes. Le pari, c’était de comprendre que cette part auto-critique ne relevait pas de la seule psychologie, de la fausse humilité des artistes préférant se dire artisans ou faussaires plutôt que d’assumer d’avoir affaire à une forme d’art et d’en endosser les conséquences — car bien sûr, assumer de « pratiquer un art » demande en un sens du courage, en élevant une activité à ce rang, on élève notre degré de responsabilité, existentielle, ou plus simplement, humaine. De façon moins psychologique, plus en phase avec l’objet lui-même, les conditions de production des œuvres pop elles-mêmes, établissent d’office de nombreuses tensions, voire contradictions, que j’étudie dans le livre. Je montre dès le départ que, par l’enregistrement, l’art de la musique populaire enregistrée est ontologiquement lié à l’industrie phonographique, et cette dernière, historiquement liée à l’industrie de la communication. L’alliance objective entre ces dimensions artistiques et industrielles n’est évidemment pas anecdotique, encore moins pour une forme d’art dont toute une part de l’esthétique mise sur une forme de naturalisme, de spontanéité, d’image d’Epinal d’un individu qui s’exprimerait sans façon au fin fond de sa campagne, et dont l’ « authenticité » est destinée à émouvoir ses auditeurs urbains et éduqués. Tout ce que « populaire » dit d’une sincérité enracinée, d’une fidélité à la communauté originelle, la puissance d’ubiquité des enregistrements le dénie. Toute une dimension esthétique de la pop mise sur la séduction de ce naturalisme tout en le sachant profondément médiée d’artificialité. Sur un autre plan, le hit, Graal artistique pop par excellence, présente aussi son double tranchant : vouloir rendre sa musique populaire confine au rêve de faire de sa singularité un universel, mais la popularité est le règne aussi assuré de la norme, qui trahit la promesse de singularité première. Que nous pratiquions cette musique ou que nous nous contentions de l’écouter, nous rencontrons sans cesse ce genre de déchirements, cette forme brisée de l’expérience qui ne se résout que dans les œuvres préservées ou exposées à un certain moment de l’histoire de la culture. L’anti-pop c’est la conscience accrue du déracinement voire de l’acculturation sous les affirmations d’authenticité, de la fabrication sous l’apparence de la spontanéité, de la norme sous celle de la singularité. Et c’est une conscience, telle est le sens de la dialectique, qui n’est pas étrangère à la pop, mais lui est constitutive. Elle n’appartient pas spécialement à ceux qui la détestent ou lui sont indifférents. Elle affecte en permanence l’écoute et la création de ceux qui l’aiment. Elle ne consiste pas en un bilan décliniste une fois que tous les jeux sont faits. Elle contribue à l’histoire de cet art musical, car la pop n’avance, du moins se change, que par les effets permanents de cette négativité, quitte à chercher dans sa propre histoire des éléments à opposer à son présent.
Quel rôle peut jouer dans ce cadre l’une des grandes références théoriques de ton travail, celle de Theodor W. Adorno, philosophe allemand bien connu pour être le grand contempteur des musiques populaires ? (Ndlr : Agnès Gayraud a rédigé une thèse de doctorat en philosophie sur Adorno)
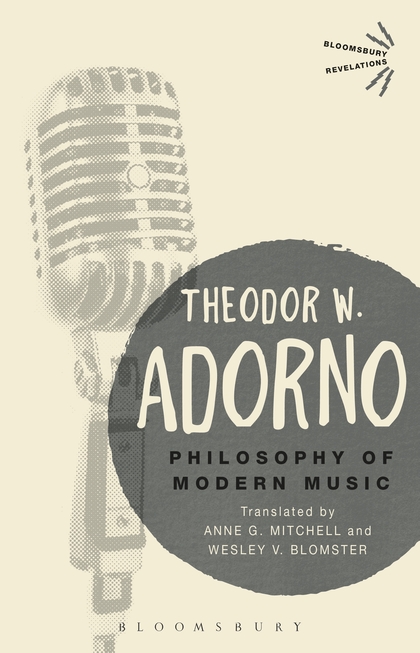 D’une certaine manière, on pourrait se passer d’Adorno pour observer cela. Mais il a un double mérite, et une double utilité pour celui qui veut « construire » un tant soit peu le problème. D’une part, il fait partie des rares philosophes du XXe siècle à s’être penchés sur la musique populaire — fût-ce pour en critiquer le principe de manière radicale — et d’autre part, il me fournit un modèle de pensée critique qui, en l’occurrence, m’a paru très opérant : celui d’une dialectique négative, c’est-à-dire d’un déploiement des contradictions dont le fonctionnement fécond ne consiste pas en un dépassement des contradictions, une résolution de ces dernières dans un troisième terme théorique qui pacifierait tout, mais en une réitération de la contradiction, que seules les œuvres, et non la théorie, peuvent résoudre localement. C’est une pensée au départ très spéculative mais qui laisse revenir l’objet, finit par avouer son impuissance face à lui, et elle me semble au fond très juste pour respecter ce qui advient avec des œuvres musicales. Adorno bien sûr, ne le voyait pas de cet œil concernant la « musique populaire légère » (pour lui essentiellement du swing— un jazz blanchi —, et des chansons de crooner, radiodiffusés à la fin des années trente en Amérique). Il y observe l’avènement d’une industrie culturelle toute puissante, le triomphe effrayant et caricatural d’un faux bonheur culturel à l’usage des masses, littéralement prisonnières du « bain d’acier du fun », et un encouragement à une forme de sauvagerie, vaguement anti-intellectualiste qui lui rappelle les heures les plus sombres de l’Allemagne nazie. Mais sa critique, curieuse de son objet, fournit aussi des éléments d’analyse plus subtils. Il est à la fois comme je l’écris une sorte de « hater hyperbolique », plus stimulant à mon sens qu’un faux ami condescendant, et un assez précieux observateur de certains phénomènes (notamment des effets de la radiodiffusion sur le format des œuvres, au-delà de leur forme). Certains honnissent Adorno pour ses textes un peu honteux sur le jazz, mais son attention à la musique populaire est bien plus assidue que ce qu’on trouve chez des philosophes supposés plus « pop friendly » comme Deleuze, Foucault ou Rancière, dont les pensées sont certes plus ouvertes notamment au déferlement démocratique et en ce sens au phénomène pop, mais ne sont pas spécialement « musiciennes » ni portée sur la signification profonde de la musique populaire.
D’une certaine manière, on pourrait se passer d’Adorno pour observer cela. Mais il a un double mérite, et une double utilité pour celui qui veut « construire » un tant soit peu le problème. D’une part, il fait partie des rares philosophes du XXe siècle à s’être penchés sur la musique populaire — fût-ce pour en critiquer le principe de manière radicale — et d’autre part, il me fournit un modèle de pensée critique qui, en l’occurrence, m’a paru très opérant : celui d’une dialectique négative, c’est-à-dire d’un déploiement des contradictions dont le fonctionnement fécond ne consiste pas en un dépassement des contradictions, une résolution de ces dernières dans un troisième terme théorique qui pacifierait tout, mais en une réitération de la contradiction, que seules les œuvres, et non la théorie, peuvent résoudre localement. C’est une pensée au départ très spéculative mais qui laisse revenir l’objet, finit par avouer son impuissance face à lui, et elle me semble au fond très juste pour respecter ce qui advient avec des œuvres musicales. Adorno bien sûr, ne le voyait pas de cet œil concernant la « musique populaire légère » (pour lui essentiellement du swing— un jazz blanchi —, et des chansons de crooner, radiodiffusés à la fin des années trente en Amérique). Il y observe l’avènement d’une industrie culturelle toute puissante, le triomphe effrayant et caricatural d’un faux bonheur culturel à l’usage des masses, littéralement prisonnières du « bain d’acier du fun », et un encouragement à une forme de sauvagerie, vaguement anti-intellectualiste qui lui rappelle les heures les plus sombres de l’Allemagne nazie. Mais sa critique, curieuse de son objet, fournit aussi des éléments d’analyse plus subtils. Il est à la fois comme je l’écris une sorte de « hater hyperbolique », plus stimulant à mon sens qu’un faux ami condescendant, et un assez précieux observateur de certains phénomènes (notamment des effets de la radiodiffusion sur le format des œuvres, au-delà de leur forme). Certains honnissent Adorno pour ses textes un peu honteux sur le jazz, mais son attention à la musique populaire est bien plus assidue que ce qu’on trouve chez des philosophes supposés plus « pop friendly » comme Deleuze, Foucault ou Rancière, dont les pensées sont certes plus ouvertes notamment au déferlement démocratique et en ce sens au phénomène pop, mais ne sont pas spécialement « musiciennes » ni portée sur la signification profonde de la musique populaire.
Qu’est-ce que cette « promesse d’une utopie de la popularité » que tu considères comme caractérisant de manière fondamentale la pop ?
Disons que c’est une caractérisation plus ancienne, que je trouve d’ailleurs énoncée dans une lettre de Mozart à son père, où il lui écrit chercher une musique de la « juste mesure » où initiés et non initiés pourraient se réconcilier dans l’évidence d’une musique qui ravirait autant les experts que ceux qui sont touchés « sans savoir pourquoi ». Dans ce rêve d’une réconciliation par le pouvoir de la musique, capable ainsi d’éradiquer les inégalités liées à la maîtrise d’un savoir musical par quelques-uns aux dépens des autres — il me semble que Mozart énonce un idéal esthétique qui survit dans la pop. Les hits que nous continuons d’admirer, alors même que nous sommes depuis longtemps initiés aux complexités de la composition et de la production pop, cristallisent à leur manière ce rêve. On sait qu’une chanson simple à comprendre n’est pas nécessairement simple à réaliser, y compris via la complexité de hasards et d’accidents qui lui confèrent sa grâce. La juste mesure de Mozart énonce cette générosité : une œuvre musicale qui se livrerait sans effort pour l’auditeur, sans lui faire peser la maîtrise, l’expérience, ou n’importe quelle médiation qui l’éloignerait de l’évidence, que le ravirait sans demander son reste. Au moment de définir l’art musical pop, dont j’établis une première définition ontologique comme art dont les œuvres sont des enregistrements, c’est-à-dire dont les œuvres n’apparaissent que par cette condition de production qu’est leur fixation sonore sur la bande, le vinyle ou le fichier numérique — quel que soit le support —, ce que j’appelle l’utopie de la popularité est la qualification esthétique qui permet de compléter cette définition. Les œuvres pop sont des enregistrements peu ou prou « orientés » par la force d’attraction de cet idéal d’une utopie de la popularité, où évidence et exigence, plébiscite et élaboration artistique, convergeraient, pour tous, dans une sorte de pouvoir réconciliateur de la musique. Bien sûr, je l’appelle « utopie » car elle est loin de caractériser tous les hits que l’industrie musicale nous impose. Et un des grands jeux de l’anti-pop est de déceler la dystopie d’une fausse réconciliation sous les traits riants de la « légèreté » promue de toutes parts. Aimer la pop peut aboutir à haïr le mainstream où les hits ne disent plus rien de ce paradis esthétique, mais jamais, je crois, à renoncer tout à fait à cette promesse, tant que l’on se rapporte encore à quelques épiphanies de cette réconciliation possible dans le canon de la musique populaire enregistrée, qu’on aime la Carter Family, Elvis ou Burt Bacharach, Etienne Daho en France ou Timbaland.
Un chapitre a particulièrement attiré notre attention : « Pop et progrès. Innocence historicisée », dans lequel tu t’attaches à discuter la figure de la pop comme forme moderniste, en te référant notamment à certaines thèses développées par Simon Reynolds (de ses écrits sur le post-punk et les raves jusqu’à Retromania). Comment penser le statut d’une forme musicale comme celle de la pop si on l’appréhende du point de vue du rapport qu’elle entend instaurer avec sa propre histoire ?
Quand j’ai commencé à écrire le livre, les esthètes de pop française étaient en plein revival de ce qu’on appelait la musique des « jeunes gens mödernes ». La modernité, à un certain moment de l’histoire de la musique populaire enregistrée, a vraiment compté comme un élément de distinction. C’était un gage d’alliance avec la jeunesse, mais aussi de rupture avec des formes de vie héritées de la contre-culture devenues empesées de leurs propres contradictions et de leur vieillissement aussi. Moderne, alors, signifiait revendiquer une esthétique plus urbaine, plus avant-gardiste car plus désabusée, plus sûre de sa propre défaite et de ce qu’elle avait à conquérir — une autonomie absolue par rapport à tous les ringards peuplant le pays. Il y avait bien sûr là des éléments de « distinction » au sens bourdieusien du terme : parce que cela inscrivait la musique pop dans une histoire de l’art, dans la nervosité des avant-gardes des années trente, dans une certaine fascination pour les machines, passée de Russolo à Kraftwerk. Tous ces éléments ont constitué un négatif esthétique par lequel la pop française a été remarquablement créative, de Mathématiques Modernes à Jacno, de Deux à Marquis de Sade, avec une musicalité qui lui allait extrêmement bien, misant sur le contraste entre le robotique, la vie automatisée et la sensibilité extrême d’une jeunesse bloquée par un avenir gris.
En cela, l’invocation de la modernité suscita des innovations incontestables. Et jamais je ne remettrai la fécondité et la signification de cette invocation en cause. Mais il m’a semblé utile — à l’échelle plus large de la forme pop, et pas seulement suivant certains genres plus « modernistes » que d’autres (comme le be bop, folk électrifié, post-punk ou techno) — de confronter tout de même l’art musical pop à ce paradigme en fait hérité d’ailleurs, en l’occurrence de la Modernité savante, liée à un certain récit de l’histoire de la musique écrite. Et pour le coup, Adorno est un penseur affirmé de la Modernité (l’autre pilier pour penser le concept de Modernité serait Greenberg mais davantage pour les arts visuels). Je me suis donc confrontée, aussi rigoureusement que possible, au sens profond, philosophique, de l’idée de progrès, et je me suis demandé à quel titre elle pouvait survivre ainsi déterritorialisée dans la pop, qui est un art musical où le cycle, le standard, la reprise, et à une plus large échelle, le revival, sont constitutifs. Un moderniste conséquent ne croit pas à la possibilité d’aller rechercher des éléments du passé pour fabriquer du nouveau : pour la pop au contraire, il n’y a pas de rebut de la modernité, la plupart des avant-gardes sont d’ailleurs elles-mêmes liées à des revivals : le folk new-yorkais des années 60 va puiser dans un répertoire de bluesmen et de hill-billies des années vingt (qu’on vendait déjà à l’époque sous la dénomination charmeuse de « old times music »), il y a toute un part de revival rockabilly dans l’esthétique des Cramps ou des Meteors, et même des Smiths, le premier grand album de musique électronique entièrement samplé, celui de DJ Shadow, Endtroducing, en 1996, est un vaste hommage à un répertoire sonore antérieur.
Bref, difficile d’identifier comme le fait Adorno un « matériau musical » qui progresse, suivant une linéarité rationnelle : la forme-chanson (antérieure à la pop et qui s’est bien sûr considérablement transformée en elle), la tonalité, l’ingénierie de l’instrumentarium pop, tout cela se déploie selon des usages qui ont peu à voir avec la discipline moderniste du progrès savant telle qu’elle fut initialement pensée. Je ne vais pas déflorer tout le suspense du livre sur cette question, mais oui, en effet, en fin de compte, c’est dans la figure d’un progrès de la conscience (plus Phénoménologie de l’Esprit que Modernisme) que l’art musical pop fait en revanche une expérience à la fois décisive et cruelle du progrès : une perte d’ « innocence » que la contemplation post-moderne de toute l’histoire de la pop soudain accessible grâce à la malléabilité sans précédent des supports numériques a en fait accrue…
Bien que ton propos soit explicitement philosophique, tu te réfères à de nombreux endroits dans ton livre à une constellation d’auteurs – Simon Reynolds, David Toop, Greil Marcus, etc. – appartenant à la sphère de la critique rock ou de la critique culturelle. Dans quelle mesure ce type d’écriture a pu influencer ton travail ?
À une certaine distance des approches que j’évoquais en réponse à ta première question, la critique rock incarne à mes yeux la seule approche qui a pris l’esthétique de la pop au sérieux, pour laquelle la question est bien celle de ce qui est donné à entendre, et de la position de l’auditeur par rapport à cela. Ce sont les critiques rock — tout en s’en défendant bien souvent — qui ont donné à la pop son statut d’art musical. Les enregistrements des années 20 et 30 que l’on trouve compilés dans l’Anthology of American Folk Music de Harry Smith ne sont pas moins des œuvres, mais lorsqu’à la fin des années 60, des types comme Lester Bangs ont commencé à tenter de lire le sens de leur existence dans des morceaux pop, à interroger les subtilités d’inflexions de voix, les parti-pris sonores et à en rendre compte dans des fanzines, un pas a été accompli dans la conscience que la pop a eu d’elle-même incontestablement. La dialectique que je décris dans le livre, je l’ai constamment trouvée formulée dans les écrits de critique rock. Ce sont eux qui ont rendues ces tensions très explicites, contribué à en renforcer certaines aussi. En un sens, il y a un geste méta-critique dans ce livre : il consiste, disons à un degré de construction philosophique supplémentaire, à déployer des spécificités esthétiques de l’art musical pop que la rock critique a fait affleurer depuis longtemps.
Tu affirmes te tenir à distance de jugements trop normatifs, en priorisant l’analyse des « conditions esthétiques des œuvres » plutôt que « la question de savoir si certaines étaient plus réussies que d’autres ». Pourrais-tu cependant évoquer pour nos lecteurs ce qui serait de l’ordre de ton panthéon pop personnel, en ce qu’il relèverait des catégories que tu développes dans ton livre ?
Ah ah, je voulais me protéger dans une tour d’ivoire méta-critique, mais me voilà rattrapée. C’est une chose dont j’ai eu conscience aussi en écrivant le livre, même si de nombreux morceaux que je chéris n’y sont pas cités, je ne pouvais réfléchir à tout cela sans me référer, au moins intérieurement, à des morceaux aimés et admirés ou inversement à quelques traumatismes musicaux imposés par un mainstream aveugle et très loin de l’utopie de la popularité que je décris plus haut. Bref, aussi méta que soit ton discours, un discours sur l’esthétique ne peut jamais s’arracher à la subjectivité de celui qui le tient. Je voulais juste ne pas l’absolutiser comme Adorno semble le faire en érigeant un tribunal esthétique avec ses élus et ses exclus, ce qui n’aboutit qu’à dater sa propre position. Un panthéon personnel donc? Il serait vaste. Et il dépend du moment, de ce qui me manque dans l’océan de la musique qui s’impose à l’instant t. Je crois que mon affection pour Alex Chilton est à peu près sans limite, et que la distance entre sa voix soul, presque noire, dans le tube The Letter avec son groupe de jeunesse, les Boxtops, et l’écho caverneux de son insondable tristesse dans Holocaust est un chemin que je peux parcourir indéfiniment avec émerveillement, qui m’en dit long sur la pop elle-même, mais aussi sur la vie tout court.
L’œuvre de John Cale me reste toujours très inspirante. Presque à l’opposé de la figure de Chilton, j’aime la folie austère de Cale, entre son pompier Helen of Troy et le dépouillement d’une version live de 1992 de Dying on the Vine, où il énonce le fait le plus émouvant qui soit « I was thinking about my mother/ I was thinking about what’s mine ». J’ai même repris cette phrase, « Je repense à ma mère » dans un de mes morceaux (Dans le doute), coïncidence que seul un critique anglais a fini par remarquer.
Des morceaux de Joni Mitchell, de Laurie Anderson ou de Beth Gibbons, comptent pour moi comme absolus modèles, de Song to Aging Children Come, Same Situation, The Jungle Line, chez la première, à la sécheresse charnue de Big Science de la seconde, à son plus récent Same Time Tomorrow, et ce chant, oui, de Gibbons, si blanc et si soul à la fois, jusque dans une récente reprise d’ABBA, avec Portishead, S.O.S.
Mais ce ne sont qu’aperçus, et il y a tous les classiques, Ram de Paul McCartney, des chansons relativement récentes de Dylan comme Love Sick (en 1997), et des ivresses plus contemporaines, comme Sleep Drifter de King Gizzard and the Lizard Wizard ou des morceaux flamenco de Rosalía, comme Aunque es de noche ou De Plata, d’une expressivité fulgurante.
Voilà, c’est totalement arbitraire et partiel, on peut à peine déchiffrer une sorte de ligne de goût là dedans ! Mais je crois que j’aime trop la pop pour designer un royaume d’élus ultime et fermé sur soi, je veux laisser les portes ouvertes à d’autres souvenirs, d’autres étonnements, je préfère l’auberge espagnole au Panthéon.

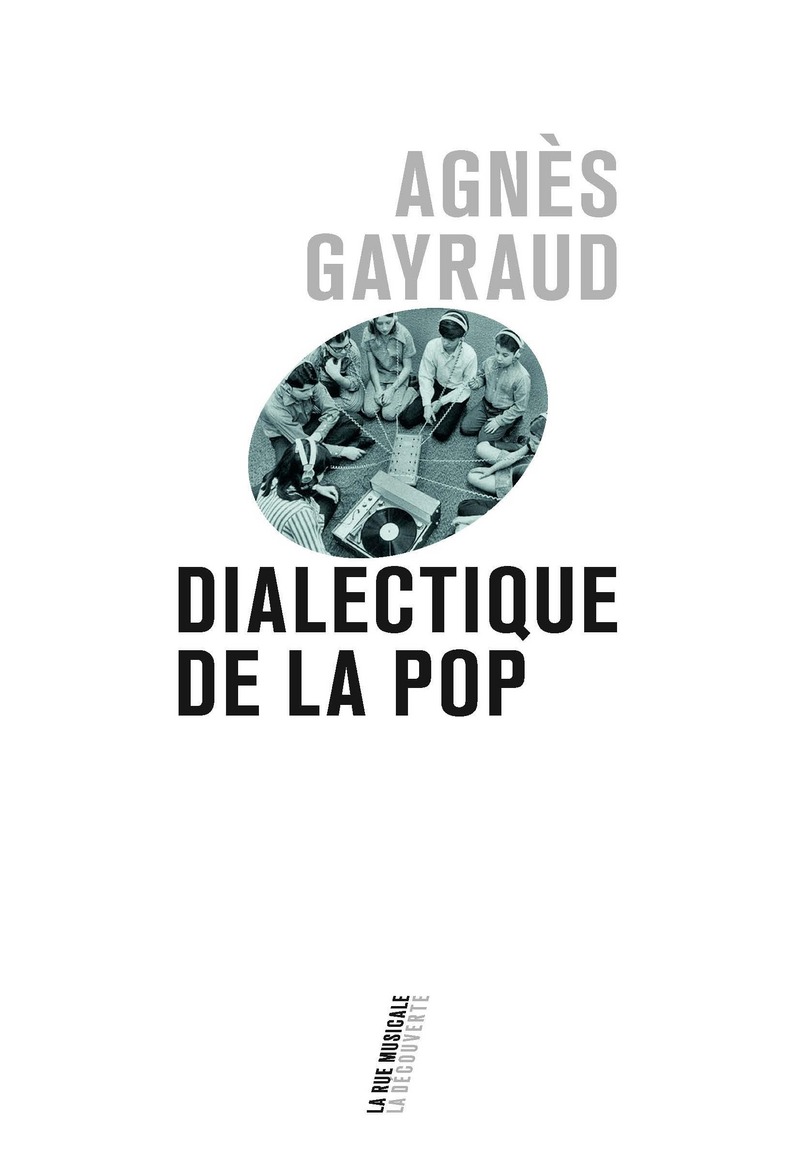 Agnès Gayraud, Dialectique de la pop (La Découverte/La Rue musicale), 528 pages.
Agnès Gayraud, Dialectique de la pop (La Découverte/La Rue musicale), 528 pages.
